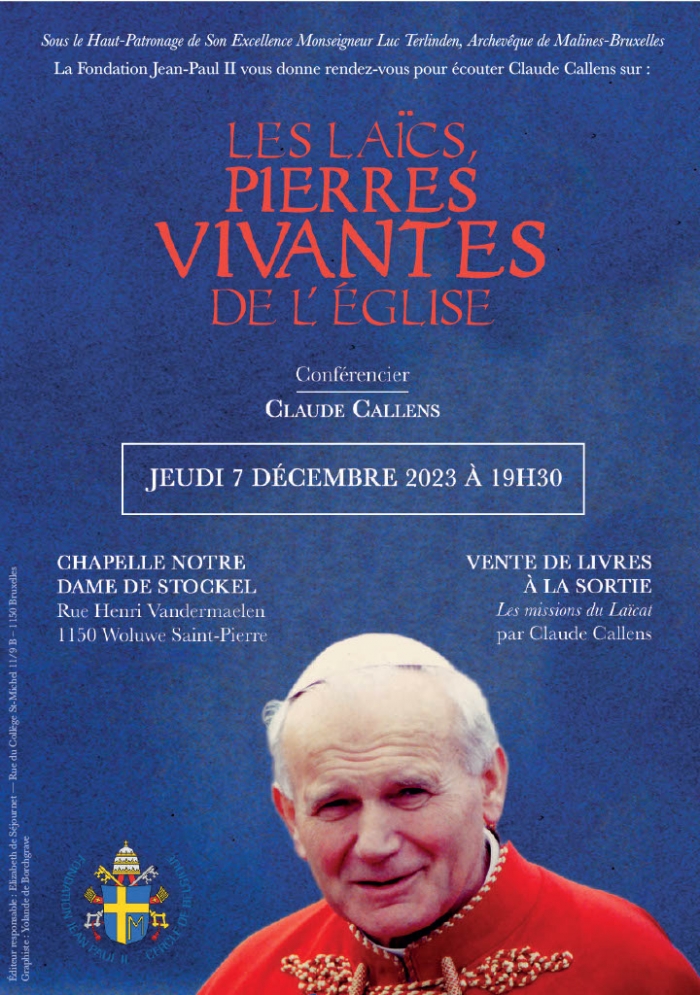De quoi l’abandon de l’Arménie par l’Europe est-il le nom ? Que dit-il de nous ? Il pourrait bien nous révéler la mort de nos nations, dissimulée derrière la survivance des « États ».
Lu (JPS) dans le mensuel « La Nef » (novembre 2023 *) :
« Je reviens d’Arménie. Cette petite république lovée dans un cirque montagneux à 1750 mètres d’altitude moyenne mais privée d’accès à la mer, entourée de quatre pays limitrophes dont trois surarmés et pratiquant une démographie conquérante sinon hostile, libérée du joug soviétique mais toujours fidèle à l’amitié et l’influence russes, abrite une nation.
Et assurément, l’Arménie est une nation. Les Arméniens parlent et écrivent une langue multimillénaire, avec un alphabet inventé il y a 1600 ans. Ils prient ensemble le Dieu unique et trinitaire depuis 1700 ans quand le roi Tiridate se convertit au christianisme. Ils professent la fierté de leur noble histoire leur ayant permis de hérisser leurs montagnes de forteresses, d’églises, de monastères et de khatchkars médiévaux, et de résister aux périls sismiques comme aux empires byzantin, sassanide puis seldjoukide qui cherchaient à les dominer et à leur imposer une autre religion. Ils communient avec ferveur dans le cadre d’une civilisation vigoureuse, constituée par un État de droit unique dans la région, par l’amour de la grande musique qui nourrit des compositeurs, un opéra et des conservatoires de qualité internationale, leur cuisine aux saveurs subtiles, et par le partage de mœurs et de valeurs issues d’une tradition ouverte. Ils ambitionnent de construire une société moderne, assurant la prospérité collective et le bien commun, tout en faisant reconnaître leurs droits historiques sur les territoires qui leur ont été arrachés et le génocide dont le peuple a été victime il y a plus de cent ans.
On retrouve bien là les cinq éléments majeurs de l’identité et de la culture des hommes qui forment une nation : la langue, la religion, l’appropriation de l’histoire passée, le désir de communion collective, et l’adoption d’un même projet d’avenir. Cela n’obère pas la diversité, dans l’harmonie cependant, car pour faire nation, il faut a minima réunir quatre de ces cinq ingrédients, or les Arméniens partagent les cinq.
Un État-nation ?
Mais les Arméniens forment-ils pour autant un État ? Ou du moins, est-il réellement viable, ce petit État de 30 000 km2 qu’ils ont pu édifier en 1991, dénué de tout accès à la mer, amputé de son emblème millénaire du mont Ararat, rabougri de ses provinces historiques de l’ouest et du sud qui ont subi l’épuration ethnique post-génocidaire, privé de ses provinces orientales peuplées d’Arméniens mais occupées par le voisin azéri ? L’Arménie est un pays pauvre, dont le PIB le situe au 136e rang mondial (111e si on retient le PIB par habitant), bien loin de ce qu’on pourrait imaginer pour un peuple cultivé, courageux et travailleur, ayant généré une diaspora dynamique et solidaire.
Et en effet, il n’est plus possible à la fin du XXe siècle de créer un État, fût-ce pour y abriter une nation, sans le soutien actif de puissances mondiales et régionales. Car si elles sont sensibles à la géographie et l’autodétermination des peuples, elles le sont davantage encore à la démographie et aux rapports de force générés par les lobbys comme par certains fanatismes qui ne dédaignent pas de recourir, parfois, à la violence.
Il en allait autrement au XIXe siècle où, à l’exemple de la France et de l’Angleterre, l’Europe avait popularisé le concept d’État-nation, afin d’optimiser les facteurs de paix intérieure et donc d’assurer le bonheur des peuples. Une nation regrouperait donc sur un territoire harmonieux des hommes partageant au moins quatre des cinq composants mentionnés plus haut et hérités du principe ancien « Cujus regio, ejus religio » qui avait mis fin aux guerres de Religion. On peut qualifier cette initiative des puissances européennes, qui dominaient alors le monde, de sagesse pragmatique en matière de relations internationales : elle avait permis de constituer de nouveaux ensembles stables, dont la cohésion fut longtemps fondée sur la culture et donc les valeurs communes de ces États-nation : Belgique, Grèce, Italie, Allemagne, Petit Liban. Mais à côté de ces succès pérennes, parfois facilités par la dislocation des empires, l’agonie de ces derniers s’accompagna aussi de grandes tragédies, comme les massacres collectifs perpétrés par les Ottomans à l’endroit de certaines de leurs populations chrétiennes.
La fin de l’État-nation
Si donc on s’en tient, comme définition pratique d’un État-nation, à la conjugaison d’une nation cohésive et d’un État prospère, la plupart des constructions du XIXe et du XXe siècles sont en régression, voire en train de s’effondrer.
En effet, les pays européens, sous l’influence de la pensée dominante en provenance d’outre-Atlantique, se sont lancés dans la mondialisation tout en pratiquant la déconstruction de leur corpus civilisationnel, alors même que, déjà sécularisés, ils étaient moins enclins à promouvoir leur propre modèle. Cette double peine grippe et même bloque le processus d’assimilation à la nation des populations nouvelles, faute de leur appropriation d’au moins quatre des cinq composants : défaut de maîtrise de la langue, bellicisme religieux, détestation de l’histoire ancienne commune, effondrement du patriotisme au quotidien, et dérision devant les projets fédérateurs. Finalement, même si l’État reste fort, la nation devient faible car divisée. Et même si cet écartèlement ne conduit pas nécessairement à la guerre civile, du moins à court terme, on trouve désormais au sein d’enclaves extraterritoriales, et même dans certains quartiers bourgeois, des hommes qui détestent le pays où ils vivent et dont parfois ils possèdent le passeport. Et qui se victimisent et revendiquent.
Les exemples de revendications ayant divisé et affaibli ces pays ne manquent pas : les Palestiniens du Liban affirmant que la route de Jérusalem passait par Jounieh ; les grands partis « islamo-progressistes » qui, en 1958 puis en 1975, refusèrent, voire combattirent la souveraineté libanaise au profit d’une solidarité arabe ; les mouvements « Woke » et « Black lives matter » qui pratiquent l’anachronisme, déboulonnent les statues, censurent les films et réécrivent les livres aux États-Unis d’Amérique ; les viols de Noël 2015 commis contre des femmes allemandes après l’arrivée de deux millions d’immigrés moyen-orientaux et africains ; les violentes émeutes à répétition en France, en 1993, 2005 puis 2023 ; les attaques au couteau dans plusieurs pays européens.
Qu’en conclure simplement, pour être audible ? On retrouve désormais sur un même territoire, un peuple qui n’est plus une nation, divisé entre des habitants anciens qui n’admirent plus leur civilisation et des habitants nouveaux qui la rejettent. Ces lézardes fissurent les pays démocratiques, jamais les dictatures.
Aussi, lorsque les grands États-nation brandissent la nécessité de valeurs partagées sans en mentionner l’origine, louent la tolérance, bégaient sur le vivre en commun et promeuvent le métissage et le multiculturalisme, sans rappeler les fondamentaux qui les ont enfantés, ils reconnaissent implicitement que s’il reste un État, il n’y a plus de nation. Et certainement pas de « civilisation judéo-chrétienne », le mot qui fâche.
Alors comment qualifier les pays d’Europe ?
Les Arméniens que j’ai rencontrés redoutent un nouvel affrontement armé avec leurs deux voisins surarmés, Azerbaïdjan et Turquie, dont la population cumulée dépasse trente fois la leur. Et ces deux voisins peuvent compter, par surcroît, sur la bienveillance d’Israël et des États-Unis – un allié régional et un allié mondial –, et sur la disqualification de facto de l’arbitre russe, durablement affaibli par le conflit ukrainien. Alors, ils m’ont interpellé, en tant que citoyen français : nous comptons sur le support de l’Europe, car ce sont des pays chrétiens comme nous. N’est-ce pas, ajoutent-ils pour se rassurer ?
Cette assertion, sous sa forme interrogative, m’a été répétée entre les pierres basaltiques du monastère de Tatev, sous la coupole en croix de l’église Sainte-Hripsimé, au fond de la fosse de Saint-Grégoire à Khor Virap, dans la chapelle troglodyte du couvent de Geghardt, face à la majestueuse crinière blanche d’Ararat contemplée depuis les ruines de Zvartnots ou la forteresse d’Amberd, devant les cartes anciennes du plateau arménien exposées au musée Matenadaran, et au son des musiques des compositeurs européens faisant chanter et virevolter les fontaines de la place de la République. Oui, elle m’a été demandée avec insistance devant ces joyaux du patrimoine de l’humanité. Pourquoi ne nous aide-t-on pas ? Nous voulons la paix avec nos voisins, et nous voulons vivre avec tous nos frères arméniens demeurés fidèles dans les villages du plateau. Nous voulons préserver notre civilisation. Elle est tellement proche de la vôtre. Vous êtes chrétiens comme nous : aidez-nous ! Vous le devez puisque vous le pouvez !
Mais ils sont fous ces Arméniens : nous chrétiens ? La constitution européenne non seulement ne le proclame pas, mais elle ne consent même pas à reconnaître – que dis-je ? nommer – les racines de l’Europe. Par honte, dégoût, peur ? Les Turcs ont beau jeu de fustiger ce qu’ils appellent un « club chrétien », car les membres du club protestent vertueusement : « Non, nous ne sommes pas chrétiens ; peut-être quelques rares nostalgiques nationalistes rances. » Et lorsque la France, attaquée par des hordes d’émeutiers, se rebiffe en parlant de valeurs communes, elle les qualifie de « valeurs républicaines », jamais de « valeurs françaises ». De quoi cet abandon est-il le nom ?
D’une désagrégation de la nation. Il n’y a plus d’État-nation, cette organisation redoutablement efficace qui avait fondé la prospérité de l’Europe et ses convictions civilisatrices – d’ailleurs, cet adjectif est honni, dans le « gloubi-boulga » des opinions qui se valent toutes et de l’égalitarisme des civilisations. On peut classer les sportifs par leurs victoires, les scientifiques par leurs prix Nobel, les peintres par leur cote chez Sotheby’s, les musiciens par leurs disques d’or, les écrivains par le nombre de lecteurs, les hommes par leur taille, les femmes dans les concours de beauté, les universités par le classement de Shangaï, les entreprises par leur valorisation boursière, les pays par le PIB. Mais pas les civilisations ! On aurait pourtant pu comparer leur apport à l’humanité en matière de systèmes de valeurs, d’aspirations eschatologiques, de découvertes scientifiques, d’innovations technologiques, de patrimoine architectural et artistique. Pourquoi en ce nouveau siècle une telle honte de ce que nous sommes ?
Question sans réponse. Alors venir en aide à trois millions d’Arméniens qui nous empêchent de bien dormir ? On a déjà milité pour la reconnaissance de leur génocide par les Turcs – dont le nom n’est pas explicitement mentionné. Nous ne sommes d’ailleurs que trente pays à l’avoir reconnu – sur 193 au total, représentés à l’ONU. Même Israël, issu d’un autre génocide, ne le reconnaît pas. On a bien fait notre devoir.
Alors non, foutez-nous la paix, les Arméniens. Laissez-nous jouir sans entrave, face à notre écran et nos réseaux sociaux, entre un Big Mac bien dodu et une canette de Coca-cola sans sucre. Nous revendiquons le droit à l’abrutissement total et à l’amnésie collective. Khalas ba’a. Vous nous rappelez trop nos racines que nous avons oubliées et notre christianisme que nous avons bradé pour une goutte de pétrole.
Rideau. »
(*) Farid Élie Aractingi
Farid Elie Aractingi, ancien cadre dirigeant dans l’industrie informatique et automobile, est engagé dans des œuvres bénévoles au service de la relation franco-libanaise.
© LA NEF n°363 Novembre 2023
 « Les semaines de travail avec lesquelles l'Opus Dei va préparer le Congrès général ordinaire de 2025 se dérouleront dans le monde entier tout au long de l'année prochaine.
« Les semaines de travail avec lesquelles l'Opus Dei va préparer le Congrès général ordinaire de 2025 se dérouleront dans le monde entier tout au long de l'année prochaine.