De Philippe Gélie sur le site du Figaro :
États-Unis : Brett Kavanaugh, le choix de Trump pour la Cour suprême
Le président Donald Trump annonce lundi la nomination du magistrat Brett Kavanaugh à la Cour suprême des Etats-Unis, ancrant ainsi dans le conservatisme l'institution qui tranche les grands débats de la société américaine.
De notre correspondant à Washington,
Dans une mise en scène calibrée pour la télévision à l'heure de grande écoute, Donald Trump a nommé lundi soir le juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Un choix conforme à ses promesses de campagne mais relativement prudent, qui privilégie la raison sur la tentation du panache et les inclinations personnelles.
Assumant devant la nation «l'une des responsabilités les plus fondamentales du président», Trump a affirmé ne pas avoir évalué les prétendants «sur leurs opinions personnelles mais sur leur capacité de mettre celles-ci de côté pour faire ce qu'exigent la loi et la Constitution. Je suis heureux d'annoncer que j'ai trouvé, sans le moindre doute, une telle personne.» Il a salué les «qualifications impeccables» de Kavanaugh, «l'un des esprits juridiques les plus affûtés de notre temps», qui a prouvé «son attachement à l'égalité devant la loi».
» LIRE AUSSI - Trump imprime sa marque sur la Cour suprême des États-Unis
Entouré de sa femme Ashley et de leurs deux filles, Brett Kavanaugh, 53 ans, a retourné le compliment au président: «Durant ce processus (de sélection), j'ai été témoin de votre appréciation pour le rôle vital du pouvoir judiciaire. Aucun président n'a jamais consulté plus largement ou parlé à plus de gens d'horizons différents pour solliciter leur contribution à une nomination à la Cour suprême», a-t-il dit.
La célébration a duré dix-sept minutes, dont de longs applaudissements pour l'heureux élu. Commence maintenant le processus de confirmation par le Sénat, qui promet d'être beaucoup plus contentieux. La majorité républicaine espère le boucler après l'été, mais les démocrates entendent le faire traîner, si possible après les législatives de novembre, où ils espèrent regagner la majorité. Cinq sénateurs démocrates qui avaient été conviés à la cérémonie ont décliné l'invitation de Trump, de même que la républicaine du Maine Susan Collins.
Passer au crible le parcours de Brett Cavanaugh pourrait prendre du temps. Juge fédéral à la Cour d'appel de Washington depuis 2006, il a rédigé plus de 300 jugements en douze ans. Son conservatisme affirmé s'y est traduit par une défense résolue des pouvoirs exécutifs du président, une tendance à arbitrer en faveur des entreprises et une hostilité remarquée à la bureaucratie. Il défend en outre une conception extensive du droit de posséder des armes. Dans la seule affaire qu'il ait jugée ayant trait à l'avortement, ce catholique fervent a refusé l'accès à l'IVG à une jeune immigrante en état d'arrestation.
Certains conservateurs religieux lui ont toutefois reproché de ne pas être allé assez loin en ne lui déniant pas un droit constitutionnel d'avorter. Ce bémol, ajouté à ses liens avec l'ancien président George W. Bush, a maintenu le suspense sur sa nomination - Donald Trump n'ayant pas dirigé les critiques de la dynastie républicaine. Non seulement Kavanaugh a servi comme conseiller juridique dans la Maison-Blanche de Bush, mais il y a rencontré sa femme, secrétaire particulière du président venue avec lui du Texas.
Auparavant, le diplômé de Yale avait travaillé à la Cour suprême pour le juge qu'il doit remplacer, Anthony Kennedy, un conservateur modéré nommé par Ronald Reagan. Il a aussi servi dans l'équipe du procureur spécial Kenneth Star, établissant les fondements juridiques d'un impeachment de Bill Clinton. De cette expérience, il a tiré la conclusion paradoxale que le président devrait être immunisé contre tout procès civil ou criminel, et même contre les enquêtes de la justice, durant son mandat. Un point de vue certainement apprécié par Trump, lui-même sous pression du procureur Robert Mueller.
Le chef de la Maison-Blanche a finalement préféré le candidat de l'establishment aux choix plus hasardeux de sa liste de quatre «finalistes». Amy Coney Barrett, 46 ans, adversaire zélée de l'avortement, aurait plu à sa base évangélique mais était assurée de déchaîner les passions au Sénat. Kavanaugh a déjà traversé ce genre d'épreuve: lorsque Bush l'avait nommé juge fédéral en 2003, la chambre haute l'avait fait patienter trois ans avant de le confirmer, lui faisant ainsi payer à la fois son rôle contre Clinton et auprès de Bush. Devant ce risque, Mitch McConnell, le chef des républicains au Sénat, avait recommandé à Trump de choisir plutôt Raymon Kethledge, un juge du Midwest au parcours moins élitiste, ou Thomas Hardiman, déjà battu sur le fil par Neil Gorsuch en avril 2017.
Le renforcement de la majorité conservatrice au sein de la Cour promet de se faire sentir sur l'évolution de sa jurisprudence. À voir les manifestants qui avaient envahi lundi soir les marches de la Cour suprême, on avait la confirmation que l'un des enjeux principaux de cette nomination tient à la possibilité de renverser le précédent de 1973 légalisant l'IVG. «L'avortement est un meurtre», proclamaient les pancartes des uns. «Ne criminalisez pas le choix des femmes», plaidaient celles des autres.






 La Hongrie (Magyarorszag) est un pays européen, néanmoins il a ses traits identitaires particuliers qui s'expliquent par l'histoire et la géographie, lesquelles déterminent pour une bonne part, le choix de la nation et modèlent sa conduite. À cela il convient d'ajouter une langue qui n'est ni germanique ni slave, encore moins latine (sauf l'alphabet), et qui appartient au groupe finno-ougrien. Cela permet de comprendre pourquoi ce pays est si attaché à son passé et à sa culture, et ne vient pas se jeter les mains vides, sans défense, dans les bras de la construction européenne, notamment sur la question migratoire, éclatée en 2015, et sur l'exercice de la démocratie. Au milieu de la Mittel Europa, distinct des Germains et des Slaves, ce pays a connu un destin singulier et une histoire douloureuse, voire terrible. En plus, ses limites territoriales ont varié fortement au cours des siècles, au gré des conquérants, et en particulier au lendemain du traité de Trianon (4 juin 1920), qui l'a démantelé.
La Hongrie (Magyarorszag) est un pays européen, néanmoins il a ses traits identitaires particuliers qui s'expliquent par l'histoire et la géographie, lesquelles déterminent pour une bonne part, le choix de la nation et modèlent sa conduite. À cela il convient d'ajouter une langue qui n'est ni germanique ni slave, encore moins latine (sauf l'alphabet), et qui appartient au groupe finno-ougrien. Cela permet de comprendre pourquoi ce pays est si attaché à son passé et à sa culture, et ne vient pas se jeter les mains vides, sans défense, dans les bras de la construction européenne, notamment sur la question migratoire, éclatée en 2015, et sur l'exercice de la démocratie. Au milieu de la Mittel Europa, distinct des Germains et des Slaves, ce pays a connu un destin singulier et une histoire douloureuse, voire terrible. En plus, ses limites territoriales ont varié fortement au cours des siècles, au gré des conquérants, et en particulier au lendemain du traité de Trianon (4 juin 1920), qui l'a démantelé.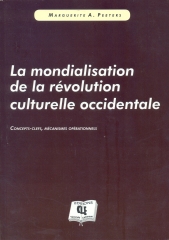 « L’imposition agressive et efficace de normes politiques et culturelles inspirées de la révolution sexuelle occidentale aux pays en voie de développement est une préoccupation croissante. Elle menace de produire dans ces pays les mêmes effets qu’en Occident : sécularisation des cultures et perte de la foi.
« L’imposition agressive et efficace de normes politiques et culturelles inspirées de la révolution sexuelle occidentale aux pays en voie de développement est une préoccupation croissante. Elle menace de produire dans ces pays les mêmes effets qu’en Occident : sécularisation des cultures et perte de la foi.  Marguerite Peeters est journaliste. De 1991 à 1993, elle a vécu en Ukraine. A son retour en Occident, elle a commencé à s’intéresser aux grandes conférences internationales de l’ONU et à la construction d’un consensus mondial sur le développement durable et ses composantes qui avait commencé directement après la guerre froide. En 1995, elle a fondé un service d’information spécialisé dans la mondialisation et les organisations internationales (Interactive Information Services). Elle a produit jusqu’à ce jour plus de 200 rapports détaillés sur ces sujets. Son travail s’est surtout distingué par les interviews d’experts qu’elle a pu réaliser pour tenter de comprendre le sens du nouveau langage employé par les organisations internationales: experts de l’ONU, de la gouvernance mondiale, des ONGs influentes. En 2001 elle a publié une synthèse analytique de ses travaux sur un site Internet américain: Hijacking Democracy – The Power Shift to the Unelected, dont elle a apporté quelques copies ici. En septembre 2003, elle a fondé à Bruxelles l‘Institute for Intercultural Dialogue Dynamics, dont l’objet est l’étude des concepts-clefs, valeurs et mécanismes opérationnels de la mondialisation. Ces dernières années, elle a participé à divers séminaires et conférences sur le thème de la laïcité
Marguerite Peeters est journaliste. De 1991 à 1993, elle a vécu en Ukraine. A son retour en Occident, elle a commencé à s’intéresser aux grandes conférences internationales de l’ONU et à la construction d’un consensus mondial sur le développement durable et ses composantes qui avait commencé directement après la guerre froide. En 1995, elle a fondé un service d’information spécialisé dans la mondialisation et les organisations internationales (Interactive Information Services). Elle a produit jusqu’à ce jour plus de 200 rapports détaillés sur ces sujets. Son travail s’est surtout distingué par les interviews d’experts qu’elle a pu réaliser pour tenter de comprendre le sens du nouveau langage employé par les organisations internationales: experts de l’ONU, de la gouvernance mondiale, des ONGs influentes. En 2001 elle a publié une synthèse analytique de ses travaux sur un site Internet américain: Hijacking Democracy – The Power Shift to the Unelected, dont elle a apporté quelques copies ici. En septembre 2003, elle a fondé à Bruxelles l‘Institute for Intercultural Dialogue Dynamics, dont l’objet est l’étude des concepts-clefs, valeurs et mécanismes opérationnels de la mondialisation. Ces dernières années, elle a participé à divers séminaires et conférences sur le thème de la laïcité En soi, le droit d’inscrire dans un registre public un fœtus né sans vie ne tranche pas la question de son statut et des conséquences qui devraient s’en suivre.
En soi, le droit d’inscrire dans un registre public un fœtus né sans vie ne tranche pas la question de son statut et des conséquences qui devraient s’en suivre.  Au moment d’écrire ces lignes, les discussions sont toujours en cours à la Commission Justice de la Chambre où les députés débattent de la sortie de l’IVG du code pénal. Pas moins de sept propositions sont été déposées, émanant de tous les partis. Certaines visent à ramener l’
Au moment d’écrire ces lignes, les discussions sont toujours en cours à la Commission Justice de la Chambre où les députés débattent de la sortie de l’IVG du code pénal. Pas moins de sept propositions sont été déposées, émanant de tous les partis. Certaines visent à ramener l’