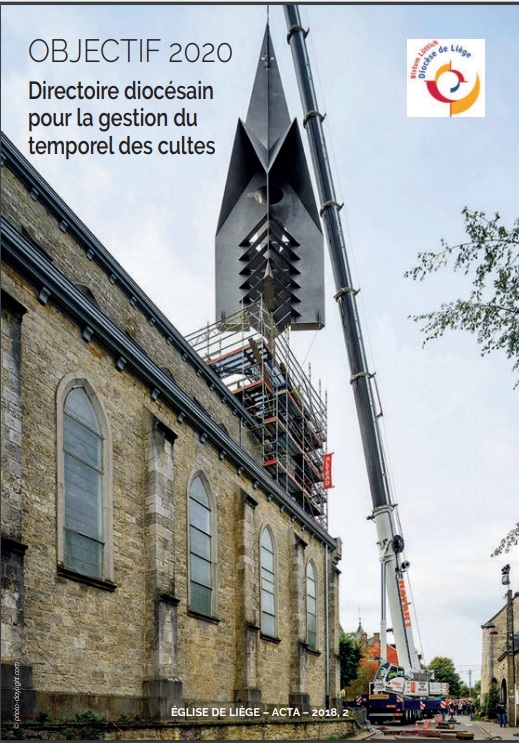D'un Egyptien chrétien vivant au Canada, sur le site Chémeré.org :
Réflexions sur les conversions des musulmans au christianisme
Le phénomène de conversion de l’islam au christianisme, que l’on signale en de nombreux pays, tant musulmans qu’occidentaux, ne devrait pas nous étonner. C’est la renaissance du christianisme des origines;, nous sommes en quelque sorte revenus au temps des catacombes : il y a bien une progression réelle, quoique difficilement quantifiable, de la foi chrétienne dans les rangs de son implacable ennemi, l’islam.
L’ampleur du phénomène est difficile à évaluer. C’est surtout par la réaction des autorités dans les pays islamiques qu’il est possible de s’en faire une idée ; cette réaction, essentiellement répressive et diffamatoire, est proportionnelle à la fréquence des conversions. S’il n’y a point d’enquêtes et encore moins de statistiques, c’est que la conversion au christianisme, du point de vue des musulmans, est bien pire que l’athéisme,; elle s’apparente à la trahison;, par conséquent, elle doit être réprimée et, dans la mesure du possible, tenue secrète. Le converti est une source de déshonneur pour sa famille, et il n’est d’ailleurs pas rare qu’il soit tué par ses proches. S’il n’est plus musulman, il est automatiquement divorcé de son épouse, et il perd ses droits sur ses enfants. Voilà pourquoi il est très rare que les convertis se déclarent publiquement chrétiens. Pour des raisons différentes, les autorités choisissent la discrétion, car elles craignent l’effet d’entraînement ou de contagion.
Il arrive aussi quelque fois que les persécuteurs eux-mêmes découvrent le Christ, ils le rencontrent à travers leur victime. Des militants fondamentalistes se sont convertis après avoir lu le Nouveau Testament, ils pensaient y trouver des éléments qui pourraient les aider à réfuter les mystères chrétiens.
En Égypte, par exemple, les autorités ont systématiquement minimisé le nombre de chrétiens. Ils étaient six millions il y a cinquante ans, à une époque où la population de l’Égypte s’élevait à un peu moins de quarante millions de personnes. À présent, la population est évaluée à quatre-vingt-dix millions, mais les coptes ne formeraient pas plus que dix pour cent des habitants, selon les estimations des autorités ! Le pape copte Tawadros a révélé à la télévision égyptienne que le nombre réel de coptes est nettement plus élevé, la compilation des registres de paroisses fait état de plus de quinze millions, certains même parlent de vingt millions, sans compter les coptes de la diaspora, dont le nombre s’élève à trois millions environ. Les musulmans convertis au christianisme ne sont pas inclus, car officiellement ils sont musulmans et légalement ils n’ont pas le droit de changer de religion.
 Le petit Alfie Evans a finalement été débranché lundi soir et, depuis lors, il continue à respirer faiblement et l'on prie pour qu'un miracle survienne... Pourtant, l'Italie, quelques heures auparavant,
Le petit Alfie Evans a finalement été débranché lundi soir et, depuis lors, il continue à respirer faiblement et l'on prie pour qu'un miracle survienne... Pourtant, l'Italie, quelques heures auparavant,