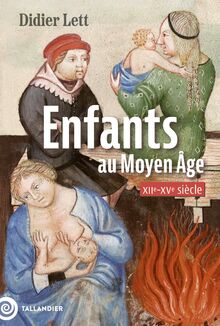Du Dr Johannes Hartl sur kath.net/news :
« Mais c'était aussi un provocateur ». À propos d'un argument récurrent concernant le meurtre de Charlie Kirk
16 septembre 2025
« Nous constatons que des opinions qui étaient jusqu'à présent considérées comme « conservatrices » normales sont aujourd'hui présentées comme illégitimes... Je ne partage pas tout ce que Kirk a dit, ni la manière dont il l'a dit. Mais... » Commentaire de Johannes Hartl
« Mais c'était aussi un agitateur ». À propos d'un argument récurrent concernant le meurtre de Charlie Kirk.
Mais il était aussi, selon ce que l'on peut lire :
- d'extrême droite
- homophobe
- raciste
- nationaliste
- favorable aux armes
- un incendiaire...
Celui qui prend les armes ne doit donc pas s'étonner de périr par les armes, peut-on lire.
Que penser de cette rhétorique ?
Nous rencontrons ici au moins deux astuces rhétoriques et logiques :
(1) l'inversion victime-bourreau
(2) le faux équilibre
L'inversion victime-bourreau est connue dans d'autres exemples extrêmes :
- « le père a battu l'enfant, mais l'enfant était aussi très insolent »
- « il a été victime d'un attentat à la bombe, mais il avait insulté le prophète »
- « Elle a été violée, mais sa jupe était vraiment très courte. »
>> L'injustice est relativisée par le contexte. La victime est présentée comme un complice secret.
De plus, cela crée un faux équilibre. Dans le cas de Kirk : comme il a exprimé l'opinion XYZ, son meurtre est en quelque sorte plus compréhensible. (Personne ne le dit explicitement, mais c'est ce qui est suggéré.)
Point important : cela suggère qu'exprimer une opinion est également un acte de violence. Or, ce n'est pas vrai. Défendre une opinion de manière argumentée est exactement le contraire de la violence, même si cette opinion est partiale, erronée, mal informée, etc. Car seul le dialogue sur les opinions peut nous sauver de la violence.
« La haine n'est pas une opinion », dit-on alors, et l'argument devient un peu plus subtil. « Les propos misanthropes, d'extrême droite, homophobes, négationnistes du changement climatique, transphobes et racistes n'ont pas leur place dans une société libre. »
Examinons cela de plus près. Le racisme, l'homophobie, etc. sont des choses graves. Cependant, le champ d'application de ces termes s'est récemment élargi de manière considérable. Un commentateur a qualifié Charlie Kirk d'« agitateur fascisant ».
Question : que représentaient exactement les fascistes, par exemple en Allemagne pendant le Troisième Reich ?
Réponse : des campagnes d'extermination contre d'autres États qui ont fait des millions de victimes, l'assassinat industriel de groupes ethniques entiers, la persécution politique cruelle des dissidents.
OK : et Charlie Kirk était en quelque sorte similaire ?
Sérieusement ?
Nous constatons plutôt que des opinions qui, il y a quelques années encore, étaient considérées comme tout à fait « conservatrices », sont aujourd'hui présentées comme illégitimes.
- « Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » : homophobe
- « Un pays doit avant tout se préoccuper de ses propres intérêts » : nationaliste
- « Il n'existe que deux sexes biologiques » : transphobe
- « L'avortement est mal » : misogynie
Kirk a tenu des propos très controversés. Je ne partage pas du tout (!) tout ce qu'il a dit, ni la manière (!) dont il l'a dit.
Mais ce qu'il a dit peut être dit. Par exemple, même si l'on n'est pas d'accord :
- « L'avortement devrait être illégal. »
- « Les lois américaines sur les armes devraient être libérales. »
- « Le changement climatique n'est pas uniquement causé par l'homme. »
(Ou que la Terre est plate et que 2 + 2 = 7)
Il est TOTALEMENT NORMAL de qualifier ces phrases de stupides, trompeuses, fausses, idiotes ou autre.
Mais on ne devrait pas tirer sur quelqu'un pour les avoir exprimées.
Même les déclarations trompeuses et fausses peuvent être exprimées publiquement dans une société libre ! (Car il n'y a souvent pas de consensus sur ce qui constitue une opinion fausse : vive le débat !)
Des termes tels que « diviseur », « agitateur » ou « misanthrope » nous viennent aussi relativement facilement à l'esprit. Mais que signifient exactement ces termes ? Ne sont-ils pas aussi des étiquettes pour désigner quelqu'un dont nous n'aimons tout simplement pas l'opinion ?
S'il existe des « agitateurs et diviseurs de droite », en existe-t-il également de gauche ? Greta Thunberg est-elle une agitateuse et une diviseuse ? Thilo Jung ? Heide Reichinnek ? Toutes ces personnes expriment à leur manière des opinions extrêmes. Je pense qu'elles en ont le droit. Sont-elles pour autant « misanthropes » ?
Lorsqu'une personne est étiquetée comme semeuse de discorde et agitatrice, la suggestion est parfaite : d'une certaine manière, il est compréhensible qu'elle soit victime de violence. Et voilà : une légitimation subtile de la violence politique. Au nom du bien, car il s'agit de lutter contre les méchants.
Tu remarques quelque chose ? Au final, on en revient à une vision très simple des choses : « Bien sûr que je suis pour la liberté d'expression. Mais seulement quand il s'agit de ma propre opinion. Car les autres sont mauvais. » Et nous revoilà au début de ce fil de discussion.
Le Dr Johannes Hartl est fondateur de la maison de prière d'Augsbourg, auteur de plusieurs livres, conférencier et professeur à l'Institut de théologie spirituelle et de sciences religieuses de l'Université philosophique et théologique de Heiligenkreuz. Il a quatre enfants avec son épouse.