Et ce moment concernera le Dicastère pour la Doctrine de la Foi.
Français Le 3 juillet, le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet de l'ancien Saint-Office, a annoncé que le Dicastère qu'il dirige publierait prochainement un document sur « divers thèmes mariaux ». Ce document doit être considéré comme une sorte de suivi des nouvelles normes sur les phénomènes surnaturels publiées en mai 2024. Le document s'inscrit probablement dans la veine qui a conduit à la publication, en septembre 2024, d'une note sur les supposées apparitions de Medjugorje (et toute l'expérience de Medjugorje).
Avec les nouvelles normes sur les phénomènes surnaturels (publiées en mai 2024), le Dicastère a déplacé son attention de l'évaluation du caractère surnaturel de phénomènes particuliers vers une évaluation pastorale de leur impact. C'est pourquoi six niveaux d'approbation ont été définis, allant de la déclaration de nature non surnaturelle (mais jamais l'inverse) au nihil obstat, ou la déclaration que rien ne s'oppose à la poursuite de cette vénération .
Fernandez a expliqué que le nihil obstat est un phénomène très positif, mais que « cela ne signifie pas que tout ce qui est dit est sans risque. Lorsque l'on considère ces phénomènes dans leur ensemble, on constate des problèmes récurrents. »
Selon Fernandez, le texte qui devrait clarifier et équilibrer les questions soulevées par les enquêtes est presque prêt, mais sa publication prendra encore plusieurs mois. Ces propos doivent être mis en balance avec une rumeur persistante selon laquelle Léon XIV aurait vu le document et refusé de l'approuver, exigeant des modifications substantielles.
Il ne s'agit là que d'une rumeur, alimentée notamment par ceux qui cherchent des signes d'une rupture manifeste entre le pape François et le pape Léon XIV. Cette rumeur reste plausible pour deux raisons. Premièrement, un document sur les phénomènes mariaux conçu sous le pape François pourrait ne pas être – dans son ton, encore plus que dans ses conclusions – totalement en phase avec Léon XIV.
Le pape François appréciait grandement la piété populaire. Léon XIV appréciait également la piété populaire. Mais il est difficile d'imaginer Léon XIV contredire ouvertement les traditions de l'Église, ou même avoir un document de la Doctrine de la Foi qui censure ouvertement des manifestations spécifiques de la foi d'une manière presque préjudiciable.
Le document sur les questions mariologiques constituera donc un test. On verra si le cardinal Fernandez, le plus fervent partisan du pape François et son « idéologue » de confiance, sera amené à modifier le ton et la portée de ses déclarations. Le pape François approuvait un langage qui marquait une rupture avec le passé, même lorsque cette rupture était peut-être exagérée ou principalement idéologique. Léon XIV ne va pas dans cette direction.
Mais Fernandez semble vouloir faire pression sur Léon XIV pour que tout ce qui avait été préparé sous le pape François soit publié.
En janvier 2025, Fernandez a annoncé que le Dicastère préparait des documents sur la valeur de la monogamie, l'esclavage à travers l'histoire et les différentes formes d'esclavage aujourd'hui, le rôle des femmes dans l'Église et, en effet, certaines questions mariologiques.
Rien de plus n'a été dit sur ces autres documents. Dans certains cas, nous connaissons la ligne directrice. Concernant l'esclavage, Fernandez fait partie de ceux qui soulignent que l'Église l'a approuvé et n'a modifié sa doctrine que plus tard. Cette affirmation contredit les données historiques, l'existence d'ordres religieux comme les Mercédaires, fondés précisément pour libérer les esclaves, et le fait que les décisions politiques des États pontificaux ne peuvent être confondues avec des positions théologiques. Fernandez, cependant, a obstinément soutenu cette idée, l'exprimant même lors d'une conférence de presse lors du Synode sur la famille en 2014 .
Concernant le rôle des femmes dans l'Église, on pourrait s'attendre à un retour à la question des diaconesses, sujet sur lequel le pape François avait créé deux commissions sans succès. On estime que le document sur la valeur de la monogamie était, de tous les documents, celui qui prêtait le moins à confusion.
La publication éventuelle de tous ces documents, et la façon dont le langage et les thèmes ont changé, pourraient représenter une clé essentielle pour comprendre comment Léon XIV veut faire avancer le pontificat.
Il y a en effet une certaine pression sur Léon XIV pour qu’il dévoile son jeu et démontre s’il veut ou non être dans la continuité de François.
Le père Santiago Martin, dans un message publié sur le site web d'Aldo Maria Valli, a souligné que, pendant la vacance du siège, l'épiscopat allemand avait approuvé un rite pour la bénédiction des unions irrégulières. Le diocèse de Cologne s'est distancié de ce document, le cardinal Woelki, archevêque de la ville, ayant estimé que ce rite contredisait la déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Fiducia Supplicans, qui autorise la bénédiction des homosexuels, mais pas celle des unions entre personnes de même sexe en tant que telles.
En parlant de Fiducia Supplicans, Fernandez lui-même a déclaré que Léon XIV n'aurait pas voulu la modifier. Il s'agit là aussi d'une forme de pression, sachant, entre autres, que Fernandez occupe actuellement un poste provisoire, comme tous les chefs de département .
La question de l'avortement a également fait l'objet de pressions. Un évêque allemand a demandé que l'avortement ne soit pas utilisé comme arme idéologique. Léon XIV ne s'étant pas encore exprimé sur la question, cette déclaration sonne comme une pression injustifiée exercée sur le pape. Léon XIV devra trouver un équilibre, mais il ne peut le faire sous la pression.
Il y a aussi le cas du père Michael Weninger, ancien ambassadeur d'Autriche devenu veuf, devenu prêtre et ayant servi quelque temps au Dicastère pour le dialogue interreligieux. Proche, voire pleinement impliqué, dans la franc-maçonnerie – il est présenté sur les sites web officiels comme aumônier de loge –, il a clairement affirmé lors d'une conférence qu'être catholique et franc-maçon n'était plus incompatible. Cette affirmation est contredite, entre autres, par plusieurs déclarations récentes du Dicastère pour la doctrine de la foi. Là encore, cependant, une pression est exercée sur le pape. Un débat public est fomenté pour contraindre Léon XIV à s'exprimer ou, par son silence, pour permettre que la position de l'Église soit manipulée.
Ces documents « en suspens », ces déclarations encore non dites, sont actuellement une épée de Damoclès sur le pontificat.
Léon XIV ne semble pas être un homme cherchant à semer la division. Mais que peut-il faire face aux agents de la division ? Comment peut-il contrer le discours qui le concerne ? Aura-t-il le courage de mettre un terme à certains des héritages les plus controversés du pontificat précédent ?
Ce sont des questions encore ouvertes pour l’instant.
Y répondre nous permettra de mieux comprendre l’orientation du pontificat.
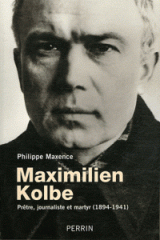 Philippe Maxence, le rédacteur en chef du bimensuel catholique « L’Homme Nouveau », a publié, en 2011, une biographie du Père Maximilien Kolbe. Rémi Fontaine avait saisi la circonstance pour écrire, dans l’édition du 13 juillet 2011 du journal « Présent », cette réflexion (im)pertinente :
Philippe Maxence, le rédacteur en chef du bimensuel catholique « L’Homme Nouveau », a publié, en 2011, une biographie du Père Maximilien Kolbe. Rémi Fontaine avait saisi la circonstance pour écrire, dans l’édition du 13 juillet 2011 du journal « Présent », cette réflexion (im)pertinente :.png)






