De JD Flynn sur The Pillar :
Une réponse papale ambiguë à une affaire parisienne ambiguë
7 décembre 2021
Huit ans après le début du pontificat du pape François, les conférences de presse aériennes ont toujours le pouvoir de surprendre, d'éclairer et, peut-être plus souvent, de confondre.
Les remarques du pape sur son vol de retour lundi à Rome, après un court voyage à Chypre et en Grèce, n'ont pas fait exception. Alors que le pape François a évoqué sa récente décision d'accepter la démission de l'archevêque de Paris, il a laissé de nombreux catholiques se demander ce qu'il essayait exactement de dire et ce qui avait guidé sa décision.
François a accepté la démission de l'archevêque Michel Aupetit la semaine dernière, annonçant sa décision le 2 décembre, sans explication. Le départ de Mgr Aupetit fait suite à des rapports des médias français selon lesquels il aurait eu une relation inappropriée avec une femme il y a plus de dix ans - un fait que l'archevêque a reconnu, tout en insistant sur le fait que la relation était non sexuelle et consensuelle, mais inappropriée - "ambiguë", a-t-il dit.
Lors de son vol de lundi, le pape François a donné quelques détails sur cette relation, affirmant que l'archevêque aurait "caressé" et "massé" sa secrétaire alors qu'il était encore prêtre. Mais le pape a également déclaré qu'il n'avait pas accepté la démission d'Aupetit à cause de ce que l'archevêque avait fait, mais à cause de la façon dont les gens en parlaient.
Le pape François a déclaré qu'à cause des "ragots des personnes chargées de rapporter les choses, un homme a perdu sa réputation, [au point] qu'il ne peut pas gouverner."
"C'est une injustice", a déclaré le pape François. "C'est pourquoi j'ai accepté la démission d'Aupetit : pas sur l'autel de la vérité, mais sur celui de l'hypocrisie."
Ainsi, selon le pape, la conduite de l'archevêque ne méritait pas en soi une révocation - une perspective qui s'aligne sur le droit canonique en la matière, et qui suit la décision de François de le nommer en premier lieu, en 2018, bien que le Vatican ait apparemment été au courant de la relation.
Toujours selon le pape, c'est une injustice que des personnes - vraisemblablement des membres des médias et leurs sources - aient colporté des ragots sur Aupetit. Mais cette injustice est devenue la base de l'éviction de l'archevêque de son poste.
Le pape a ajouté que les péchés de la chair "ne sont pas les plus graves", a rappelé à la presse que tout le monde est pécheur, et a réprimandé les catholiques qui attendent de leurs évêques qu'ils soient sans péché.
Qu'est-ce que tout cela signifie ?
Le pape François a-t-il accepté la démission d'Aupetit parce que de fausses rumeurs ou allégations avaient entravé la capacité de l'archevêque à gouverner ? Alors qu'un pasteur de paroisse peut être démis de ses fonctions parce qu'il a perdu sa bonne réputation auprès de ses paroissiens - même si cette perte de réputation n'est pas imputable au pasteur - le pape n'a pas laissé entendre auparavant qu'il appliquerait une norme similaire aux évêques diocésains.
En fait, si c'est ce que le pape a voulu dire, cette décision semble représenter un changement radical pour le pontife, qui a défendu par le passé des évêques qu'il estimait victimes de fausses accusations. Si François, qui s'est toujours efforcé de défier la pression des médias, a démis Aupetit de ses fonctions à cause d'une tempête médiatique de "ragots", a-t-il donné le pouvoir aux critiques épiscopaux du monde entier de susciter la détraction comme moyen de voir leurs évêques renvoyés ?
Autre question : le pape peut-il imputer avec précision les échecs de leadership d'Aupetit aux détracteurs de l'archevêque dans les médias ?
L'archevêque a perdu deux conseillers principaux cette année, l'un en janvier et l'autre en mars - des prêtres très respectés qui auraient démissionné parce qu'ils avaient du mal à supporter le style de leadership autocratique d'Aupetit. Ces démissions sont intervenues plusieurs mois avant que les médias français ne mettent la main sur une histoire salace concernant le passé de l'archevêque. En quoi les médias sont-ils responsables ?
Le pape voulait-il dire que les rumeurs sur la relation d'Aupetit ont circulé parmi les prêtres parisiens pendant des mois avant que la presse ne s'en empare ? Est-ce que cela a un lien avec les démissions de son personnel de chancellerie ? Les ragots cléricaux sont-ils vraiment responsables de la chute d'Aupetit ? Les détracteurs de l'archevêque au sein de la chancellerie ont-ils transmis aux médias des informations d'apparence salubre - et est-ce là ce que le pape avait en tête ?
Nous ne le savons tout simplement pas. Et cette incertitude met en évidence un défi permanent pour le Vatican : Le Pape François a promis une nouvelle approche du Vatican pour traiter les évêques ayant commis des fautes ou des incompétences administratives. Le Vatican a également promis la transparence. Mais quelques commentaires aériens hors sujet - une vue à 30 000 pieds du problème, pour ainsi dire - sont le genre de transparence qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout.
Si le pape n'est pas confronté à d'autres questions sur Paris, il continuera à être interrogé sur la façon dont il prend des décisions cruciales en matière de personnel et sur les raisons de ces décisions. Un avertissement en vol contre les commérages, associé à un petit je ne sais quoi sur les détails, n'est pas de nature à démontrer à de nombreux catholiques que l'engagement du Vatican dans la réforme de la gestion du personnel est un plan qui fonctionnera lorsque le caoutchouc rencontrera la piste.

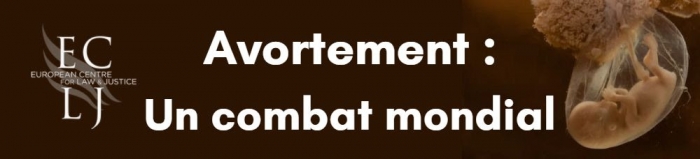

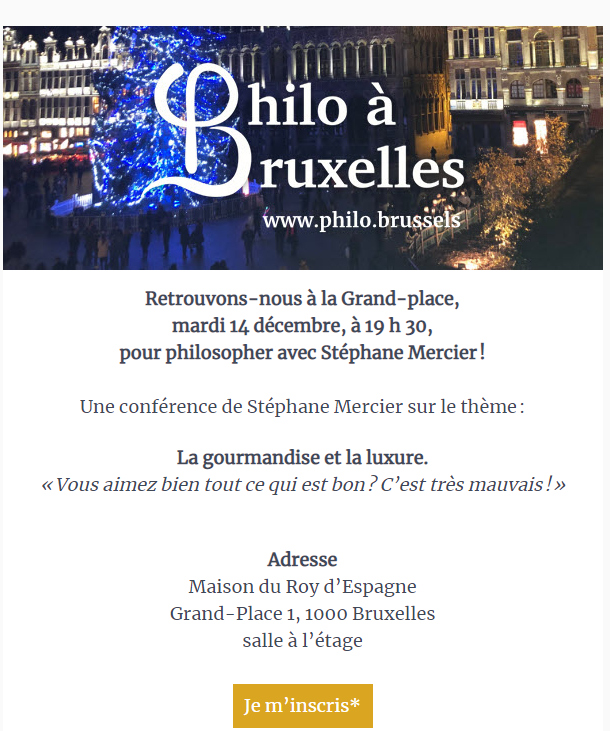
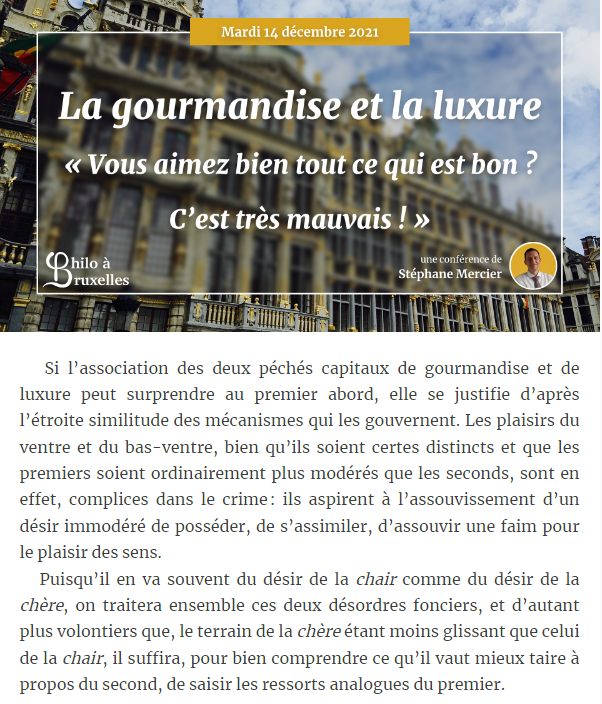



 « Dans l'avion qui le ramenait lundi d'Athènes vers Rome, le pape François a évoqué plusieurs sujets d'actualité devant la presse, il a notamment expliqué pourquoi il avait accepté la démission de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Nous publions la réponse intégrale du pape à cette question sur la base du compte rendu de l'agence romaine de presse I.Media, présente dans l'avion :
« Dans l'avion qui le ramenait lundi d'Athènes vers Rome, le pape François a évoqué plusieurs sujets d'actualité devant la presse, il a notamment expliqué pourquoi il avait accepté la démission de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Nous publions la réponse intégrale du pape à cette question sur la base du compte rendu de l'agence romaine de presse I.Media, présente dans l'avion :