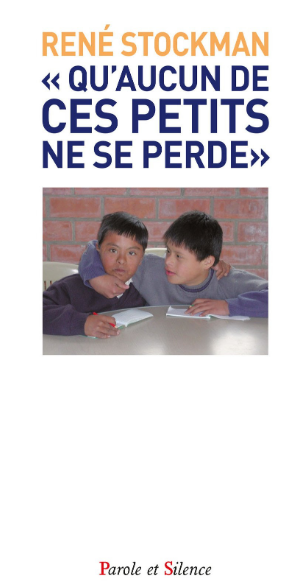IVG EN IRLANDE DU NORD : UNE JEUNE FEMME TRISOMIQUE EN APPELLE AUX DÉPUTÉS
synthèse de presse bioéthique de genethique.org
17 juin 2020

Heidi Crowter, une jeune femme trisomique âgée de 24 ans, a présenté une pétition au 10 Downing Street « contre une loi sur l'avortement qui lui donne l'impression qu'elle serait "mieux morte" ». Les 18 000 signataires de la pétition demandent aux députés de ne pas adopter le projet de loi qui légaliserait en Irlande du Nord l'avortement en cas de trisomie, possible jusqu'à la naissance. « Une majorité de membres de l'Assemblée de Stormont avait voté le 2 juin pour soutenir une motion rejetant cette "imposition" de règlements sur l'avortement par Westminster » (cf. Malgré l’opposition de l’Irlande du Nord, la Chambre des Lords soutient le projet de libéralisation de l’IVG ; Irlande du Nord : l'Assemblée irlandaise adopte une motion pour s’opposer à la loi sur l'avortement ).
« Je leur demande (aux députés) de respecter le vote de l'Irlande du Nord et de veiller à ce qu'il soit respecté, et de permettre l'égalité entre les bébés dans l’utérus », a déclaré Heidi Crowter, estimant que « la loi qui autorise l'avortement jusqu'à la naissance pour des handicaps non mortels comme le mien est une véritable discrimination dans l'utérus ». « Je pense que cela envoie un message vraiment négatif », a-t-elle ajouté.
Pour la députée Carla Lockhart du parti unioniste démocrate, à l’initiative de la pétition avec la Baronne O'Loan, « le projet de loi est "mauvais" tant sur le plan constitutionnel que moral ». « Cela donne à Heidi l'impression qu'elle ne devrait pas exister, et c'est tout simplement faux. »
D’après les chiffres de la Down's Syndrome Association, qui soutient la pétition, « environ 40 000 personnes au Royaume-Uni sont atteintes de trisomie 21 ».
Pour aller plus loin :
- Angleterre, Pays de Galles, Irlande et Irlande du Nord : les chiffres de l'avortement
- Avortement eugénique : de la trisomie à l'autisme ?
- Royaume-Uni : une maman saisit la justice pour que les foetus porteur de trisomie 21 aient des "droits égaux"
- « Nous avons tous la même valeur et nous devrions tous avoir la même valeur »