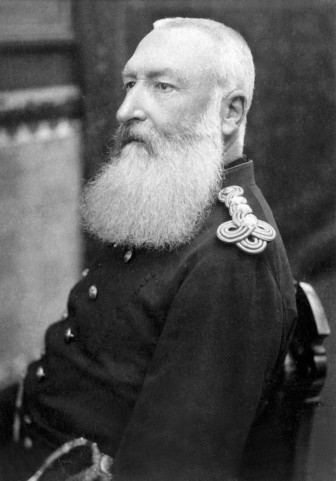Saisi par plusieurs associations et requérants individuels, le juge des référés du Conseil d’État a demandé au gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires. Sur le site web de « La Vie », l’essayiste François Huguenin réagit à cette décision :
« Alors que le déconfinement permet aux magasins et aux transports d’être à nouveau librement investis par les Français, dans des conditions sanitaires au demeurant inégalement assurées, le maintien d’une interdiction de réunion dans les lieux de culte n’avait pas manqué de faire réagir une part de l’opinion publique, catholique notamment.
Et de fait, le juge des référés du Conseil d’État a estimé qu’une telle mesure, au-delà de la période générale de confinement, présentait « un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique » et que le maintien de l’interdiction de tout rassemblement constituait, « eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière ».
A lire:
Matthieu Rougé : « La liberté de se rassembler fait partie intégrante de la liberté de culte »
On ne peut être plus clair, d’autant que le Conseil d’État a « enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de huit jours, le décret du 11 mai 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ». Chez de nombreux catholiques, la perspective de pouvoir célébrer la fête de la Pentecôte, après avoir été empêchés de se rassembler pour Pâques, même dans des conditions comportant un certain nombre de restrictions indispensables, est accueillie avec joie.
Pourtant, cette décision de justice n’est pas de nature à contenter les seuls croyants. Elle peut réjouir le citoyen quelles que soient ses convictions religieuses. Le juge a parlé et fait respecter une liberté fondamentale que le gouvernement avait abusivement enfreinte. C’est la beauté de l’état de droit de pouvoir garantir aux citoyens que leurs libertés fondamentales seront respectées, même en cas de circonstances exceptionnelles. Car la règle de droit n’est pas destinée à disparaître en période troublée. Sauf cas très particuliers, et de manière toujours proportionnée à la gravité de la situation, la règle de droit est aussi faite pour les temps exceptionnels. C’est en effet dans ces moments où le danger – et la peur qui l’accompagne – risque d’inciter les citoyens à renoncer à leurs libertés fondamentales que la loi et le juge sont précieux : en rappelant que les libertés sont à garantir en tout temps.
A Lire:
Éditorial : la sécurité ne doit pas tuer la liberté
Reste que le fait que l’action en justice ait été initiée par des mouvements relevant, à des degrés divers, d’une mouvance traditionaliste ou identitaire du catholicisme peut interroger. Que l’action n’ait pas été menée par la Conférence des évêques de France choque même certains. Mais d’une part, il apparaît plutôt intelligent que l’instance épiscopale ait cherché à préserver le dialogue avec le gouvernement. Sans qu’il y eût concertation, ces deux stratégies se sont de facto bien complétées. Et par ailleurs, quelle que soit l’identité des requérants, l’action en justice était légitime et même nécessaire. La défense des libertés publiques n’appartient à personne en particulier et la possibilité d’agir en justice n’est pas réservée à certains citoyens ! Elle est garantie à chacun, quelles que soient ses convictions. Que l’état de droit ait triomphé est la seule chose qui importe. C’est notre bien commun. »
À lire : Le Pari chrétien. Une autre vision du monde, de François Huguenin, Tallandier, 2018.
Ref. Ordonnance du Conseil d'État sur les cultes : “L'état de droit est notre bien commun“
A quand une initiative similaire en Belgique?
JPSC
 Dans une ordonnance rendue ce 18 mai, le juge des référés du Conseil d’État français ordonne au Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de « déconfinement ». Lu ce jour sur le site web du Conseil d’Etat français :
Dans une ordonnance rendue ce 18 mai, le juge des référés du Conseil d’État français ordonne au Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de « déconfinement ». Lu ce jour sur le site web du Conseil d’Etat français :