De Florence Richard dans « La Libre » ce matin :
« Des tirs, depuis le lever du jour, à un rythme régulier. Des tirs jusqu’au cœur de la capitale centrafricaine, Bangui, dans un centre-ville jusque-là relativement épargné par les violences qui ensanglantent le pays depuis des mois. En milieu de journée, vendredi, il y a eu l’espoir d’une accalmie dans le ciel noir, orageux, qui a menacé Bangui. Les fortes pluies attendues ne se sont finalement pas abattues. L’orage a tourné et la pluie courte et ténue n’a pas calmé les esprits ni dissipé les manifestants, très excités pour certains.
Depuis jeudi, la ville est paralysée par des barricades fumantes érigées par la population au lendemain de la tuerie dans l’église Notre-Dame-de-Fatima, dans le quartier du même nom. Cette attaque perpétrée sur des civils catholiques par un groupe armé dont on ignore toujours précisément l’origine a fait une quinzaine de morts et des dizaines de blessés. "Cet acte terroriste", selon les mots de la présidente de transition centrafricaine Catherine Samba-Panza, constitue une des plus sanglantes attaques depuis de mois.
Tensions interconfessionnelles exacerbées
Le 5 décembre dernier, les miliciens anti-Balaka, en majorité des chrétiens, ont investi la ville tombée à la faveur d’un coup d’Etat en mars 2013 aux mains des ex-rebelles de la Séléka, majoritairement musulmans. Depuis, les tensions interconfessionnelles se sont exacerbées.
Dès le lendemain de la tuerie de Fatima, la population s’est donc soulevée, érigeant des barricades constituées de pierres, de blocs de béton, de pneus enflammés, paralysant totalement la ville. La tension est encore montée d’un cran dans la nuit, les barricades se multipliant au même rythme que les coups de feu. Et vendredi matin, plusieurs milliers de manifestants se sont réunis très tôt pour appeler à la démission de la présidente de transition et au retrait du contingent burundais de la MISCA, accusé ne pas avoir protégé les catholiques tués dans l’église de Fatima. Des tirs ont éclaté.
Le bilan provisoire, recoupé auprès de plusieurs sources humanitaires, fait état de trois morts dans et en marge de cette manifestation ainsi que d’une dizaine de blessés. Il pourrait être beaucoup plus lourd selon le Comité international de la Croix-Rouge puisque des quartiers entiers restaient vendredi soir inaccessibles. "En ma qualité de chef suprême des armées, je prendrai toutes les mesures qui s’imposent pour que l’ordre soit rétabli dans les différents quartiers de Bangui et ses environs. Je prendrai toutes les dispositions pour que le désarmement tant demandé se fasse partout, y compris dans les 3e et 5e arrondissements de Bangui afin de permettre une libre circulation et un meilleur contrôle de tous les quartiers de Bangui", a déclaré dans la journée Catherine Samba Panza dans un discours relayé par la radio nationale.
La France est encore là pour un moment
Le désarmement du PK5, dernière enclave musulmane de la capitale, est une des autres revendications largement entendues hier chez les manifestants. "Nous ne sommes pas d’accord, l’état-major n’est pas d’accord avec cette décision", insiste le Capitaine Ahmad Nijad Ibrahi, porte-parole militaire des ex-rebelles Séléka, chassés de l’ouest et de la capitale du pays mais toujours présents à l’est et au nord. "Pourquoi ne pas chercher une solution politique ? La présidente fait comme si elle voulait faire disparaître tous les musulmans et encourager la partition du pays. Ils ne pourront plus se défendre s’ils sont désarmés. Si le gouvernement ne peut pas assurer leur sécurité, il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités et les évacue vers le nord".
L’attaque dans l’église Notre-Dame de Fatima est attribuée par la population aux "ex-rebelles" ou aux "musulmans" - ce que réfutent formellement les ex-Séléka qui crient à la manipulation. Le 5 juin, cela fera six mois que les militaires français de l’opération Sangaris sont déployés en Centrafrique. Six mois, soit la durée de la mission annoncée avant leur déploiement par la France. Au regard de la journée d’hier, une des plus explosives et instables jamais enregistrée, et avec un fort sentiment anti-français qui se développe à Bangui, l’opération paraît bien loin d’être terminée.
Ref : Bangui s’enfonce à son tour dans la violence et le chaos
Guerres tribales et religieuses récurrentes, revival islamiste aujourd’hui en prime : comme nous l’avons souligné dès le début « L’Afrique centrale n’en finit pas d’être mal partie… ». En 1960, la France comme la Belgique ont tout à coup jeté les populations d’Afrique centrale dans le bain de l’indépendance, un peu comme on jette les jeunes chiens à l’eau. L’idéologie « tiers-mondiste » était à la mode. Mais voilà, les hommes ne sont pas des chiens. Ils ont besoin d’apprendre et non pas d’être, sans transition, abandonnés à la loi de la jungle nationale et internationale. Après un demi-siècle de déconvenues et de régressions en tous genres, le spectacle est désolant, de part et d’autre de l’Oubangui et de l’Uélé. JPSC
 Le soir du 31 mai 2012, dans les Jardins du Vatican, Benoît XVI participait à la traditionnelle procession mariale – de l’église Saint-Etienne-des-abyssins jusqu’à la grotte de Notre Dame de Lourdes – et à la récitation du chapelet, qui concluent le mois de mai, dédié à la Vierge Marie.
Le soir du 31 mai 2012, dans les Jardins du Vatican, Benoît XVI participait à la traditionnelle procession mariale – de l’église Saint-Etienne-des-abyssins jusqu’à la grotte de Notre Dame de Lourdes – et à la récitation du chapelet, qui concluent le mois de mai, dédié à la Vierge Marie. Selon l’évangile, en saint Matthieu 28, 16-20, Jésus s’approchant des disciples à la montagne où il leur avait donné rendez-vous en Galilée leur dit : allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez- leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés… Et en saint Marc : annoncez l’Évangile à toutes les créatures. (Mc 16,15).
Selon l’évangile, en saint Matthieu 28, 16-20, Jésus s’approchant des disciples à la montagne où il leur avait donné rendez-vous en Galilée leur dit : allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez- leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés… Et en saint Marc : annoncez l’Évangile à toutes les créatures. (Mc 16,15).

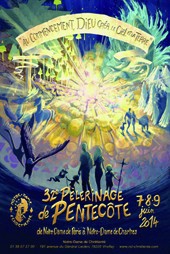
 Voici le programme. A noter que cette « nuit » sera encadrée par deux temps de prière de l’office liturgique chantées par une quinzaine de chantres membres de l’académie de chant grégorien (dir. Gérald Messiaen): les vêpres à 18h00 et les complies à 22h15. Des livrets seront mis aussi à la disposition des fidèles. L’une et l’autre de ces deux liturgies seront présidées par le chanoine Joseph Bodeson
Voici le programme. A noter que cette « nuit » sera encadrée par deux temps de prière de l’office liturgique chantées par une quinzaine de chantres membres de l’académie de chant grégorien (dir. Gérald Messiaen): les vêpres à 18h00 et les complies à 22h15. Des livrets seront mis aussi à la disposition des fidèles. L’une et l’autre de ces deux liturgies seront présidées par le chanoine Joseph Bodeson