Du blog de Jeanne Smits :
Et maintenant, ils attendent qu'Alfie Evans meure de faim ?
A l’issue de 3 heures d’audience devant la Haute Cour de Manchester, en Angleterre, mardi, le sort d’Alfie Evans est désormais scellé, selon le juge Hayden pour qui l’on est en train de vivre « le dernier chapitre de l’affaire de cet extraordinaire petit garçon ». Alors que l’enfant respire seul depuis plus de 24 heures, à l’heure d’écrire, le magistrat qui avait déjà décidé une première fois qu’il était opportun de priver Alfie de la ventilation que l’on croyait alors indispensable à sa survie, a pris de nouveau et sans surprise une décision de mort.
Le fait qu’Alfie respire seul et que, manifestement, il ne souffre pas, n’a rien changé à sa détermination. Malgré la présence du chef de cabinet de l’ambassadeur d’Italie – l’enfant est officiellement citoyen italien désormais – le juge Hayden insiste : c’est dans « l’intérêt » d’Alfie de rester sous la responsabilité de l’hôpital pédiatrique Alder Hey qui doit poursuivre son « plan de fin de vie » pour le courageux petit bonhomme de 23 mois qui a pourtant manifesté si magnifiquement sa volonté de vivre.
Le juge a donné raison aux médecins de Liverpool qui estiment qu’Alfie aurait des convulsions incessantes s’il devait faire le voyage à Rome (ou à Münich, où un autre hôpital est prêt à le soigner), qu’il n’y survivrait pas et que le déplacement serait « erroné et sans objet ».
Tout au plus envisagera-t-on de le laisser rentrer chez lui, mais pas avant « trois ou cinq jours » pour pouvoir préparer ce transfert – les médecins ont précisé que cela serait de toute façon « impossible » en cas d’« hostilité » à leur encontre et qu’ils vivaient dans une « peur véritable ».
Une fois de plus, les parents d’Alfie, Tom Evans et Kate James n’ont rien à dire. On les a définitivement spoliés de leur droit de prendre des décisions médicales pour leur enfant. Ces décisions prises désormais par les médecins et confirmées par la justice reposent sur plusieurs faits avancés par ceux-ci : le cerveau d’Alfie est profondément atteint comme l’ont montré plusieurs IRM, et il ne saurait se regénérer, tous ses mouvements sont réflexes ou convulsifs, il n’entend, ni ne voit, ni ressent le monde extérieur, il ne ressent probablement pas de douleur ou d’inconfort mais cela reste incertain, il n’a aucun espoir de voir sa condition s’améliorer et sa vie dans l’unité de soins intensifs d’Alder Hey pourrait être prolongée « longtemps ». Dans une précédente décision, datée du 20 février, le juge Hayden avait ainsi justifié le retrait de la ventilation et des soins intensifs au motif de la « futilité » de la vie d’Alfie qui n’avait aucun espoir d’amélioration, et qu'il ne communiquerait « très probablement » jamais avec ses proches.
On y lisait aussi qu’« Alfie n’a pas de réflexe de déglutition, il est incapable d’avaler et de gérer efficacement ses secrétions orales. Alfie est à 100 % dépendant du soutien du ventilateur ».
Sur ce dernier point, avancé sans la moindre réserve par l’un des médecins qui soignent Alfie, le petit garçon a prouvé que le corps médical peut avoir spectaculairement tort. Il semble aussi d’après les photos que l’on voit d’Alfie depuis l’extubation qu’il ne bénéficie d’aucune traitement pour évacuer ses secrétions orales : les avalerait-il donc ?
En proposant de le maintenir dans un protocole de fin de vie, la « solution finale » appliquée à Alfie Evans semble en outre devoir passer par le retrait de la nourriture qu’il recevait jusqu’à présent par sonde orale. Mardi soir, à 24 heures de son extubation, il n’avait reçu qu’un peu de fluides, et aucune nourriture. En même temps il consent des efforts inouïs pour continuer de respirer…
Si cela se confirme, il faut dire clairement qu’il n’est pas question de « laisser » mourir Alfie, mais d’abréger délibérément sa vie après qu’il a échappé à une première tentative qui avait pour objectif sa mort.
On notera que lorsque l’avocat de Tom Evans et Kate James, Paul Diamond, a plaidé sur le plan des « normes de civilisation », le juge lui a rétorqué qu’il ne voulait pas voir la cour servir de « plateforme pour des platitudes et des phrases choc ». Et à chaque phrase au contenu « chargé » il l’a rabroué en dénonçant ses « ridicules sottises émotives ».
Dans une déclaration mardi soir aux manifestants devant la clinique, Tom Evans a déclaré qu’avec Kate, il a dû soutenir plusieurs fois son fils en lui faisant du bouche à bouche ou en le désobstruant. Il a précisé que les médecins et infirmières avaient plusieurs fois essayé d’empêcher Kate de toucher son fils. Pour ce qui est de la « peur » dont ces médecins ont parlé, il a rappelé que la chambre d’Alfie est gardée par 6 policiers en uniforme et portant des Tasers, et ce ne sont pas les médecins qu’ils menacent. Son sentiment est que les soignants attendent le moment où l’état d’Alfie se détériorera puisqu’ils restent impassibles lorsqu’il montre des signes de détresse.
En clair : puisqu'une grande partie de son cerveau est atteint, on peut au fond considérer que sa vie humaine ne mérite plus protection.



 Vendredi 13 avril, la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) a exprimé sa préoccupation quant à la situation qui prévaut en RD-Congo. À 8 mois des élections, la Cenco s’est inquiétée des tensions entre le gouvernement congolais et la communauté internationale et a demandé des garanties sur la « machine à voter ». Lu sur le site de la Croix-Africa :
Vendredi 13 avril, la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) a exprimé sa préoccupation quant à la situation qui prévaut en RD-Congo. À 8 mois des élections, la Cenco s’est inquiétée des tensions entre le gouvernement congolais et la communauté internationale et a demandé des garanties sur la « machine à voter ». Lu sur le site de la Croix-Africa :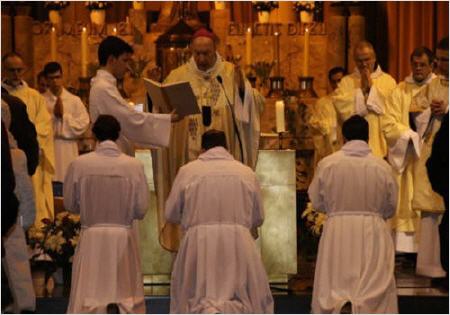
 "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime".
"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime". Un pape africain noir ne ferait pas mieux que le pape François dont la popularité est au plus haut sur le continent. Le prestige que lui a conféré son voyage en Centrafrique est-il applicable au pays voisin, la République démocratique du Congo ? L’Église catholique y a été amenée à combler le vide politique. Elle a patronné les accords de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2016, pour tenter de ménager une transition du fait de l’impossibilité d’organiser les élections prévues à l’issue du mandat du président Kabila arrivé à son terme le 19 décembre précédent. Un an s’est passé sans que rien ne change. Un collectif de laïcs du diocèse de Kinshasa a lancé un mouvement de marches pacifiques violemment réprimées (31 décembre, 21 janvier, 25 février) avec mort d’hommes. De jeunes miliciens partisans du président ont commencé une chasse aux catholiques. Bientôt on transposera le conflit sur des bases religieuses, le président étant protestant, appuyé par les nombreuses églises « néo-pentecôtistes » dites du Réveil. Celles-ci pourraient même être aujourd’hui majoritaires dans la capitale. Au total à travers le pays, des statistiques (pas vraiment précises) évaluent le nombre des catholiques et celui des protestants (y compris les Églises africaines comme le kimbanguisme) à un niveau à peu près égal autour de 45-47 % chacun (les musulmans ne sont que 2 à 3 %).
Un pape africain noir ne ferait pas mieux que le pape François dont la popularité est au plus haut sur le continent. Le prestige que lui a conféré son voyage en Centrafrique est-il applicable au pays voisin, la République démocratique du Congo ? L’Église catholique y a été amenée à combler le vide politique. Elle a patronné les accords de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2016, pour tenter de ménager une transition du fait de l’impossibilité d’organiser les élections prévues à l’issue du mandat du président Kabila arrivé à son terme le 19 décembre précédent. Un an s’est passé sans que rien ne change. Un collectif de laïcs du diocèse de Kinshasa a lancé un mouvement de marches pacifiques violemment réprimées (31 décembre, 21 janvier, 25 février) avec mort d’hommes. De jeunes miliciens partisans du président ont commencé une chasse aux catholiques. Bientôt on transposera le conflit sur des bases religieuses, le président étant protestant, appuyé par les nombreuses églises « néo-pentecôtistes » dites du Réveil. Celles-ci pourraient même être aujourd’hui majoritaires dans la capitale. Au total à travers le pays, des statistiques (pas vraiment précises) évaluent le nombre des catholiques et celui des protestants (y compris les Églises africaines comme le kimbanguisme) à un niveau à peu près égal autour de 45-47 % chacun (les musulmans ne sont que 2 à 3 %).