De l’évêque auxiliaire de Lyon, cette interview publiée sur le site « aleteia »:
 "Mgr Gobilliard, l’un des plus jeunes évêques de France, vient de publier un livre intitulé « Dieu a besoin de toi… Oui, toi ! ». Il y invite chacun à sortir de soi afin de répondre à l’appel du Christ et à être témoin de son amour, au quotidien. Dans un entretien accordé à Aleteia, il revient sur cet appel dont chacun doit se saisir.
"Mgr Gobilliard, l’un des plus jeunes évêques de France, vient de publier un livre intitulé « Dieu a besoin de toi… Oui, toi ! ». Il y invite chacun à sortir de soi afin de répondre à l’appel du Christ et à être témoin de son amour, au quotidien. Dans un entretien accordé à Aleteia, il revient sur cet appel dont chacun doit se saisir.
Comme Jésus disant à la Samaritaine « Donne-moi à boire », Dieu nous attend, nous appelle. Ce n’est nullement notre panache et notre force qu’Il sollicite, mais « notre pauvreté, nos bosses, nos peurs, nos blessures », afin qu’Il puisse les rejoindre « et les remplir de sa force et de sa tendresse ». Mgr Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, vient de publier aux Éditions de l’Emmanuel un livre intitulé Dieu a besoin de toi… Oui, toi ! qui rassemble plusieurs de ses textes (homélies, conférences…) et dans lesquels il invite les chrétiens à « sortir de leurs sacristies » afin d’être des témoins de l’amour de Dieu, ici et maintenant.
Aleteia : Qu’est-ce qui vous a poussé à sortir ce recueil ?
Mgr Emmanuel Gobilliard : Les éditions de l’Emmanuel ! Je ne l’avais pas du tout prévu. Ils me l’ont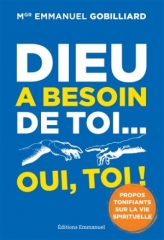 demandé en ayant remarqué que ces nombreux textes étaient déjà écrits et disponibles sur le site du diocèse de Lyon.
demandé en ayant remarqué que ces nombreux textes étaient déjà écrits et disponibles sur le site du diocèse de Lyon.
À qui s’adresse-t-il ?
Pour les homélies, je pourrais vous répondre qu’elles s’adressent aux fidèles devant qui ces homélies ont été prononcées. En fait, ce n’est pas si simple, parce que la plupart de ces homélies n’ont pas été prononcées telles que vous les lisez. À Madagascar, puis grâce au chapitre d’Evangelii Gaudium concernant l’homélie, j’ai vécu une profonde conversion. J’avoue avec une grande honte qu’auparavant, même si je priais sur les textes du dimanche suivant, je préparais mal mes homélies. Et nous savons que si nous préparons mal nos homélies, nous risquons, en fin de compte, de ne parler que de ce que nous connaissons, de nous répéter souvent et de ne pas considérer avec suffisamment de sérieux notre ministère de prédicateur de l’Évangile. Auparavant je pouvais m’appuyer sur une aisance à l’oral, sur une technique de communication, mais sur le fond j’étais un peu « léger ». Le Seigneur ne nous demande pas d’être brillants, mais de le laisser convertir les cœurs. Nous devons être à son service, dire ce qu’il veut que nous disions et cela demande de la prière, du travail et, pour moi en tout cas, une rédaction précise de ce que je veux dire. Je sais qu’il s’agit d’un texte écrit, qui s’adressera probablement à des personnes qui le liront par le moyen d’internet. Je l’écris donc pour qu’il soit lu et la plupart du temps, le jour où je dois prononcer ces homélies, je ne dis pas ce que j’ai écrit. Mais tout ce que j’ai écrit m’aura largement préparé à m’adresser aux fidèles. Pour les conférences, je respecte davantage le texte que j’ai écrit, parce que l’exercice est différent. On peut donc dire que, même s’il s’agit d’une homélie ou d’une conférence, je m’adresse à des lecteurs qui auront la bonté de me lire. Je considère généralement, sauf pour certaines conférences, que ces lecteurs sont catholiques et qu’ils ont déjà une vie sacramentelle et une vie de prière.
Lire aussi : Non mais sérieusement, comment peut-on être catholique en France ?
Vous écrivez dans ce livre « Ne rêvez-pas votre vie, affrontez-là », « Vivre à contre-courant »… Comment trouver sa place aujourd’hui ?
Pour moi toute vocation est absolument unique. Dieu s’adresse à moi personnellement, d’où le titre du livre. Cet appel est actuel, pour aujourd’hui et il s’insère dans la vie concrète, au travers de situations particulières. Je suis très heureux que le pape François insiste sur cette dimension concrète, sur le fait aussi que notre parole doit renvoyer au quotidien, à la vie des gens. Nous sommes appelés à être saints, à partir de ce que nous sommes et de ce que nous vivons, pas à partir de ce que nous imaginons. Dieu peut faire de nous des saints, même si nous nous croyons très loin, très pauvres, très indignes. La condition de la sainteté d’ailleurs c’est l’humilité, l’humilité d’accepter que c’est le Seigneur qui fait tout le travail. Il est difficile de trouver sa place tout seul. Souvent, c’est la place qui nous trouve. Il faut savoir être attentifs aux signes, aux appels, et avoir un bon accompagnement spirituel. Le bon accompagnement spirituel met en évidence la grâce propre de la personne, ce pourquoi Dieu, l’Église, le monde a besoin d’elle. Il met en lumière aussi toutes nos réticences, nos lenteurs, nos lourdeurs, nos refus, pour que nous les dépassions, que nous accueillions avec paix et confiance l’amour de Dieu sur nous, et son appel.
Lire aussi : Père René-Luc : la parabole du phare ou comment trouver sa vocation ?
Vous nous invitez à « sortir des sacristies », donc à nous mettre en mouvement et à délaisser sa zone de confort… Concrètement qu’est-ce que cela signifie ?
Nous devons surtout sortir de nous-mêmes ! Vivre, en contemplant Jésus, et en essayant de lui ressembler. Sortir de soi, c’est très concret, c’est rejoindre l’autre, ce qu’il est, le comprendre, l’accueillir, l’aimer en vérité. Jésus est, dans ce domaine, stupéfiant ! IL est attentif aux besoins des personnes. Il connait leur cœur, il veut profondément leur bien et sait quel est le meilleur chemin pour y parvenir. Les exemples dans l’Évangile, Pierre, Marie Madeleine, Zachée, Nicodème, la Samaritaine, sont très nombreux et ils révèlent combien le cœur de Jésus est totalement oblatif, tourné vers l’autre. Il est totalement tourné vers le Père, comme nous le dit saint Jean, mais aussi totalement tourné vers chacun de nous. Il s’oublie lui-même pour nous aimer, pour nous servir, pour nous sauver. L’Église en sortie, c’est d’abord cela : être capable de sortir de soi, dans un mouvement de charité qui est proprement divin ; c’est aussi sortir de ses vues un peu courtes, de ses idées trop réductrices, de ses groupes et de ses milieux lorsqu’ils sont trop centrés sur eux-mêmes. Si nous ressemblons à Jésus, si nous méditons sa Vie, sa Parole, si nous le reconnaissons dans nos frères, alors nous n’avons pas trop de souci à nous faire, nous serons « en sortie », y compris, parfois dans nos propres sacristies, dans nos groupes ou nos paroisses, où de grandes souffrances, cachées, ont besoin d’être rejointe par la charité du Christ, par l’attention aimante et accueillante de l’Église.
Lire aussi : Patrice de Plunkett : « L’engagement pour un chrétien ne se réduit pas à un engagement politique »
Faut-il être des « chrétiens décomplexés » ?
Soyons des saints et nous ne poserons plus ce genre de question ! Le courage, la force du témoignage a plusieurs expressions que l’Esprit saint saura nous dicter si nous sommes unis à Lui. L’Église n’est ni un parti politique, ni une association philanthropique, elle est le corps du Christ et est composée de différents membres. Certains témoignent par le martyre, d’autre par l’humble service du frère, d’autres encore par l’engagement au service de la vie, de la société. Les moyens sont multiples mais le but est le même : aimer Dieu, le faire aimer : aimer les gens, les faire aimer ! Dieu saura nous inspirer l’attitude juste.
Lire aussi : Tous saints ? Tous concernés ?
Gens ordinaires, pêcheurs… sommes-nous (vraiment) tous appelés à la sainteté ?
J’essaye de répondre à cette question tout au long du livre. Nous ne sommes pas égaux ! Certains naissent dans la pauvreté, d’autres dans la richesse ; certains sont favorisés, socialement, psychologiquement, intellectuellement, physiquement, d’autres le sont moins. Certains vivent de grandes souffrances, d’autres semblent en être préservés. Le seul domaine où je suis persuadé que nous sommes tous égaux, c’est la sainteté, à condition de ne pas la confondre avec la perfection ou avec l’adéquation à un système de valeurs. La vie chrétienne n’est pas d’abord une morale mais une rencontre avec le Dieu vivant. Le seul saint, c’est Lui ! Nous ne pourrons jamais être saint par nos propres forces. Regardez saint Pierre et saint Paul mais aussi saint Augustin, sainte Marie Madeleine et le bon Larron, et finalement, de façon plus ou moins visible, tous les saints. Ils ont tous fait l’expérience de leur pauvreté, de leur péché, de leur incapacité à répondre à l’appel du Seigneur. Ils ont accueilli la miséricorde de Dieu, son amour, sa force aussi et leur vie en a été transformée au point qu’ils ont rayonné de la sainteté même de Dieu. Je ne peux même pas imaginer que Dieu n’accorde pas à tous, les moyens, adaptés certes et parfois très différents, de le rejoindre, de répondre à son amour, d’être touchés par sa miséricorde, et donc d’être saints !"
Ref. Mgr Gobilliard : « Dieu ne nous demande pas d’être brillants, mais de le laisser convertir les cœurs »
JPSC

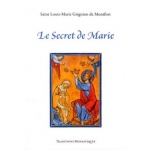 Le Secret de Marie en donne d’ailleurs le texte précis qui mérite d’être connu et médité (cf. ci-dessous). Il propose également un certain nombre d’autres prières, invocations et chants en l’honneur de la Vierge Marie, afin de bien se préparer à vivre avec et par Marie
Le Secret de Marie en donne d’ailleurs le texte précis qui mérite d’être connu et médité (cf. ci-dessous). Il propose également un certain nombre d’autres prières, invocations et chants en l’honneur de la Vierge Marie, afin de bien se préparer à vivre avec et par Marie
 Plusieurs livres récents évoquent l’engagement des chrétiens dans la cité avec pour toile de fond un monde occidental qui n’est plus chrétien, preuve qu’il s’agit là d’une question majeure. Petit tour d’horizon de ces différents ouvrages par Christophe Geffroy, dans le mensuel « La Nef », mars 2018 :
Plusieurs livres récents évoquent l’engagement des chrétiens dans la cité avec pour toile de fond un monde occidental qui n’est plus chrétien, preuve qu’il s’agit là d’une question majeure. Petit tour d’horizon de ces différents ouvrages par Christophe Geffroy, dans le mensuel « La Nef », mars 2018 :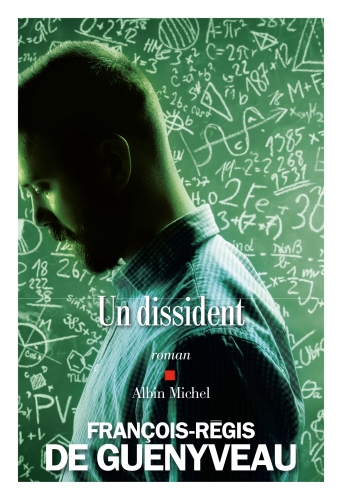 Par l'abbé de Chaillé
Par l'abbé de Chaillé 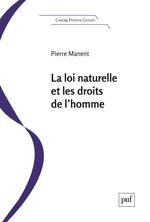


 "Mgr Gobilliard, l’un des plus jeunes évêques de France, vient de publier un livre intitulé « Dieu a besoin de toi… Oui, toi ! ». Il y invite chacun à sortir de soi afin de répondre à l’appel du Christ et à être témoin de son amour, au quotidien. Dans un entretien accordé à Aleteia, il revient sur cet appel dont chacun doit se saisir.
"Mgr Gobilliard, l’un des plus jeunes évêques de France, vient de publier un livre intitulé « Dieu a besoin de toi… Oui, toi ! ». Il y invite chacun à sortir de soi afin de répondre à l’appel du Christ et à être témoin de son amour, au quotidien. Dans un entretien accordé à Aleteia, il revient sur cet appel dont chacun doit se saisir.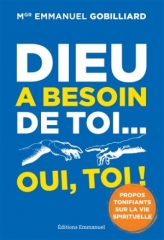 demandé en ayant remarqué que ces nombreux textes étaient déjà écrits et disponibles sur le site du diocèse de Lyon.
demandé en ayant remarqué que ces nombreux textes étaient déjà écrits et disponibles sur le site du diocèse de Lyon.