Via Metablog :
[verbatim] Philippe de Villiers, «Le krach de la Transcendance»
Philippe de Villiers consacre un chapitre de son livre «Le Moment est venu de dire ce que j'ai vu» (2015) à ce qu’il nomme Le krach de la Transcendance. Voici le texte, repris du blog de Marc-Elie. Toute la première partie offre une similitude parfaite avec le constat de Michel Onfray que l'on re/lira ici: «J'ai vu les effets de Vatican II à la messe étant gamin...»
J'avais grandi au rythme de la messe des anges et du credo grégorien. Je suivais les enfants de chœur du reposoir avec leurs paniers débordant de pétales de roses.Je tenais une petite bannière de sainte Thérèse, au milieu de la procession des Rogations qui implorait la clémence du Ciel, après les semailles, pour une juste récolte. Les surplis rouge et blanc tenaient les cordons du dais qui abritait l'ostensoir à paillettes dorées. C'était beau.
En ce temps-là, la dévotion populaire était le terreau de la liturgie. On priait avec des gestes, avec son corps, on tombait à genoux, on joignait les mains pour supplier, on frissonnait en chantant le Lauda Sion immémorial.
Au mois de mai, on marchait chaque soir d'une maison à l'autre, avec une Sainte Vierge portée à bout de bras sur un brancard. C'était le mois de Marie. J'aimais l'odeur d'encens et la plainte du requiem qui faisaient descendre en majesté un peu de ciel dans nos cœurs. Et puis la Fête-Dieu, les œufs de Pâques, la crèche, les pèlerins de Lourdes, les cloches du glas et du baptême, les croix de mission. C'était une société.
Soudain, un dimanche, tout chavire. On nous exhorte à tutoyer Dieu, dans un nouveau Notre-Père. Les agenouillons ont été descellés dans la semaine. Ils ont disparu.
On comprend que le remembrement ne s'est pas arrêté au porche de l'église, il est entré dans le chœur, en pleine messe.
On a remembré les missels. On a voulu éloigner le faste et le triomphalisme. On a descendu les statues, les tentures, on a remisé le dais: il fallait du dépouillement, revenir aux pauvretés, aux austérités des origines, aux pieds nus des catacombes ; les accessoires chamarrés de la dramaturgie sacramentelle ont été placés «en dépôt» chez le «conservateur départemental des antiquités et objets d'art», ravi de l'aubaine. Bientôt le dépôt deviendrait un dépotoir.
On nous avait expliqué, jadis, que l'autel était «orienté», qu'il devait regarder, avec les fidèles, en direction de l'est, vers le soleil levant qui triomphe de la nuit et symbolise le Christ ressuscité. Et voici qu'on installe une table à repasser au milieu du chœur, avec des tréteaux et des planches. Le curé nous regarde, convivial, collégial, «il faut participer». Il a congédié ses ornements et son calice. Il boit le vin consacré dans un verre à moutarde, il veut être comme tout le monde. Il a laissé la soutane et porte un débardeur marron. Selon le mot de Claudel, il dit «la messe à l'envers» pour «être à l'écoute des gens » et pour «faire église».
Un jeune paroissien avec une guitare, qui ressemble à Leny Escudero, entonne le chant que j'apprendrai par cœur:
Si tu en as envie,
Comme Jésus-Christ lui-même,
Tu peux faire de ta vie
Un... je t'aime.
C'est la religion de l'amour. Enfin! On n'est plus dans un règlement. On est dans l'amour. Et, si on tutoie Dieu dans le nouveau Notre-Père, c'est pour se rapprocher de lui. Ce n'est plus un Dieu de tonnerre et qui condamne. Il n'est plus au-dessus de nous, il est en nous, au milieu de nous, il chemine. C'est un voisin et non plus un Père. Si les agenouilloirs ont disparu, c'est que Dieu n'a pas besoin de ces théâtrales démonstrations d'obéissance où l'on se couvre de cendre jusqu'à s'anéantir. Dieu est Esprit. Une religion trop sensible perd l'esprit.
C'est l'aggiornamento, la nouvelle Pentecôte, le temps du Renouveau et du retour aux sources.




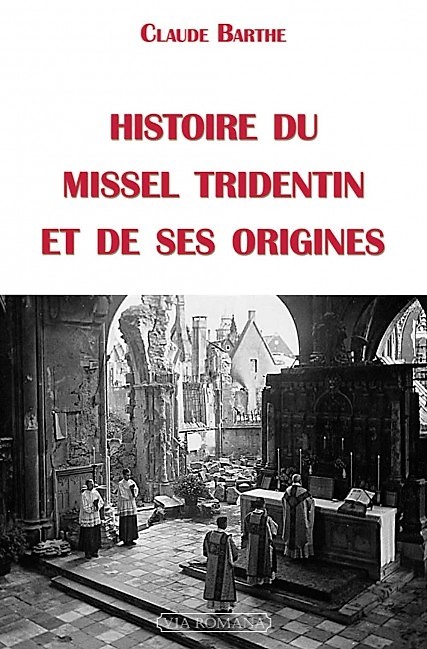
 Quand on regarde l’évolution des choses dans la société européenne contemporaine, au-delà même des questions démographiques, on ne peut pas nier un phénomène qui est la déchristianisation, y compris dans des terres qui sont restées catholiques très longtemps, telle que la Flandre il y a encore trente ou quarante années. Je sais que vous avez une conception qualitative en quelque sorte du catholicisme. Vous préférez un catholique fervent, cohérent et intense, plutôt qu’une dizaine de personnes qui, finalement, sont dans le simulacre du rite. Mais est-ce que, dans le cadre européen, ce recul quantitatif massif de l’Eglise catholique est à caractériser comme un échec, fut-il ponctuel et temporaire, ou pas ?
Quand on regarde l’évolution des choses dans la société européenne contemporaine, au-delà même des questions démographiques, on ne peut pas nier un phénomène qui est la déchristianisation, y compris dans des terres qui sont restées catholiques très longtemps, telle que la Flandre il y a encore trente ou quarante années. Je sais que vous avez une conception qualitative en quelque sorte du catholicisme. Vous préférez un catholique fervent, cohérent et intense, plutôt qu’une dizaine de personnes qui, finalement, sont dans le simulacre du rite. Mais est-ce que, dans le cadre européen, ce recul quantitatif massif de l’Eglise catholique est à caractériser comme un échec, fut-il ponctuel et temporaire, ou pas ?  « Il y a beaucoup de chose à répondre sur une telle question. C’est un échec et en même temps c’est une chance. Dans les décennies qui ont précédé, où nous avons connu dans pas mal de pays d’Europe, notamment la Belgique , un catholicisme très marquant dans la société, faisant même parfois un peu la pluie et le beau temps – et parfois un peu trop –cela avait ses avantages – on avait une société qui était très imprégnée de la foi et des valeurs chrétiennes, mais il manquait peut-être une conviction très personnelle. On était mis sur des rails dès l’enfance : la paroisse, l’école, la famille, les mouvements de jeunesse. C’était beau, mais qu’y avait-il derrière, dans les profondeurs du cœur et de l’âme humaine ? Aujourd’hui, dans cette situation que l’on peut qualifier d’échec, car marquée par un recul quantitatif, il y a l’aspect positif que, si quelqu’un désormais est catholique, il le sera davantage par un choix personnel. Cela, c’est un gain. Donc, oui, il y a un échec, mais un échec qui correspond aussi à une chance qui est offerte.
« Il y a beaucoup de chose à répondre sur une telle question. C’est un échec et en même temps c’est une chance. Dans les décennies qui ont précédé, où nous avons connu dans pas mal de pays d’Europe, notamment la Belgique , un catholicisme très marquant dans la société, faisant même parfois un peu la pluie et le beau temps – et parfois un peu trop –cela avait ses avantages – on avait une société qui était très imprégnée de la foi et des valeurs chrétiennes, mais il manquait peut-être une conviction très personnelle. On était mis sur des rails dès l’enfance : la paroisse, l’école, la famille, les mouvements de jeunesse. C’était beau, mais qu’y avait-il derrière, dans les profondeurs du cœur et de l’âme humaine ? Aujourd’hui, dans cette situation que l’on peut qualifier d’échec, car marquée par un recul quantitatif, il y a l’aspect positif que, si quelqu’un désormais est catholique, il le sera davantage par un choix personnel. Cela, c’est un gain. Donc, oui, il y a un échec, mais un échec qui correspond aussi à une chance qui est offerte.