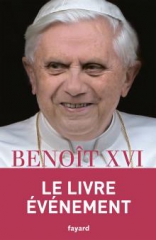 Sur ces "Dernières conversations" avec Benoît XVI, publiées chez Fayard, nous avons déjà relaté ici le commentaire du « Corriere della Sera » reproduit en français par notre confrère Diakonos.be. et notre consoeur de "Benoît et moi". Sur le site web de « Famille Chrétienne » Charles-Henri d'Andigné présente son propre éclairage dont nous extrayons les aspects complémentaires à ceux que souligne le journal italien (les intertitres sont de Belgicatho) :
Sur ces "Dernières conversations" avec Benoît XVI, publiées chez Fayard, nous avons déjà relaté ici le commentaire du « Corriere della Sera » reproduit en français par notre confrère Diakonos.be. et notre consoeur de "Benoît et moi". Sur le site web de « Famille Chrétienne » Charles-Henri d'Andigné présente son propre éclairage dont nous extrayons les aspects complémentaires à ceux que souligne le journal italien (les intertitres sont de Belgicatho) :
Un livre important
« C’est un livre événement. Probablement pour la dernière fois, le pape émérite se confie. Dans un dialogue très vivant avec le journaliste allemand Peter Seewald, il s’exprime sur les raisons profondes qui l’ont poussé à renoncer, sur les relations qu’il entretient avec François, sur Vatican II, sur son itinéraire de théologien surdoué, sur l’importance de la liturgie, sur son « progressisme », à ses débuts, sur son conservatisme supposé, l’âge mûr venant... On le retrouve tel qu’en lui-même, bienveillant, humble, et surtout très libre et ouvert d’esprit. Voyant les choses de très haut, il désamorce tranquillement, avec le sourire, toutes les questions polémiques que son interlocuteur, en bon journaliste qu’il est, se fait un plaisir de lui poser. S’en dégage une image attachante, celle d’un homme affaibli par les années, certes, mais accessible, simple, totalement dénué d’ambition personnelle. Ses réponses courtes, directes, vont droit à l’essentiel, et, en dépit d’une supériorité intellectuelle évidente, il ne cherche jamais à s’imposer, mais à expliquer avec douceur et persuasion. « Il n’est évidemment pas question de dire "Je détiens la vérité", rappelle-t-il. C’est la vérité qui nous détient. »
Originaire de Bavière, dont il parle le dialecte avec Benoît XVI, le journaliste et écrivain Peter Seewald, 62 ans, a réalisé trois livres d’entretien avec ce dernier : Le Sel de la terre (1997), longue interview du cardinal Ratzinger, Lumière du monde (2010), et enfin DernièresConversations (2016). Il est revenu à la foi catholique à la suite de ses rencontres avec le pape. »
François
« Comme tout le monde, Benoît XVI a été surpris par l’élection du pape François (« Je le connaissais, bien sûr, mais je n’avais pas pensé à lui »), et refuse d’un sourire de confirmer que les Pères du conclave de 2005 avaient déjà pensé à lui, ce que murmurent les gens prétendument bien informés... »
« …Le style assez peu conventionnel de son successeur ne lui pose aucun problème. Il se réjouit qu’un pape du Nouveau Monde — jésuite qui plus est soit élu au siège de Pierre. Toutes ces nouveautés, pour lui, sont le signe que « l’Église n’est pas immobile, qu’elle est dynamique et ouverte et qu’elle est le lieu de nouvelles évolutions. Voilà, résume-t-il, qui est beau et encourageant. »
« Les papes se suivent et ne se ressemblent pas. Faut-il les opposer, comme le font souvent les médias, et parfois les fidèles, dans les commentaires un peu faciles, ou souligner leur complémentarité ? Dieu corrige chaque pape à travers son successeur, fait remarquer Peter Seewald, lui demandant en quoi François le corrige. Le pape sourit, approuve et souligne ce qui le frappe chez François : son attention directe aux hommes. Sous-entendu : ce n’était pas mon fort. « Mais, poursuit-il, c’est aussi fondamentalement un pape de la réflexion », comme le prouve, parmi d’autres textes, l’exhortation apostolique Evangelii gaudium, parue en 2013. Tout de même, insiste Peter Seewald, n’est-il pas trop impétueux, trop excentrique ? « Chacun son tempérament », répond Benoît XVI en riant. Ajoutant : « Il y a une nouvelle fraîcheur dans l’Église, une nouvelle joie, un nouveau charisme qui plaît aux gens. »
Dieu de la Foi et Dieu de la Raison
« Impossible d’oublier en lisant ce texte que Benoît XVI est un grand théologien, même s’il parle de son brillantissime parcours d’universitaire avec modestie. Le 24 juin 1959, tout nouveau professeur de théologie à l’université de Bonn, il donne son cours inaugural. Thème : le Dieu de la foi et le Dieu de la philosophie. Le jeune intellectuel est nourri de Pascal, qui dans son Mémorial traite du « Dieu de la foi », du « Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob », par opposition au « Dieu des philosophes ». Le pape théologien explique : « Il était à l’époque très moderne de considérer la Grèce comme un fourvoiement, une intrusion erronée dans le christianisme. On s’attachait au contraire à rechercher le message biblique originel, ce qu’il y a de vivant dans le Dieu d’Abraham [...] et qui est complètement différent du Dieu des philosophes. » On songe ici au célèbre discours de Ratisbonne (2006), qui traitait des rapports entre foi et raison, et de l’apport décisif sur ce plan de la pensée grecque : « Je pense que nous pouvons voir ici l’harmonie profonde entre ce qui est grec, au meilleur sens du terme, et la foi en Dieu fondée sur la Bible », disait le pape. Cette harmonie profonde est au cœur de la pensée de Benoît XVI, qui s’appuie sur saint Augustin. « J’en suis arrivé à la conviction que nous avons évidemment besoin du Dieu qui a parlé, qui parle, du Dieu vivant. Du Dieu qui touche au cœur, qui me connaît et qui m’aime. Mais Dieu est également accessible à la raison. » Nulle opposition, donc, entre le Dieu de la foi et le Dieu des philosophes, pas plus qu’entre la foi et la raison.
« Il n’est pas question de dire "Je détiens la vérité" : c’est la vérité qui nous détient. » Benoît XVI »
Il faut évangéliser
« …Cette nouvelle évangélisation, autrement dit la rechristianisation des nations anciennement chrétiennes, n’est-ce pas un vœu pieux ? lui demande Peter Seewald. Pas du tout, rétorque le pape émérite, « il ne faut pas renoncer à annoncer l’Évangile ». Et de prendre l’exemple du monde gréco-romain, dont il était plus qu’improbable qu’une poignée de juifs démunis réussissent à l’évangéliser... Improbable à vue humaine. Benoît XVI enfonce le clou : « Il est absolument indispensable d’annoncer cette Parole qui porte en elle la force de construire l’avenir et de donner du sens à la vie des hommes. »
Ses prières jésuites préférées
« Benoît XVI apprécie particulièrement la prière de saint Ignace :
« Prends, Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j’ai et possède, c’est Toi qui me l’as donné... » Il aime à réciter aussi celle de saint François Xavier : « Je t’aime, non parce que Tu peux me donner le paradis ou me condamner à l’enfer, mais parce que Tu es mon Dieu. Je t’aime parce que Tu es Toi. »
Sa préférée est la prière de Pierre Canisius : « Vous, mon Sauveur, vous m’avez, en quelque sorte, ouvert le cœur de votre corps très saint. J’avais l’impression d’en voir l’intérieur. Vous m’avez dit de boire à cette fontaine, m’invitant à puiser les eaux de mon salut à votre source, ô mon Sauveur. Pour moi, j’éprouvais un grand désir de voir couler de là dans mon âme, à flots, la foi, l’espérance et la charité. J’étais assoiffé de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, et je vous priais de me purifier, de la tête aux pieds, de me couvrir et de me parer. Puis, j’osai approcher de votre cœur, tout rempli de douceur et y apaiser ma soif ; et vous m’avez promis une robe tissée de paix, d’amour et de persévérance, pour couvrir mon âme dénudée. Avec cette parure de salut, je sentis grandir en moi la confiance de ne manquer de rien et que tout tournerait à votre gloire. Amen. »
Benoît XVI. Dernières conversations, avec Peter Seewald, Fayard.
Ref. Livre événement : Benoît XVI par lui-même
En attendant la suite des réactions dans la « cathosphère » et ailleurs...
JPSC
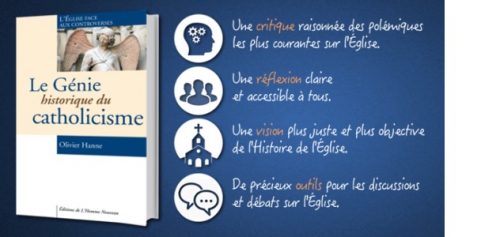
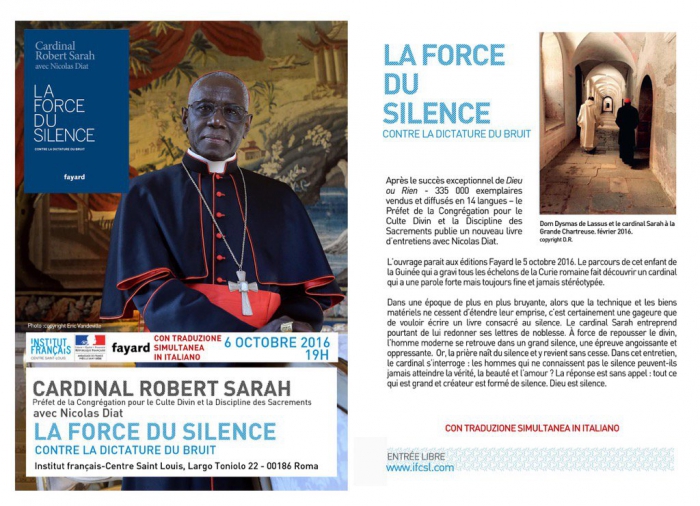
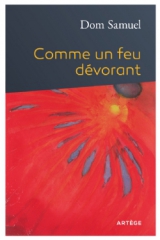 Comme un feu dévorant
Comme un feu dévorant Dans le livre d’entretiens que Joseph Ratzinger a publié ces jours-ci, il y a peu de choses concernant le pape François. Mais elles sont toutes significatives. Le point de vue de Sandro Magister sur son site « chiesa » :
Dans le livre d’entretiens que Joseph Ratzinger a publié ces jours-ci, il y a peu de choses concernant le pape François. Mais elles sont toutes significatives. Le point de vue de Sandro Magister sur son site « chiesa » :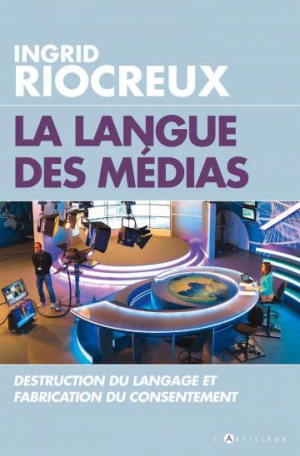 Ingrid Riocreux
Ingrid Riocreux De cet ample panorama (indisponible sur le net) réalisé par Jean-Marie Guénois nous retiendrions, en évitant de redire ce que nous avons déjà noté par ailleurs, ces quelques extraits parlant de
De cet ample panorama (indisponible sur le net) réalisé par Jean-Marie Guénois nous retiendrions, en évitant de redire ce que nous avons déjà noté par ailleurs, ces quelques extraits parlant de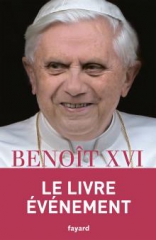 Sur ces "Dernières conversations" avec Benoît XVI, publiées chez Fayard, nous avons déjà relaté
Sur ces "Dernières conversations" avec Benoît XVI, publiées chez Fayard, nous avons déjà relaté 
