Dans un long article sur le libéralisme publié dans la revue « Arguments », le journaliste Grégoire Canlorbe (*) a interrogé l’économiste Henri Lepage (*), entre autres sur la déresponsabilisation des individus par la société post-moderne, qui privilégie la notion de risque : une tendance à laquelle n’échappent ni le droit, ni la morale, ni même aujourd’hui la religion. Henri Lepage y déclare à propos du fameux « principe de précaution » :
« […] Henri Lepage : Il s'agit d'un problème essentiel, tellement important que malheureusement il est impossible de faire l'économie d'une explication circonstanciée.
Le fait fondamental est la tendance de notre droit de la responsabilité civile à abandonner, depuis la fin du XIXème siècle, la faute comme critère moral d'incrimination et y substituer la notion moderne de responsabilité collective. Quelles en sont les conséquences ?
Tout accident est la conséquence d'une chaîne de causalités qui, à la limite, peut être presque infinie. Chaque accident est le produit d'une chaîne causale qu'on peut reconstituer, si on veut, jusqu'au Big Bang qui a donné naissance à notre univers. Si un gosse, un jour de 14 juillet fait éclater un pétard qui met le feu à la grange du maire, pourquoi ne pas remonter jusqu'au Chinois qui a inventé la poudre il y a plus d'un millier d'années ? N'est-ce pas à cause de son invention qu'un tel événement a pu se produire ? Pour que la responsabilité soit un concept utile, il faut interrompre cette chaîne des causalités quelque part, et disposer pour cela d'un critère. Dans la traduction occidentale du droit, ce critère est celui de la faute – que celle-ci s'apprécie en fonction d'attributs objectifs comme le meurtre ou l'invasion de propriété, ou qu'elle résulte d'une évaluation subjective des faits de nature jurisprudentielle. La théorie de la faute permet de s'arrêter à un maillon de la chaîne en donnant à ce maillon une signification morale. La faute est dès lors considérée du point de vue juridique comme la fin de la chaîne. Toutes les causes précédentes sont alors effacées et deviennent invalides.
Que se passe-t-il lorsque l'on élimine la faute comme condition de la responsabilité ? Tous les maillons de la chaîne reçoivent la même qualification morale. Pourquoi s'arrêter là plutôt qu'ailleurs ? Pourquoi s'en tenir au gosse et ne pas condamner l'inventeur chinois ? Pourquoi pas le maire qui a "omis" d'interdire les pétards à moins de 50 mètres de toute habitation ? Pourquoi pas 500 mètres ? (Ce serait encore plus sûr). Pourquoi ne pas les interdire totalement ? Dès lors qu'il manque ce critère moral, il n'y a plus qu'une solution : c'est au législateur qu'il appartient de choisir, et de décider sur les épaules de qui retombera le devoir de responsabilité. Le législateur devient celui qui distribue le risque par décret. On passe dans un nouveau type de régime juridique où une certaine activité se trouve légalement qualifiée comme risquée et un certain acteur dans le déroulement de cette activité est purement et simplement désigné comme l'auteur du risque, et donc comme coupable, chaque fois que l'accident se réalise. La responsabilité ne devient plus qu'un terme générique pour toutes sortes de distributions de risque imposées par les autorités politiques.
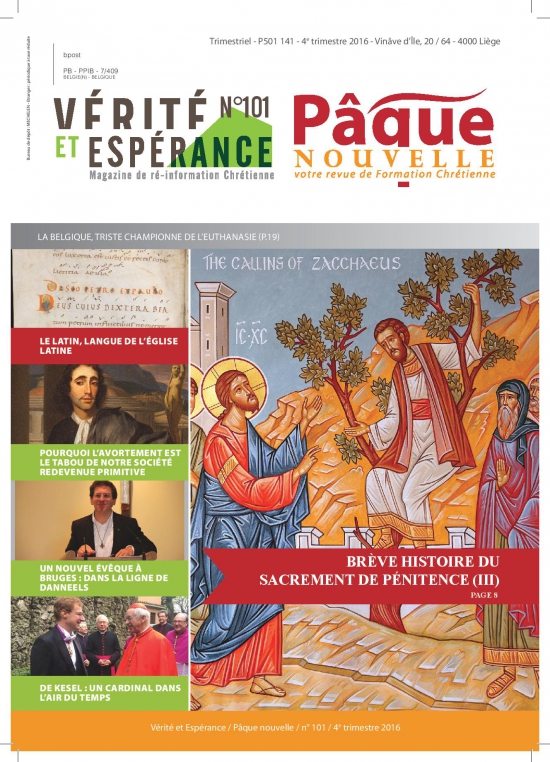
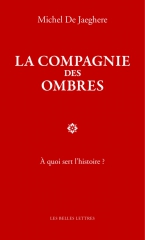 Sur
Sur 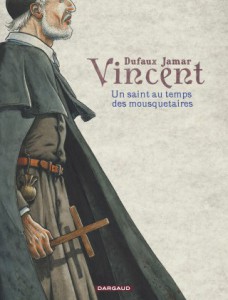
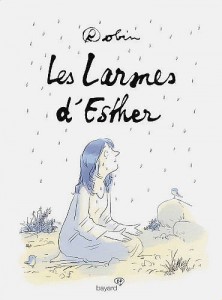

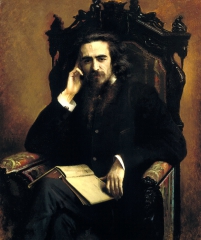 "Il n'y a que trois choses certaines attestées par la Parole de Dieu :
"Il n'y a que trois choses certaines attestées par la Parole de Dieu :