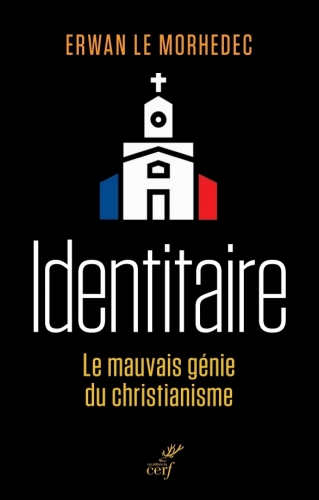Actrices ou spectatrices, les femmes oubliées de 1830
Livres - Publications - Page 122
-
Actrices ou spectatrices, les femmes oubliées de 1830
"Pourquoi pas ?" Ce fut notre première réaction quand Soraya Belghazi nous fit part de l'essai qu'elle a consacré aux femmes dans la Révolution de 1830. En même temps, nous ne pouvions ... -
Une histoire secrète de la Révolution russe
Lu sur aleteia.org (Philippe Oswald) :
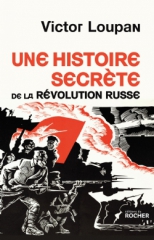 Dans la terrifiante intimité des bolcheviks
Dans la terrifiante intimité des bolcheviksC’est dans une plongée au cœur des ténèbres que nous entraîne cette enquête historique et quasi policière, à l’occasion du centenaire de la révolution russe.
Qui a joué le rôle décisif dans la Révolution bolchevique de 1917 ? Incontestablement Léon Trotski, répond, documents à l’appui, Victor Loupan, spécialiste reconnu de l’histoire russe et du communisme. Son enquête, nourrie notamment par de nouvelles sources russes et anglo-saxonnes, rend la primauté au fondateur et premier chef de l’Armée rouge dans la réalisation du coup d’État du 25 octobre. Elle met aussi en lumière l’aide financière, venue principalement d’Outre-Atlantique, dont Trotski profita pour la cause de la Révolution, sans oublier de se servir lui-même généreusement.
Lénine avait bénéficié de la complicité des Allemands qui avaient cru faire un bon calcul en permettant à cet agitateur de traverser en pleine guerre le territoire du Reich pour se rendre de Suisse jusqu’en Russie (c’est le fameux épisode du « wagon plombé »). Trotski, lui, avait compte ouvert chez des banquiers de Wall Street, acharnés à faire tomber le tsarisme accusé d’être responsable de pogroms récurrents en Russie (Soljenitsyne a rendu justice au pouvoir impérial à ce sujet dans son essai historique : Deux siècles ensemble (Fayard) dans lequel il montre au contraire le rôle émancipateur des derniers tsars à l’égard des juifs, qui n’est pas sans évoquer celui de Louis XVI avant la Révolution française ).
Pour autant, Trotski n’a nullement « renvoyé l’ascenseur » à ses financiers, jugeant lui aussi que « Les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle nous les pendrons », selon la célèbre citation attribuée à Lénine. Seule la Révolution mobilisait son énergie, et pour y parvenir, tous les moyens étaient bons ! Son absence totale de scrupule et d’empathie le met, si l’on peut dire, au-dessus de Lénine quant à la cruauté et à l’acharnement à éliminer tout adversaire réel ou supposé. S’il fait aujourd’hui figure de victime en raison de son exil puis de son assassinat au Mexique en 1940 sur ordre de Staline, Trotski ne fut pas moins impitoyable que le « petit père des peuples ». Mais face à « l’homme de fer » Staline, sa morgue et sa mégalomanie lui ôtèrent toute prudence et causèrent sa perte.
Lire la suite sur le site d'aleteia.org
-
Messe selon la forme ordinaire : pas de retour vers des traductions plus proches des textes latins de référence.
L’instruction « Liturgiam authenticam » publiée en 2001 par la SC du Culte divin pour mettre en œuvre une application correcte de la constitution conciliaire de Vatican II sur la liturgie est, selon le pape François, « la source de nombreux blocages ». Il vient de créer une Commission pour la réviser . Sur le site du journal « La Croix », le correspondant à Rome de ce journal commente :
"Une commission a été constituée au sein de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements en vue de faire évoluer l’instruction Liturgiam authenticam sur la difficile question des traductions des textes liturgiques, a appris La Croix.
Publiée en 2001 à la demande de Jean-Paul II, Liturgiam authenticam, « instruction pour la correcte application de la constitution sur la sainte liturgie du concile Vatican II », demandait notamment que le texte latin d’origine soit « traduit intégralement et très précisément, c’est-à-dire sans omission ni ajout, par rapport au contenu, ni en introduisant des paraphrases ou des gloses ».
Traductions bloquées
Dans les faits, cette exigence romaine entraîna de grandes difficultés pour la traduction de l’édition de 2002 du Missel romain. La Congrégation pour le culte divin, présidée par le cardinal Robert Sarah s’appuyait sur Liturgiam authenticam pour exiger des épiscopats des traductions littérales de l’original latin. Mais la traduction anglaise, entrée en vigueur en 2011, a été rejetée par la moitié des fidèles et 71 % des prêtres à cause de son style « trop formel » et « pompeux ».
> LIRE AUSSI : Le nouveau Missel anglais demeure contesté
Les traductions espagnoles et italiennes sont bloquées, de même que la traduction française, dont une première version avait déjà été rejetée par Rome en 2007.
> LIRE AUSSI : Missel romain, bisbilles autour d’une traduction
En Allemagne, les évêques, s’opposant « à un langage liturgique qui ne serait pas le langage du peuple », avaient refusé en 2013 le travail de la commission imposée par Benoît XVI et entamé leur propre travail. Celui-ci aurait récemment été rejeté par la Congrégation pour le culte divin.
Ce serait justement après que les évêques de langue allemande se sont plaints auprès de lui que le pape François, qui a déjà profondément remanié la composition de la congrégation, a demandé à son secrétaire, Mgr Arthur Roche, de constituer une commission pour dépasser les blocages.
« La rigidité dont la congrégation a fait jusqu’ici preuve vis-à-vis des traductions réalisées par les différents épiscopats a été la source de blocages et de paralysies, souligne un observateur. Il faut admettre des traductions qui tiennent compte à la fois de la fidélité aux sources et de la culture de ceux qui les reçoivent. »
L’information de la constitution de cette commission avait déjà été annoncée le 11 janvier par le vaticaniste Sandro Magister (lire l’article en italien) […]"
Ref. Une commission pour assouplir les règles de traduction des textes liturgiques
Les préconisations actuelles de la SC du culte divin tendent à rendre les traductions vernaculaires en usage dans la forme ordinaire de la messe plus proches des textes latins de référence : elles s’inscrivent dans un certain esprit de « réforme de la réforme » conciliaire voulue par Benoît XVI. Mais le pape François estime que cette orientation est une erreur, comme il le déclare sans ambages dans un livre que vient de publier le P. Antonio Spadaro, directeur de la revue jésuite « Civilta cattolica ». L'espoir s'éloigne donc de rapprocher les deux formes de la messe romaine voire d'en réunifier un jour le rite.
JPSC
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, liturgie, Livres - Publications 0 commentaire -
Le christianisme survivra, n'en déplaise à Michel Onfray
De Vincent Morch en Tribune sur le site du Figaro (Vox) :
«N'en déplaise à Michel Onfray, le christianisme survivra !»
FIGAROVOX/TRIBUNE - Dans Décadence, Michel Onfray annonce la fin de la civilisation judéo-chrétienne. Pour Vincent Morch, le sort de celle-ci n'est pas joué, même s'il est vrai que le christianisme, fondé sur la faiblesse et la liberté de l'homme, est intrinsèquement fragile.
Diplômé de philosophie, Vincent Morch a enseigné en Afrique avant de travailler dans l'édition.
Le christianisme est une religion fondée sur la foi en la résurrection et en la divinité de Jésus de Nazareth. Cette foi née au seuil d'un sépulcre et bâtie sur des idées qui se situent aux limites de ce qu'il est possible d'admettre n'aura, pour de multiples raisons, jamais cessé d'être agonisante. Que ce soit à cause de ses ennemis déclarés, comme dans le cas des persécutions perpétrées par les empereurs romains ou par les républicains fanatiques de 1793, ou sous le poids de ses propres errances (songeons à la corruption de la Rome des Borgia), il n'est pas un siècle où elle n'aura été confrontée à des périls mortels - il n'a jamais existé, il ne pourra jamais exister, de «chrétienté triomphante». La réelle nouveauté de la période qui s'ouvre avec la Révolution française est la prolifération des déclarations de morts imminentes: le christianisme doit être prochainement aboli par une nouvelle religion (Robespierre, Hugo), par la science (Comte, Marx) ou par un nouveau type humain (Nietzsche). Lorsque Michel Onfray, dans son nouvel ouvrage Décadence, prétend faire le constat de la mort du christianisme, il se situe donc dans une tradition déjà longue. Or, en dépit de son incontestable déclin en Occident, il existe encore à ce jour des chrétiens. Il en existe même suffisamment pour remplir massivement, au grand étonnement de ceux qui les croyaient déjà six pieds sous terre, les rues des grandes villes françaises. Sont-ce là les derniers spasmes d'un cadavre? Ou les prémisses d'une résurrection?
Le christianisme est né au seuil d'un tombeau. Et il y demeurera à jamais. Depuis deux mille ans il ne cesse d'osciller entre le Royaume des morts et le Royaume des cieux, entre la nuit du néant et la joie du Salut. Annonçant un Messie crucifié, il ne joue pas le jeu habituel qui régit la vie des humains, celui de la réussite et du pouvoir. Il ne flatte pas les instincts. Il ne surfe pas sur les appétits. Il place la révélation ultime du Dieu tout-puissant entre la faiblesse d'un nouveau-né et l'effroyable spectacle d'un innocent sacrifié. Il est une religion de la faiblesse. Il est donc, en lui-même, intrinsèquement fragile. Et fragile, il l'est d'autant plus qu'il proclame que les êtres humains sont fondamentalement libres, et que c'est librement qu'ils doivent se positionner par rapport à lui. Lors de son face-à-face avec Ponce Pilate, le Christ, le Fils de Dieu, n'a pas daigné faire ployer devant lui celui qui le jugeait en lui révélant toute sa gloire. Il a laissé se détourner de lui celui qui se demandait ce qu'était la vérité alors qu'il était la vérité même. Il l'a laissé face à sa conscience, son intelligence et son cœur, au risque de la croix, au risque de sa mort.
Parce que, selon les chrétiens, c'est en se livrant pleinement à la liberté humaine que le Christ a opéré le salut du monde - une liberté réelle, effective, matérialisée par la croix, mais transfigurée, par-delà ses propres intentions et sa propre compréhension d'elle-même, par la grâce du matin de Pâques - leur religion constitue une avancée inédite et décisive dans l'histoire de l'humanité, et un leg infiniment précieux pour l'ensemble de celle-ci. En effet, il faut se souvenir qu'il est apparu dans un monde où la culture gréco-romaine dominante imaginait que les hommes comme les dieux étaient soumis au pouvoir inflexible de la fatalité. C'est cette intuition religieuse fondatrice qui a donné naissance au théâtre tragique où les spectateurs voyaient se nouer des intrigues dont ils connaissaient déjà le terme. Œdipe, quoi qu'il puisse faire, finira toujours par tuer son père et épouser sa mère. C'est aussi cette intuition qui, alliée au génie intellectuel grec, a donné naissance à la science. La raison, le logos, est en effet une conceptualisation de la fatalité: une chaîne de nécessités à laquelle il est impossible de contrevenir. Si l'on a dessiné un triangle sur le sable, alors il est nécessaire que la somme de ses angles soit égale à deux angles droits. Anodin appliqué aux mathématiques, ce principe s'avère hautement problématique à mesure que l'exigence de scientificité s'élargit à des domaines qui touchent à l'existence concrète des hommes - et, en premier lieu, à la politique et l'histoire.
De fait, la conséquence la plus remarquable de la mise en retrait du christianisme dans la vie des idées est la prolifération concomitante de discours fatalistes. De toutes parts, on cherche à nous convaincre que tout est déjà écrit: le milieu de notre naissance conditionne notre vie ; la mondialisation est inévitable ; le capitalisme est voué à l'échec ; la Grande-Bretagne restera dans l'UE. Et si l'Islam correspond à un certain «air du temps», c'est précisément en ce sens qu'il est une religion fataliste. Il se révèle ainsi comme le surprenant pendant religieux d'une rationalité qui prétend enchaîner toute la destinée humaine dans des préceptes intangibles. Or, devant toutes ses injonctions aussi impérieuses que contradictoires, les derniers événements témoignent que les consciences se révoltent, et cette révolte - aussi absurdes et dangereuses que ses manifestations puissent revêtir - manifestent une immense aspiration à la liberté. Et cette liberté pratique objective n'est compréhensible qu'à partir d'une philosophie de la liberté, qui elle-même n'a pu naître que dans un environnement judéo-chrétien. Notre civilisation est judéo-chrétienne en ce qu'elle croit que l'être humain est un être libre, jusques et y compris dans les critiques et les reniements qu'elle a pu formuler envers ses racines.
Non, n'en déplaise à Michel Onfray, le sort de notre civilisation n'est pas joué. Et tant que des hommes voudront être libres, ils puiseront, consciemment ou pas, à ses racines judéo-chrétiennes. Aux chrétiens, quant à eux, de se montrer dignes de l'héritage qu'ils ont reçu, en témoignant de la capacité de la foi à déplacer des montagnes, à faire advenir la Nouveauté qui libère et qui sauve.
-
Hergé, un "anticommuniste primaire" ?
Une opinion de Corentin de Salle, directeur scientifique du Centre Jean Gol, sur LaLibre.be :
Tintin, "l’anticommuniste primaire" (OPINION)
En 1929, "Tintin au Pays des Soviets" dénonçait un régime dont l’idéologie a fait 100 millions de morts dans le monde. Ne serait-il pas opportun de rappeler aux Belges francophones d’aujourd’hui les méthodes et les crimes du communisme ?
Comme chacun sait, "Tintin au Pays des Soviets" sort enfin en version colorisée. Comme tous les autres lecteurs de ma génération, je l’ai découvert en noir et blanc durant mon enfance. Mais quand on évoque cette bande dessinée, je pense directement à une autre : une planche de Claire Bretécher lue durant mon adolescence. Claire Bretécher était, dans les années 70, la dessinatrice vedette du "Nouvel Obs". Elle séduisait chaque semaine un public de gauche bourgeoise et cultivée (on ne disait pas encore "bobo" à l’époque) car, avec talent, elle tournait en dérision ce milieu qui adorait se voir étrillé de la sorte.
Le gag tient en une planche : un enfant lit un exemplaire de "Tintin au Pays des Soviets" (acheté dans une brocante ou autre part). Sur ces entrefaites, les parents arrivent. Ils sont scandalisés. Ce sont des parents de la classe supérieure votant PS -typiquement le couple qui lit le "Nouvel Obs" - et, d’autorité, le père confisque l’album et décide qu’il est hors de question que son fils lise cette BD car elle véhicule un "anticommunisme primaire"… Mais, saisi d’un doute, il se demande subitement s’il ne s’agit pas de l’édition originale, auquel cas l’exemplaire vaudrait une fortune. Du coup, son attitude change du tout au tout et il dit, de manière admirative : "Tu as eu le nez fin, mon fils." Avant de s’apercevoir, déçu, qu’il s’agit en réalité d’une réédition.
Les horreurs du régime soviétique
Aussi étrange que cela puisse paraître aujourd’hui, cette attitude de rejet de la première aventure de Tintin était très répandue dans le troisième quart du siècle passé. A cette époque, une portion importante des intellectuels, des journalistes, des enseignants, etc., était communiste ou proche des idées communistes. Et, pour beaucoup de gens, y compris les non-communistes, il était stigmatisant de se voir traiter "d’anticommuniste primaire". Condamner trop brutalement cette idéologie rédemptrice du genre humain revenait à passer pour un ignare doublé d’un imbécile. C’était également courir le danger de passer pour un être dénué de compassion face aux souffrances de la classe exploitée. Rétrospectivement, cela fait sourire quand on sait que la mise en œuvre criminelle de cette idéologie a fait 100 millions de morts dans le monde. Cet aveuglement volontaire face aux horreurs du régime soviétique a été abondamment commenté depuis, notamment dans "Le Passé d’une illusion", le remarquable ouvrage de François Furet, et dans toute l’œuvre indispensable de Jean-François Revel.
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Culture, Débats, Jeunes, Livres - Publications, Politique 0 commentaire -
A propos de l’identité de l’Europe et de la France
Pour l’hebdomadaire « Famille chrétienne », Antoine Pasquier interroge le P. Benoît-Dominique de la Soujeole, professeur à la Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg :
 " Deux ouvrages à paraître le 12 janvier1 s'interrogent sur le rôle des catholiques, et de l'Eglise en général, dans l'affirmation et la défense de l'identité chrétienne de la France et de l'Europe. Cette identité chrétienne existe-t-elle ? Doit-on choisir entre le Christ et la patrie ? Le discours du pape François sur les migrants menace-t-il l'identité de l'Europe ? Eléments de réponse avec le père Benoît-Dominique de la Soujeole2, professeur de théologie dogmatique à la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg (Suisse).
" Deux ouvrages à paraître le 12 janvier1 s'interrogent sur le rôle des catholiques, et de l'Eglise en général, dans l'affirmation et la défense de l'identité chrétienne de la France et de l'Europe. Cette identité chrétienne existe-t-elle ? Doit-on choisir entre le Christ et la patrie ? Le discours du pape François sur les migrants menace-t-il l'identité de l'Europe ? Eléments de réponse avec le père Benoît-Dominique de la Soujeole2, professeur de théologie dogmatique à la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg (Suisse).L'identité d'une nation peut-elle être définie comme chrétienne ?
L'identité d'une nation comprend plusieurs éléments dont le principal est la culture, c'est-à-dire une sensibilité et une mentalité communes façonnées par l'histoire. La culture française, en son état actuel, possède des éléments venus du droit romain (le mariage par échange des consentements par exemple), d'autres – les plus nombreux et les plus profonds – venus du christianisme, d'autres encore plus récents, les Lumières notamment. La culture française continue aujourd'hui de recevoir d'autres éléments qui s'intègrent plus ou moins harmonieusement au patrimoine déjà possédé. Il résulte de ce donné d'abord historique que l'élément chrétien ne suffit pas à définir la culture française : un juif, par exemple, est tout aussi français qu'un catholique.
L'identité d'une nation est-elle immuable, figée ou évolue-t-elle au fil du temps ?
La culture est une réalité humaine fondée dans l'exercice commun de l'intelligence et de la volonté des membres de la communauté nationale. Comme toute réalité humaine, elle est évolutive. Il faut noter la différence entre évolution et révolution. L'évolution, sur le modèle du vivant qui grandit harmonieusement (de la graine à l'arbre par exemple), est l'idéal souhaitable, car elle dit un enrichissement. Malheureusement, l'histoire connaît aussi des révolutions, c'est-à-dire des discontinuités plus ou moins radicales. Cependant, la culture peut, avec le temps, intégrer après discernement ce qui s'est présenté comme une révolution pour en faire, en définitive, une évolution. Pour la culture française, la révolution française mérite bien son nom, et nous voyons depuis deux siècles comment notre culture tâche de discerner dans cet apport ce qui permet une évolution. Ce processus n'est pas achevé !
La défense de l'identité chrétienne d'une nation peut-elle aller jusqu'à refuser certains préceptes évangéliques, comme l'accueil de l'étranger ?
Une culture nationale qui doit tant au christianisme, comme l'est la culture française, ne saurait affirmer à un moment de son histoire qu'une valeur évangélique aussi profonde que l'accueil de l'étranger (c'est un des « critères » du jugement dernier en Mt 25,35) pourrait être mis de côté. Ce serait, non seulement bafouer l'Évangile, mais être infidèle à notre culture.
-
La geste héroïque de ces soldats inconnus de la grande cause de Dieu
Lu sur le site de l'Homme Nouveau (Thibault Bertrand) :
Ces soldats inconnus de la grande cause de Dieu

© AED. Diacre, historien, ancien directeur national de l’Aide à l’Église en détresse, Didier Rance vient de faire paraître À travers la grande épreuve : Europe de l’Est, témoins de la foi dans la persécution (Artège, 344 p., 19,90 €). Dans un temps où la foi est mise à rude épreuve en Orient par l’islamisme radical, en Occident par un athéisme militant qui ne dit pas son nom, il est bon d’avoir recours aux témoignages de ceux qui surent aimer jusqu’au bout le Christ Sauveur.
Votre ouvrage propose au lecteur de découvrir les témoignages de catholiques d’Europe de l’Est, laïcs ou religieux, hommes ou femmes, ayant subi dans leur chair les persécutions des régimes communistes. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré ces témoins du totalitarisme antichrétien ?
Didier Rance : Au lendemain de la chute du Rideau de fer, je suis parti, avec le soutien du Père Werenfried, fondateur de l’Aide à l’Église en Détresse (AED), recueillir en Europe centrale et orientale le témoignage d’hommes et de femmes qui avaient pour point commun d’avoir affirmé leur foi catholique dans la persécution et d’en avoir payé le prix. J’avais un double avantage dans cette quête par rapport au journaliste standard. D’une part, j’avais du temps – j’ai rencontré longuement, plus d’une fois et parfois sur près de vingt ans, ces témoins. D’autre part, l’AED les avait aidés dans la persécution voire dans la clandestinité quand l’Occident les avait oubliés, et cela établissait dès le début une relation forte et chaleureuse.
Ce travail a donné naissance à une dizaine d’ouvrages, pays par pays, et à des synthèses nourries par ma participation aux travaux de la Commission pontificale Nouveaux Martyrs. Mais – outre que demeurent largement méconnues en France les pages de foi, de souffrance et de courage vainqueur écrites par les confesseurs de la foi dans les régimes communistes – il manquait un ouvrage pour en présenter quelques-uns des plus représentatifs. D’où ce livre. La plus grande difficulté pour moi a été de devoir me limiter à une dizaine de portraits fondés sur nos entretiens, quand bien d’autres auraient tout autant mérité d’y figurer.
Comment résumer les rigueurs et persécutions auxquelles ont été confrontés les communautés et les fidèles catholiques sous le joug communiste en Europe centrale ou orientale, dans des pays aussi divers que l’Albanie, la Biélorussie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie ou encore la Roumanie ?
Un fait en constitue le résumé le plus parlant : les dix témoins de ce livre, qui vivaient dans huit pays différents, ont tous connu les goulags de l’Union soviétique ou de l’Europe de l’Est, la prison et souvent les tortures. Et, bien sûr, ils sont loin d’être les seuls et, en particulier, ils témoignent aussi pour leurs frères et sœurs qui sont morts martyrs dans ces pays.
-
Bienvenue au "Passé Belge", un blog consacré à notre histoire
 Nous saluons l'apparition d'un nouveau blog sur la toile; il est consacré à l'histoire de notre pays et s'intitule "Le Passé Belge; l'actualité de la recherche historique". Son initiateur, Paul Vaute, qui est aussi rédacteur en chef des pages liégeoises de la Libre ("La Gazette de Liège") le présente en ces termes :
Nous saluons l'apparition d'un nouveau blog sur la toile; il est consacré à l'histoire de notre pays et s'intitule "Le Passé Belge; l'actualité de la recherche historique". Son initiateur, Paul Vaute, qui est aussi rédacteur en chef des pages liégeoises de la Libre ("La Gazette de Liège") le présente en ces termes :Faire connaître de multiples facettes, souvent ignorées, de notre passé, refléter la richesse des travaux les plus novateurs de nos historiens de niveau professionnel, rendre accessibles au plus grand nombre les résultats des recherches scientifiques: telles sont les ambitions de ce blog dont l'auteur, journaliste de profession, est aussi historien de formation.
Toutes les études dont il est ici question enrichissent notre savoir relatif au passé belge. Passé belge ?... Il faut simplement entendre par là les faits humains de portée sociale, culturelle, politique, économique, technique... qui se sont déroulés, de la préhistoire à nos jours, sur le territoire actuel de la Belgique. Ainsi procède-t-on dans tous les pays, même si la plupart ont revêtu leur forme étatique actuelle bien plus récemment que le nôtre. Ce faisant, on n'ignore certes pas les espaces et les cadres politiques différents dans lesquels vécurent nos ancêtres: Gaule, empire romain, royaume franc, empire carolingien, morcellement féodal, Pays-Bas bourguignons puis habsbourgeois, principautés de Liège et de Stavelot-Malmedy, régimes français puis hollandais, royaume de Belgique...
Si ce recueil se veut des plus diversifiés, attentif aux apports venus des deux côtés de la frontière linguistique - et aussi des pays et régions limitrophes qui ont, un temps, partagé nos destinées -, il n'est pas possible d'être exhaustif, tant la masse est considérable. Nous faisons donc des choix dans les revues, colloques, communications, thèses et TFE, ouvrages collectifs, éditions de sources, rapports de fouilles archéologiques... les plus récents, sans nous interdire de temps à autre une incursion dans des textes plus anciens mais qui ont conservé toute leur valeur. Nous espérons ainsi jouer notre rôle de passeur entre le monde des chercheurs et le grand public.
A celles et ceux que l'une ou l'autre de nos présentations a mis en appétit, nous ne manquons pas de fournir les références des documents complets: articles, livres, sites, pdf...
L'ensemble fait en outre l'objet d'un classement par thèmes et d'un classement par époques, les deux pouvant être croisés.
Les sujets qui ont déjà été abordés sur ce blog sont d'un intérêt évident; jugez-en :
De Godefroid Kurth (1847-1916), on connaît surtout l'œuvre historique et l'action politique, de l'importation des méthodes de travail allemandes dans nos universités à la promotion du catholicisme social dans notre vie politique. Mais bien peu savent que l'auteur de Clovis, le fondateur, de La cité de Liège au Moyen Age ou de La nationalité belge prit aussi à cœur la cause de Sitting Bull et des Amérindiens en général. ...
Le 18 juin 1316, après des années d'affrontements, le prince-évêque de Liège Adolphe de la Marck et les représentants des corps constitués (chanoines, grands chevaliers, villes importantes appelées "bonnes villes") s'entendaient pour mettre fin aux hostilités dans le village de Fexhe-le-Voué, aujourd'hui Fexhe-le-Haut-Clocher. S'il faut mettre bien des nuances à une certaine vision romantique prompte à exagérer la portée de ce compromis établissant un équilibre entre les pouvoirs, il n'en a pas moins fourni une sorte de base "constitutionnelle" à...
Ce n'est pas sans raison qu'une statue équestre de Charlemagne se dresse à Liège, au boulevard d'Avroy, comme à Paris, sur le parvis de Notre-Dame, pour ne citer que ces lieux emblématiques. A des titres divers, le roi franc devenu empereur s'est vu ou se voit encore octroyer un rôle de pionnier, voire de père, de la Belgique ou de la France mais aussi de l'Allemagne, de l'Europe, de l'Occident chrétien… "
La maison L. Hoeberechts fils a duré presque un siècle, jusqu'en 1910. Pas de chauvinisme: c'est à des Allemands que nous devons l'implantation d'une industrie du piano, comme ce fut aussi le cas en France et en Angleterre. Et à en juger par l'étude que Pascale Vandervellen consacre à cette naissance, les anciens Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège ont démarré plutôt petitement. Alors que les concepteurs du mariage du clavier et des cordes...
"Pardonnez-moi, Prince, si je / Suis foutrement moyenâgeux", chantait Brassens. Il aurait pu le dire aussi de ces écrits pour lesquels notre signature est fréquemment sollicitée et par lesquels une plainte ou une demande est adressée à telle ou telle autorité. Rien de plus ordinaire de nos jours que le recours à la pétition comme mode d'action politique. La Constitution belge (article 28) comme la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 44) en font un droit qu'organisent notamment les...
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Culture, Histoire, Livres - Publications, Médias, Politique, Société 0 commentaire -
L'art de la miséricorde enseigné par le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine
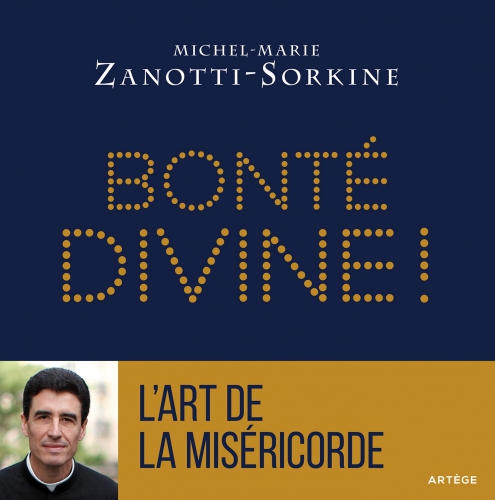 De Maëlys Delvolvé sur aleteia.org :
De Maëlys Delvolvé sur aleteia.org :La résolution du nouvel an ? Se laisser étreindre par la miséricorde divine
Avec le livre "Bonté Divine !", le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine rend hommage à la miséricorde et à ceux qui l’ont représentée.
À tous ceux qui ont pris la résolution de vivre et de se laisser étreindre par la miséricorde divine dans l’élan de l’année jubilaire achevée, Bonté Divine ! vous accompagnera bienveillamment. Dans ce nouveau livre, le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine met sa plume, pleine de finesse et de panache, au service de l’amour infini de Dieu pour chacun des hommes.
Composé de deux parties, ce bel ouvrage s’ouvre sur un magnifique texte autour de la miséricorde, « La miséricorde. Atout cœur dans le jeu de Dieu ». S’ensuit une série de tableaux, personnellement choisis et commentés par le père Zanotti, intitulée « L’Art de la miséricorde », pour aider chaque lecteur à contempler et rentrer davantage dans le mystère du Dieu d’Amour.
Vivre la miséricorde
Tout a-t-il été dit sur la miséricorde ? Le père Zanotti l’affirme lui-même d’emblée, dans son texte introductif : « […] il faut bien reconnaître qu’en cette année, le mot de miséricorde a repris ses lettres de noblesse et retentit comme jamais. Chacun y est allé de son couplet et même de ses refrains. » Mais n’est-ce pas le propre des mystères ? Plus nous cherchons à les commenter et à les comprendre, plus nous prenons conscience des limites de notre intelligence face à leur incommensurabilité ; une explication, une recherche en appelle une autre.
Pour autant, loin de chercher à nous donner une compréhension rationnelle de la miséricorde divine, l’auteur nous invite à contempler sensiblement les preuves d’amour de Dieu envers les hommes, à travers plusieurs passages de l’évangile, comme la résurrection de Lazare, la multiplication des pains, ou la parabole du fils prodigue.
Dans ce texte poétique et exalté, largement inspiré de la conférence donnée par Michel-Marie Zanotti-Sorkine en l’église Saint-Sulpice à Paris, le 4 avril 2016, ce dernier nous exhorte à reconnaître notre propre misère pour vivre la miséricorde divine envers nos frères, et aller au-delà de la justice des hommes. Il ajoute : « Si nous sommes le sel de la terre, si nous sommes la lumière du monde, nous devons vivre dans le monde tel qu’il est, et non à côté du monde. Nous ne sommes pas, nous chrétiens, des Amish, nous ne sommes pas une société dans la société […] », et affirme que la conversion de nos prochains dépend de l’amour miséricordieux que nous avons-nous-mêmes à leur offrir.
Lire la suite sur aleteia.org
Bonté divine ! L’art de la miséricorde, Michel-Marie Zanotti-Sorkine, Éditions Artège, 150 pages, 17,90 euros.
-
Dieu agit dans le monde où nous vivons, il n’y a aucune raison d’avoir peur
Lu sur le site de France Catholique :
Dom Samuel Lauras, soudainement converti après quelques années tumultueuses, entré au monastère en 1983, fut novice de Père Nicolas, étudiant de Père Jérôme, prieur de Dom Patrick, abbé de Sept-Fons. Aujourd’hui abbé trappiste de Nový Dvur en République tchèque, il a publié « Qui cherchait Théophane ? » (Parole et Silence, 1992, réédité 2009) et « De tout cœur : Réflexions d’un moine sur l’avenir chrétien de notre monde » (Ad Solem, 2011) qui l’a fait connaître. Un ton nouveau, entre lucidité, courage et espérance. Un esprit qui puise dans les trésors reçus les raisons de l’affirmation chrétienne et monastique.
Aujourd’hui, Dom Samuel récidive avec « Comme un feu dévorant. Propos d’un moine sur l’exercice de la miséricorde » (Artège), un livre dont le sous-titre dit l’actualité mais qui va bien au-delà. Pour « France Catholique », Dom Samuel prolonge dans un entretien exclusif les chapitres de son ouvrage. Une invitation à le lire.

Nový Dvur est bien loin de la France et de l’Église catholique en France. Que savez-vous des sujets brûlants qui la concernent et dont vous traitez (scandale de prêtres pédophiles, dévaluation de la morale chrétienne, questions sur la vocation monastique et sa pérennité aujourd’hui, crise de la transmission, etc.) ? Que répondriez-vous à un grincheux qui vous dirait : « Mais enfin, de quoi se mêle-t-il, ce moine qui habite si loin de ce dont il parle ? »
Dom Samuel : Les pays d’Europe sont-ils si loin que ça de la France ? La France ne serait-elle pas capable d’entendre une voix qui parle hors de ses frontières, d’une partie de l’Europe, c’est vrai, qui ne raisonne pas toujours de la même manière que la majorité de ses intellectuels, mais qui a peut-être quelque chose d’important à lui dire ? L’Europe serait-elle un courant à sens unique, qui se déverse nécessairement de l’Occident vers l’Orient, pour que les modes de vie occidentaux, considérés comme les seuls admissibles, se répandent partout ?
Comme un feu dévorant est le fruit d’un combat personnel, d’un événement éprouvant dans la vie de l’Église qui m’a touché de très près. Je ne voulais pas me laisser submerger, il me fallait donc prier ; pour prier, garder une foi vivante ; pour croire, écrire afin de voir distinctement ce que Dieu attendait de moi. Ce processus a duré quatre ou cinq ans. Ensuite, j’ai décidé de publier. Pourquoi ? Ce fut comme une décision fraternelle. Je ne suis pas le seul à être affronté, dans sa foi, à de telles situations, presque incompréhensibles. Nous devons nous rapprocher les uns des autres, taire les querelles qui nous affaiblissent (pas les débats, bien sûr !).
Lire la suite sur le site de France Catholique
-
Deux visions et un débat au sujet des catholiques et de la "tentation identitaire"
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Livres - Publications, Politique, Religions 0 commentaire -
"Identitaire" ou quand Koz dénonce le mauvais génie du christianisme
De "Koz" (Erwan Le Morhedec), sur son blog :
Identitaire, le mauvais génie du christianisme
Pourquoi ? Puisque aussi bien, ils ne s'en prennent pas à moi, à nous. Pourquoi, alors qu'ils vont jusqu'à affirmer défendre la foi catholique, défendre nos crèches, nos villages, nos églises ? Pourquoi, alors que, moi aussi, l'immigration et l'islam m'interpellent, et très brutalement quand s'y mêlent les derniers massacres ? Pourquoi, alors que je ne sais pas si l’Église que je connais et la France dont je suis issu, de mes quatre lignées occidentales, existeront encore demain ? Pourquoi donc, alors que certains clament qu'ils défendent mon identité ethnique jusque dans leurs choix du quotidien ? Je suis chrétien, blanc et Français de longue génération. Pourquoi alors ne pas me laisser représenter et défendre par les Identitaires ? Pourquoi ne pas, moi aussi, ce serait plus simple, assurer cette défense des miens ?
Pourquoi écrire ce livre ?
Parce que je ne marche pas. Parce que ma foi, précisément, m'enseigne que si j'ai des proches, les miens ne sont pas d'une race ou d'une ethnie. Parce que le pape n'est pas le "défenseur de la chrétienté". Parce que les crèches ne sont pas des étendards que l'on plante pour marquer un territoire, mais le tableau de la Nativité. Parce que ma foi n'apprécie guère d'être soumise à la politique et qu'elle ne supporte pas d'être asservie par ceux qui n'en brandissent que des symboles, en abandonnant le sens. Parce qu'il est impensable que le christianisme soit un outil d'exclusion. Parce que je n'ai pas, quand l'occasion se présentait, entrepris de défendre comme je pouvais à la fois l’Église et le christianisme contre les attaques extérieures pour les laisser flétrir de l'intérieur, par effraction.
Un jour prochain nous aurons peut-être à rappeler que le christianisme est une religion de paix, qu'il ne faut pas faire d'amalgame, que la violence n'a rien à voir avec le christianisme. C'est à nous de le dire, maintenant et de l'intérieur, avant que cela ne nous saute au visage.
Sont à l’œuvre aujourd'hui en France des groupes politiques divers qui imaginent concilier le christianisme avec la violence, le Christ avec les dieux païens, la foi catholique avec le racisme le plus évident. La question n'est pas seulement politique, elle est culturelle et spirituelle. Les groupes politiques revendiqués comme identitaires ((que ce soit Les Identitaires (ex Bloc Identitaire), Génération Identitaire ou la myriade de groupuscules régionaux, régionalistes ou "localistes")) sont finalement peu nombreux, mais ils sont bruyants. L'impact culturel est en revanche profond, recherché avec d'autant plus de zèle sur les divers réseaux d'influence - spécialement numériques - que l'on sait que la bataille idéologique se gagne d'abord par la culture et le vocabulaire. Il n'y a pas jusqu'au vocable d'«identité" qui ne soit piégé, conduisant chacun à se justifier de ce qui serait chez lui tout à la fois différent, unique, essentiel et intangible.
J'ai voulu examiner aussi à ce titre les raisons de notre sensibilité particulière - nous, catholiques français - à cette question de l'identité. Car il ne s'agit pas de la rejeter : ce serait me renier moi-même. Ceux qui me connaissent et ceux qui me lisent savent mon attachement à ma foi, à mon pays, à sa culture, à ses paysages, à ses clochers.
Mais si notre inquiétude est vraiment celle de trouver notre place dans une société qui semble se dérober sous nos pieds, si notre angoisse est véritablement celle de l'avenir du catholicisme en France, alors je crois qu'il nous faut dépasser le réflexe simpliste de défense et d'affirmation identitaires pour chercher le sens et l'apport que peut avoir la présence catholique dans la société française.
C'est une nécessité pragmatique et stratégique, mais c'est également une démarche spirituelle. En écrivant ce livre, je me suis aperçu que, du livre de Jérémie à la Passion du Christ, c'est comme si Dieu nous demandait avec insistance de savoir nous détacher de la pierre pour nous attacher à la parole vivante. Peut-être pouvons-nous trouver dans cette démarche le viatique qui nous donnera la force de traverser avec confiance une période troublée et troublante.
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Livres - Publications, Politique, Société 0 commentaire