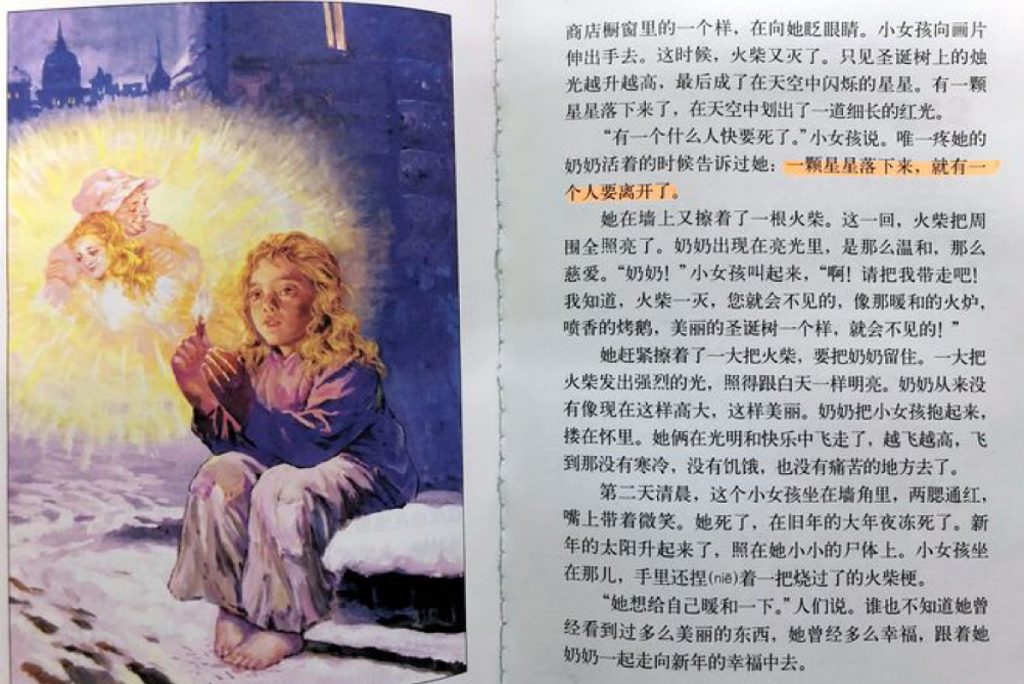Du site de la CNA (Catholic News Agency) :
Mgr Doyle déclare que la cause de la sainteté de Chesterton n’avancera pas
Denver, Colorado, 2 août 2019 (CNA)
La cause en faveur de la canonisation de l'auteur catholique fumeur de pipe, disert, moustachu et apprécié, Gilbert Keith (GK) Chesterton, ne sera pas ouverte : c'est ce qu'a annoncé Mgr Peter Doyle, évêque de Northampton, le diocèse du défunt Chesterton.
Malgré les écrits inspirants de Chesterton et son rôle dans le renouveau catholique en Angleterre au début du XXe siècle, plusieurs obstacles empêchent de faire avancer la cause de la canonisation de l'auteur, a déclaré Doyle dans une lettre lue à la séance d'ouverture de la conférence américaine GK Chesterton Society. .
Les trois préoccupations citées par Doyle sont que Chesterton ne fait pas l'objet d'un «culte» de dévotion locale, l’absence de «modèle de spiritualité personnelle» qui puisse être discerné à travers ses écrits et des charges d’antisémitisme dans ses écrits.
"Je suis très conscient de la dévotion envers GK Chesterton dans de nombreuses régions du monde et de son influence inspirante sur tant de gens, ce qui rend difficile la communication de la conclusion à laquelle je suis arrivé", a déclaré l'évêque, selon le Catholic Herald au Royaume-Uni.
Chesterton est né en 1874 et est devenu un écrivain prolifique et un apologiste catholique convaincu après sa conversion à la foi. Il est réputé pour avoir écrit des classiques apologétiques tels que «Orthodoxie» et «L'Homme éternel», ainsi que pour sa série fictive du «Père Brown», parmi de nombreux autres ouvrages. Il est mort en 1936.
Doyle a loué "la bonté de Chesterton et sa capacité d'évangélisation" mais a déclaré qu'il ne pouvait pas ouvrir la cause pour le moment.
«… Je ne peux pas promouvoir la cause de GK Chesterton pour trois raisons. Premièrement et surtout, il n’ya pas de culte local. Deuxièmement, je suis incapable de démêler un modèle de spiritualité personnelle. Et troisièmement, même en tenant compte du contexte de l'époque de K. K Chesterton, la question de l'antisémitisme constitue un réel obstacle, particulièrement en ce moment au Royaume-Uni », a-t-il déclaré dans la lettre.
Dans une interview avec Alfa y Omega, un hebdomadaire catholique espagnol, Doyle a déclaré que même si Chesterton était farouchement opposé aux nazis, il avait stéréotypé le peuple juif dans certains de ses écrits.
À titre d’exemple, Alfa y Omega a noté que, dans The New Jerusalem, un livre écrit en 1920 par Chesterton, il affirmait que le peuple juif avait besoin d’une nation distincte pour «vivre, autant que possible, dans une société juive dirigée par les Juifs ». Il a également préconisé que les Juifs portent des vêtements distinctifs en public pour les distinguer.
La Société de Gilbert Keith Chesterton soutient que l'accusation d'antisémitisme contre Chesterton est fausse, car l'auteur déclarait : «Le monde doit Dieu aux Juifs» et «Je mourrai en défendant le dernier Juif d'Europe».
Chesterton était «un homme qui détestait le racisme et les théories raciales et qui s'est battu pour la dignité humaine et a toujours affirmé la fraternité de tous les hommes», déclare la société sur son site internet.
Fr. John Udris, qui a enquêté pour la cause de Chesterton, a déclaré au Catholic Herald qu’il «n'enviait pas l’évêque Peter Doyle contraint de prendre une telle décision avec d’énormes implications."
«Bien sûr que c’est une déception. Mais l'enquête était un énorme privilège. Mieux connaître Chesterton m'a certainement changé pour le meilleur », a-t-il ajouté.
Fr. Benedict Kiely, un prêtre qui prétend que l’intercession de Chesterton a aidé à guérir sa mère de septicémie, a déclaré que la décision montre que la hiérarchie catholique anglaise baigne dans un «brouillard de médiocrité», une phrase initialement appliquée au groupe par l’auteur anglais Hilaire Belloc.
«La décision de l’évêque actuel de Northampton de ne pas poursuivre la cause de G.K. La canonisation de Chesterton indique que le brouillard ne s'est pas encore dissipé », a déclaré Kiely au Catholic Herald.
Selon son entretien avec Alfa y Omega, Doyle a déclaré qu'il était possible que son successeur rouvre la cause. Doyle a 75 ans et a présenté sa démission pour examen au pape François, étant donné qu'il est l'âge de la retraite habituel pour un évêque.
"Et je ne voudrais pas être un obstacle à cela, au-delà des conclusions que j'ai tirées", a-t-il déclaré.

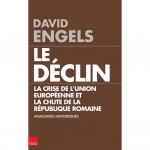 Dans un cycle de conférences organisé en 2017 à l’ULg par le Groupe de réflexion Ethique sociale et l’Union des étudiants catholiques de Liège sur le thème « L’Europe, ses fondements, aujourd’hui et demain », David Engels avait déjà présenté au public réuni dans la salle des professeurs de l’ "Alma Mater" liégeoise un premier livre, intitulé « Le Déclin », pour mettre en lumière des analogies historiques entre la crise de l’Union européenne et la chute de la république romaine à la fin du 1er siècle avant J.C.
Dans un cycle de conférences organisé en 2017 à l’ULg par le Groupe de réflexion Ethique sociale et l’Union des étudiants catholiques de Liège sur le thème « L’Europe, ses fondements, aujourd’hui et demain », David Engels avait déjà présenté au public réuni dans la salle des professeurs de l’ "Alma Mater" liégeoise un premier livre, intitulé « Le Déclin », pour mettre en lumière des analogies historiques entre la crise de l’Union européenne et la chute de la république romaine à la fin du 1er siècle avant J.C. 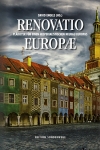 l’U.L.B., avant d’être appelé à l’Institut Zachodni de Poznan, en tant que professeur chargé de recherche pour l’analyse de l’histoire intellectuelle de l’Occident.
l’U.L.B., avant d’être appelé à l’Institut Zachodni de Poznan, en tant que professeur chargé de recherche pour l’analyse de l’histoire intellectuelle de l’Occident. 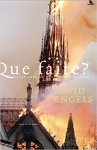 l’avenir et, surtout, léguer notre héritage en danger à nos descendants…
l’avenir et, surtout, léguer notre héritage en danger à nos descendants…