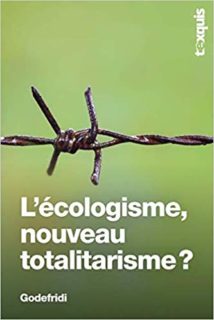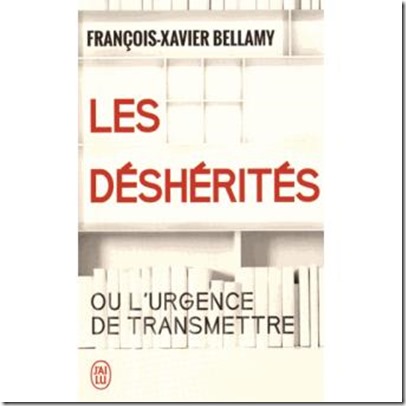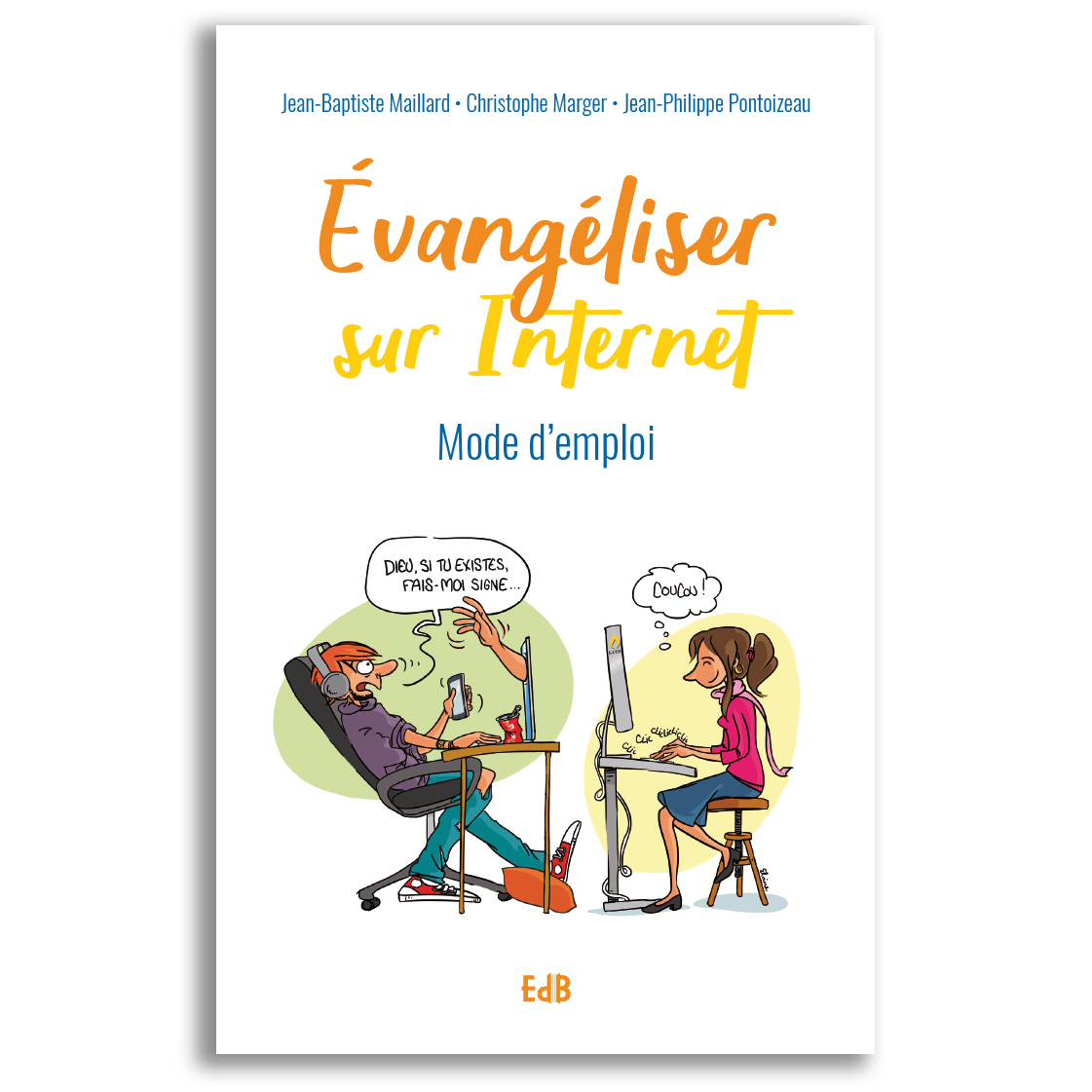El Andalous — Les adeptes du mythe du vivre-ensemble ont quelque souci à se faire
via le site "Pour une école libre au Québec" :
Les Chrétiens dans al-Andalus, de la soumission à l’anéantissement : voilà un titre qui ne laisse guère d’alternative au lecteur. Son auteur, Rafael Sánchez Saus, est une sommité du monde universitaire espagnol. Médiéviste, il est aussi historien des idées.
Après avoir lu son essai, on se dit que les défenseurs du mythe ont quelque souci à se faire. Déjà, en 2004, un autre historien espagnol, Serafin Fanjul, avait taillé en pièces la légende dans un essai qui avait provoqué de sérieux remous, Al-Andalus, l’invention d’un mythe. La réalité historique de l’Espagne des trois cultures(Toucan, 2017).
Mais ici il s’agit d’autre chose. Autant Serafin Fanjul polémiquait avec les publicistes qui ont entretenu le mythe d’el-Andalous, autant Rafael Sanchez Saus s’en abstient. Son livre ne s’attache qu’à l’étude des faits tels que les différentes sources historiques, arabes et latines, permettent de les envisager. Ce n’est pas le livre d’un militant mais d’un scientifique qui tente de résoudre l’énigme qu’a représentée le surgissement soudain de l’islam dans un monde hispanique encore dominé au début du VIIIe siècle par une dynastie wisigothe chrétienne qui s’est écroulée sous l’assaut fulgurant des troupes berbères et arabes venues d’Afrique du Nord.
L’auteur se penche aussi sur la quasi-disparition de la chrétienté en Afrique du Nord et sur la conversion des Berbères à l’islam. S’il ne polémique pas, c’est qu’à ses yeux il n’existe plus un seul historien sérieux qui défende la vision idyllique d’une civilisation où juifs, chrétiens et musulmans auraient devisé aimablement à l’ombre de la mosquée de Cordoue.
Il ne fait aucun doute à ses yeux que l’instauration du régime islamique qui s’est épanoui sous le règne du calife omeyyade Abdel Rahmane a été d’une extrême brutalité.L’auteur insiste sur la décadence d’un monde wisigoth qui n’a pas résisté au choc de l’agression arabe. Il rappelle que les juifs, eux-mêmes opprimés par les chrétiens, ne s’opposèrent pas à l’invasion. Toute une partie de la société chrétienne, notamment les mozarabes, chrétiens culturellement arabisés, coopérèrent avec les nouveaux maîtres qui leur laissèrent au début des formes d’autonomie. Mais, peu à peu, notamment sous l’influence de l’islam malékite, extrêmement rigoriste, les marges de liberté de la société chrétienne se réduisirent comme peau de chagrin.
Tracasseries et persécutions
Connaisseur de l’islam et de ses diverses écoles, Rafael Sanchez Saus énumère toutes les prescriptions que devaient respecter les dhimmis, depuis l’interdiction de monter à cheval à celle de porter une barbe ou de posséder des armes. Sans oublier les impôts que les infidèles payaient pour avoir le droit de vivre en terre d’islam. L’historien ne nie nullement la somptuosité de l’islam andalou. [Rappelons que l'Hispanie romaine, puis wisigothe était très riche...] L’extrême cruauté et le raffinement ne sont pas incompatibles, on le sait. Mais il rappelle le prix très lourd, depuis les tracasseries jusqu’aux persécutions, qu’ont dû payer les autochtones. «Il ne s’agit pas de nier les réussites de l’islam d’al-Andalus (…) mais de lutter contre la tendance si marquée aujourd’hui à l’idéalisation d’al-Andalus par exécration de l’Espagne chrétienne », conclut l’auteur.
Une idéalisation de l’autre qui est parfois l’autre nom de la haine de soi.
Les chrétiens dans al-Andalus:
De la soumission à l'anéantissement Broché
de Rafael Sánchez Saus
publié le 20 février 2019
aux Éditions du Rocher
à Monaco
528 pages
ISBN-10: 2268101282
ISBN-13: 978-2268101286

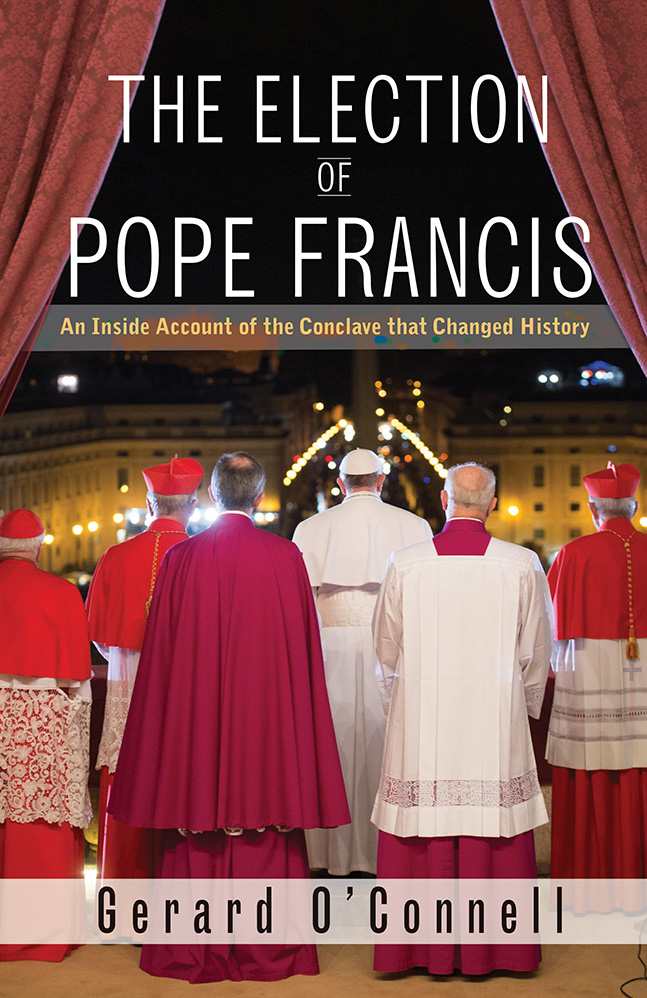


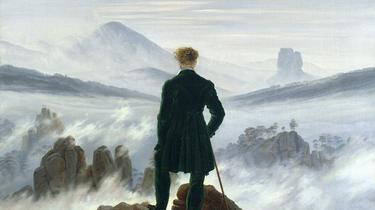


.png)