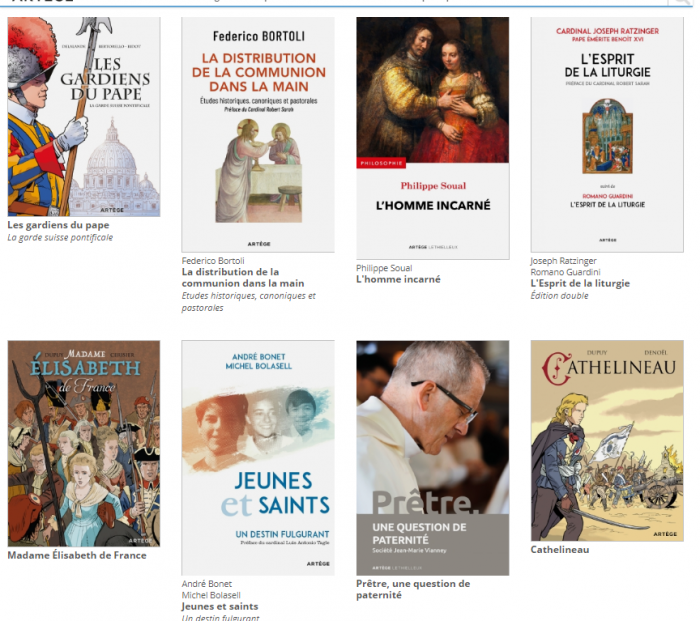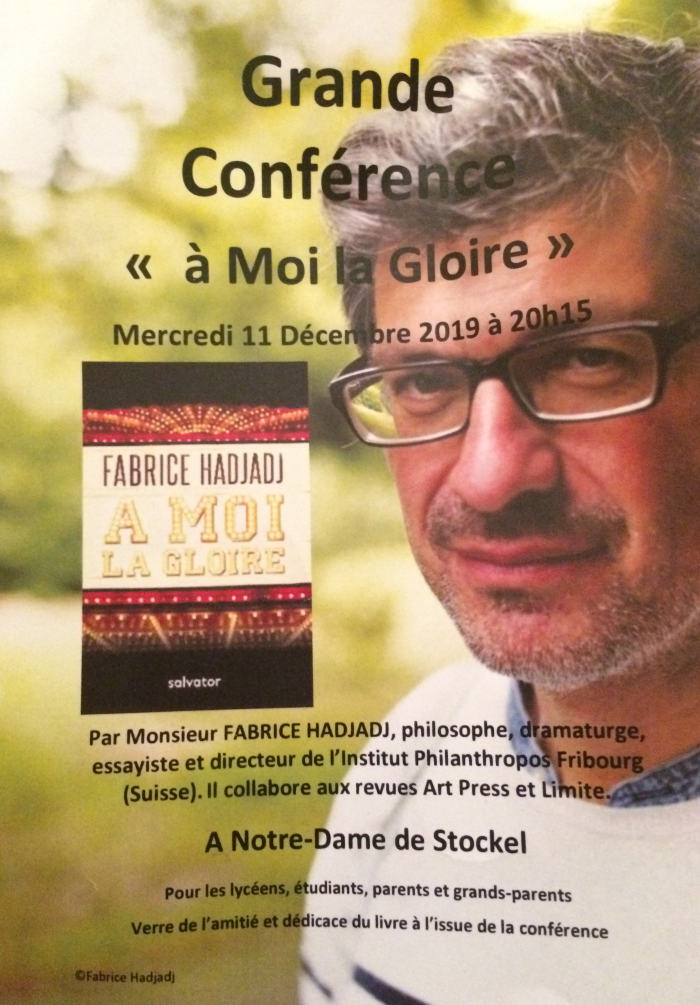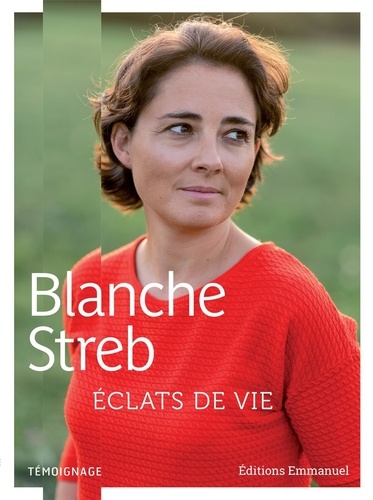Du Père Will Conquer, propos recueillis par Odon de Cacqueray, sur le site de l'Homme Nouveau :
Carlo Acutis, un nouveau modèle pour les jeunes ?
14 novembre 2019

Le père Will Conquer est un prêtre des missions étrangères. En terminant ses études en Italie, il s’attelle à l’écriture d’une biographie de Carlo Autis, un jeune italien, mort en 2006, à 15 ans, après avoir terminé le grand projet de sa vie, une exposition sur les miracles eucharistiques. À travers son livre, le père Conquer veut proposer un nouveau modèle de jeunesse. L'année dernière, le pape François a déclaré Carlo Acutis vénérable.
Père Will Conquer, lors de la présentation de votre livre : Un geek au paradis, une biographie de Calo Acutis, vous avez déclaré : « tout a commencé sur un coin de table de l’autre côté du monde ». Quelle est la genèse de votre ouvrage ?
C’est Pierre Chausse et Grégory Turpin, au cours d’une conversation où je leur annonçai mon départ en mission, qui m’ont incité à mettre mon temps à profit et laisser quelque chose à la France qui m’a tant donné. J’habitai alors en Italie, ils m’ont dit Le pape parlait d’un jeune italien, très peu connu en France : Carlo Acutis.
En France c’était encore le grand inconnu, on connaît Claire de Castelbajac, on connaît beaucoup d’histoires touchantes, des modèles de jeunesse qui inspirent, mais pas Carlo Acutis. Il fallait donc faire une enquête sur ce jeune et l’idée me plaisait puisque je me reconnaissais des traits commun avec ce jeune, le côté un peu « geek », l’attrait pour les nouvelles technologies…
J’ai pris rendez-vous avec le postulateur et la mère de Carlo, l’enquête commençait. Je me suis attelé à la lecture des différents livres écrits sur Carlo, parfois difficilement recevables en France à cause du côté très pieux plus spécifique aux italiens qu’aux français, cet élan religieux propre aux méditerranéens. J’ai essayé de montrer en quoi Carlo pouvait être un modèle. En m’intéressant à lui, en m’intéresant à ce qu’il a fait, à ce que ses amis sont devenus, je me suis rendu compte que c’était véritablement un jeune de notre génération. Tous ses amis sont sur Instagram aujourd’hui, ses parents sont sur Whatsapp, il existe des groupes Facebook à son nom.
Carlo Acutis, c’est une jeune de 15 ans né avec internet, quel est son contexte familial ? Est-il baigné dans un univers très religieux ? D’où lui vient sa piété ?
Carlo ressemble aux jeunes de notre temps avec aussi ce qu’il peut y avoir de plus triste. Il grandit dans un environnement où la religion est plus une culture, où les enfants font leur première communion « comme tout le monde », mais lui il va demander à faire sa première communion plus jeune. À partir du moment où il a reçu le corps du Christ, Carlo va demander à faire ce que ses parents n’avaient jamais fait : aller à la messe tous les jours.
Carlo grandit dans une classe extrêmement élevée, ses parents font partie de la haute société milanaise. Il est fils unique comme beaucoup d’enfants de notre époque, il avait tout pour être l’enfant-roi, matérialiste. Pourtant, dans une ville anonyme comme l’est Milan, Carlo va tisser des liens personnels avec des gardiens d’immeubles, les passants qu’il croise sur le chemin de l’école, des employés de ses parents… grâce à ces liens d’amitiés un des employés, Rajesh, va demander le baptême. C’est là le coeur missionnaire de Carlo, son témoignage de foi il le fait d’abord chez lui.
Cet aspect missionnaire comment nait-il ?
Aux rencontres de Communion et Libération, Carlo est présent avec ses parents et prend conscience de l’urgence de trouver les mots pour parler aux jeunes aujourd’hui. Il va avoir l’idée de créer une exposition à destination des jeunes, afin de leur parler de l’eucharistie. Son approche est très intéressante, il veut parler de l’eucharistie en partant des miracles eucharistiques, ce n’était alors pas du tout à la mode.
Combien de jeunes aujourd’hui savent que la fête Dieu est née d’un miracle ? Carlo Acutis va utiliser internet pour monter son exposition. Ce chef d’œuvre de sa vie va lui prendre deux ans, en passant toujours après son devoir d’état : faire ses devoirs d’école, etc.
Quatre jours avant l’inauguration il ressent des troubles, des malaises, des vomissements. Il est conduit à l’hôpital, les médecins pensent d’abord à de la fatigue liée au stress et à la préparation de l’exposition. Les analyses de sang vont révéler une leucémie. En quatre jours la maladie va avoir raison de lui. Son exposition va, malgré son absence, avoir un succès incroyable.
J’ai eu la chance de la voir dans une université pontificale en 2006. Cette exposition a voyagé dans tous les continents, et Carlo qui est parti très jeune vers le Père, continue de porter du fruit par ce biais aujourd’hui.
Un saint c’est un modèle, Carlo Acutis a utilisé les nouvelles technologies très jeune. Peut-on proposer comme modèle un jeune qui passait une bonne partie de son temps sur les écrans ? N’est-ce pas un risque pour les parents qui restreignent leurs enfants sur le sujet ?
Rabelais nous a dit « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Carlo nous montre que l’usage des technologies modernes de façon consciencieuse peut porter de bons fruits. Ce rapport à la technologie résultait d’une pédagogie de ses parents. Quand il était enfant, ils n’autorisaient qu’une heure par semaine de jeux vidéos. Quand il sera adolescent, ce sera deux heures. C’est un usage raisonné, il y a un lieu, une durée limité. En ce sens c’est un modèle pour les parents.
Carlo joue avec ses amis, l’aspect social est important. Beaucoup de technologies qui se prétendent sociales aujourd’hui, sont anti-sociales.
Il a un usage missionnaire des nouvelles technologies. Il pose une question à laquelle nous devons tous répondre. Est-ce que les nouvelles technologies me rapprochent de Dieu ? Quel en est mon usage ?
Il y a une confiance réciproque entre Carlo et sa mère concernant l’usage de l’ordinateur. Carlo n’avait d’ailleurs pas de code. Combien de personnes n’osent pas donner leurs codes par peur de ce qui se trouve dans leurs portables ? L’historique complet de tout ce qu’a fait Carlo sur internet a permis de constater l’absence de recherches déplacées.
Comment avez-vous voulu construire le livre ?
J’ai voulu construire le livre comme un parcours pour grandir en sainteté, à partir des vertus chrétiennes. Aujourd’hui, au catéchisme on parle beaucoup du témoignage et de la rencontre avec Jésus et c’est en effet très important, mais il doit également y avoir une éducation aux vertus chrétiennes. On connait souvent les 7 péchés capitaux, connaît-on aussi bien les 7 vertus ? Dans les vertus chrétiennes il y a cette rencontre extraordinaire entre les vertus cardinales, justice tempérance, force et prudence qui sont comme les quatre murs d’une maisons, couronnés par les trois vertus théologales, foi, espérance et charité, qui viennent comme la coupole d’une église sur ces murs.
Carlo n’est pas saint parce qu’il fait des miracles, il a d’abord été reconnu vénérable par un décret qui a reconnu ses vertus héroïques. Carlo nous montre l’exemple l’exemple des vertus héroïques dans notre époque. Face à la décadence de notre société, aux idéologies mortifères, il faut éduquer nos enfants à l’héroïsme du troisième millénaire.
Un geek au paradis, une biographie de Calo Acutis, père Will Conquer, aux éditions Première Partie, 224 p., 16 €.