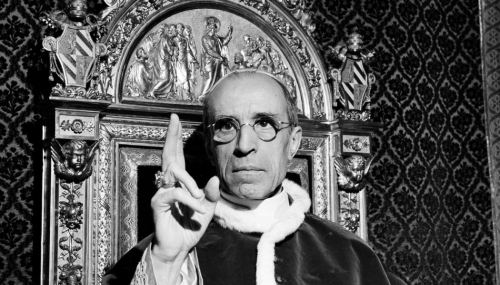Lu dans la Libre de ce jour (6 février), p. 38 :
La souffrance psychique gagnerait-elle à être mieux définie dans le cadre de l'euthanasie ?
Le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), a plaidé pour une évaluation de la législation sur l’euthanasie, et en particulier pour examiner la notion de “souffrance psychique insupportable” qui permet de légitimer une euthanasie dans certains cas, mais qui manquerait de précision et laisserait une trop large place à l’interprétation.
Oui pour Éric Vermeer, infirmier éthicien en soins palliatifs
Nous devons redéfinir la loi alors que nous assistons à une banalisation de l’euthanasie. Il faut enlever la notion de souffrance psychique qui permet l’euthanasie dans certains cas, car il est impossible d’établir l’incurabilité d’une telle souffrance.
Vous avez participé à la rédaction d’un ouvrage publié aux éditions Mols et intitulé "Euthanasie, l’envers du décor". Quel serait cet envers du décor ?
Depuis sa dépénalisation sous certaines conditions en 2002, j’ai le sentiment qu’on a banalisé l’euthanasie et qu’on essaye désormais, à coups de pathos, de nous imposer l’idée que, pour mourir dignement, il faut se faire euthanasier. Je suis par ailleurs impressionné par la manière dont les propositions d’élargissement de la loi se font. Dernièrement, il y a eu cette proposition de pouvoir euthanasier les personnes qui sont fatiguées de vivre. Nous entrons dans une logique qui me semble de plus en plus mortifère. Ce livre souhaitait montrer que derrière cette normalisation de l’euthanasie, sa pratique reste très douloureuse et difficile pour beaucoup de médecins et d’infirmiers sur le terrain. Nous voulions montrer que l’euthanasie n’est jamais vécue comme un acte anodin.
Faut-il mieux définir dans la loi la définition de la souffrance psychique constante, insupportable et inapaisable qui peut légitimer une euthanasie ?
Un tel travail de redéfinition me semble essentiel. Nous sommes des centaines d’éthiciens, de soignants et de psychologues à dire qu’il est impossible de valider l’incurabilité d’une souffrance psychique. Car qu’est-ce qui fait la spécificité de la dépression ? C’est l’absence de perspective, l’impression que l’on ne va pas s’en sortir. Mais il y a tant de témoignages de personnes qui, dans une situation de dépression, ont demandé l’euthanasie avant de se rétracter car ils avaient retrouvé de l’espoir suite à une rencontre par exemple. Il est impossible de dire devant une souffrance psychique qu’elle est absolument incurable. Et le grand risque, à terme, est qu’en infiltrant la possibilité de l’euthanasie dans la psychiatrie, on fasse imploser le sens profond de la psychiatrie.
Pourquoi ?
La société demande aux psychiatres de remettre debout des gens qui ont une perte d’élan vital. Si on euthanasie des gens qui ont comme symptôme une telle perte d’élan vital, on aboutit à une réponse qui n’est pas celle que la société demande à la psychiatrie. Je le répète : il est illusoire et impossible de valider l’incurabilité d’une souffrance psychique, et la plupart des demandes d’euthanasie sont en réalité un appel à une meilleure qualité de vie à laquelle la médecine et la société peuvent et doivent répondre.