De Chantal Delsol sur le Figaro Vox via Magistro
FIGAROVOX/TRIBUNE - Les droits de l’homme ne sont plus universels et immuables mais catégoriels et sans cesse croissants. Aussi est-il légitime de leur poser des bornes, argumente le professeur de philosophie politique*.
Aux États-Unis, une "commission des droits inaliénables" a été récemment mise en place par le secrétaire d’État, Mike Pompeo. Son objet est de réfléchir sur ce que sont devenus les droits de l’homme depuis leur affirmation solennelle en 1948 dans la déclaration universelle des droits de l’homme. La présidente de la commission, Mary Ann Glendon, professeur de droit à Harvard, a affirmé que la commission travaillerait "au plan des principes, pas de la politique". Les membres de la commission sont inquiets de voir les droits, catégorie sacrée au sens culturel du terme, se développer anarchiquement. Les opposants à la création de cette commission, eux, sont inquiets en pensant, non sans raison, qu’on pourrait conclure à la relativisation de certains droits.
Alors que la modernité nourrissait des idéologies censées susciter des sociétés parfaites, la post-modernité ne se voue qu’au développement de la liberté individuelle sur tous les plans. Les droits sont inflationnistes, parce que l’envie individuelle a tendance à susciter chaque fois un nouveau droit. Sauf l’impossibilité technique, il n’y a pas de limitation à mes désirs. Même la fameuse liberté qui "s’arrête là où commence celle de l’autre" est entamée : face à l’être faible qu’est l’enfant, c’est ma volonté d’adulte qui seule compte - j’ai le "droit" de produire un enfant sans père parce que j’en ai envie, j’ai "droit" à un enfant si je veux. Et tous ces nouveaux droits réclament aussitôt leur inaliénabilité. On met en avant la souffrance des demandeurs pour justifier la légitimité de leurs souhaits.
Les choses vont si loin que Muriel Fabre-Magnan, s’appuyant sur des textes européens, se demande si le sadomasochisme doit être considéré comme un droit de l’homme, après avoir vu la Cour européenne des droits de l’homme établir lors d’un procès pour sadomasochisme, le droit de l’autonomie personnelle à "s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne". La "commission des droits inaliénables" veut pointer du doigt cet engrenage déraisonnable.
L’inflation des droits a été patente depuis la Seconde Guerre. On pourrait parler des droits dits de seconde et de troisième génération, dont la signification a changé par rapport aux affirmations premières. Mais surtout, et depuis peu, l’universalité a été mise à mal pour laisser place aux droits des groupes, parfois des groupuscules. Pour la Déclaration originelle de 1948, il n’y a ni des Iroquois ni des Français, il n’y a que des humains, et c’est cela qui fait la grandeur de la Déclaration. C’est cela d’ailleurs qui suscitait la moquerie des contempteurs des droits de l’homme : je ne connais pas l’Homme, je ne connais que des Français et des Anglais, disait Joseph de Maistre. Or, aujourd’hui, les droits universels des humains quels qu’ils soient, c’est-à-dire hors leurs appartenances sociales et autres, s’éclipsent pour laisser place aux droits des groupes comportementaux ou identitaires. Il y a les droits des femmes. Les droits des homosexuels. Les droits des "LGBTQI", etc. Ils renvoient à des possibilités légales d’adopter certains comportements, qui revendiquent à grand bruit d’être aussitôt traduits en droits inaliénables, suscitant un nuage de droits concernant tous les domaines de la vie, et figeant (c’est bien le but) ces comportements dans le marbre comme s’il s’agissait de dogmes théologiques.
Les droits de l’homme originels, ceux énoncés au départ par les Déclarations, équivalent pour nous à des dogmes théologiques, et ils sont gravés dans le marbre ("tout homme a droit à la liberté de penser"), même s’ils ne sont pas toujours respectés. C’est leur généralité, leur universalité, leur côté lapidaire et parfois laconique, qui garantit leur insigne valeur. Mais tous ces droits dérivés et particuliers qui fleurissent chaque jour doivent être discutés, et non pas imposés par quelques groupuscules : c’est ce que signifie cette commission.
Lorsqu’on a le sentiment d’avoir laissé des principes enfler indûment, de s’être peut-être fourvoyé avec le temps qui passe, on revient alors aux fondements : aux pères fondateurs dont on a pu s’éloigner sans penser aux conséquences. On refonde ce qui a été altéré en revenant aux sources, comme l’avait bien montré Machiavel à propos des républiques. C’est pourquoi la commission parle d’en venir à distinguer des droits humains inaliénables et des "droits ad hoc". Il est clair qu’il est question d’enlever à certains droits leur inaliénabilité. Et l’on comprend l’inquiétude des opposants.
Car il s’agit, essentiellement, de répondre à la pression du courant progressiste qui veut imposer le caractère inaliénable de bien des nouvelles revendications, revendiquées sous peine de manquement à la modernité toute-puissante. Certains pays (la France, l’Allemagne) considèrent que le mariage entre deux personnes de même sexe est un droit de l’homme. Mais d’autres pays, comme la Hongrie ou la Pologne, contestent rigoureusement ce droit. Et ils sont injuriés et traités d’analphabètes. Or ces différences devraient entraîner non des insultes, mais la reconnaissance de spécificités légitimes, et c’est pourquoi la commission parle de "droits ad hoc". Autrement dit, on pourrait considérer que ces divergences ne sont pas une question de retard provincial ou d’idiotie congénitale, mais de point de vue et de conviction. On peut avoir des raisons de penser que l’IVG n’est pas un droit, mais une tolérance devant des cas graves, un respect de la décision individuelle en situation tragique. C’était d’ailleurs la pensée et le propos de Simone Veil, qui a été rapidement détournée par l’effet de cette enflure, justement.
La dénomination de droits ad hoc permettrait aux différents pays ou régions, comme les États américains, de définir leurs visions des droits au-delà des droits fondamentaux définis par les Déclarations. Ce serait un gage de la pluralité des opinions. Le problème étant que le courant dominant n’accepte pas du tout des challengers et ostracise tout ce qui diffère de lui.
La pensée conservatrice se saisit ici des droits de l’homme en posant une question qu’elle juge essentielle : les droits de l’homme n’ont-ils pas des limites ? Ils en ont bien au regard de notre responsabilité face à l’environnement. Et, certainement, ils sont limités par notre responsabilité à l’égard des humains, qui ont aussi leurs exigences. La position de ces limites est chaque fois discutable, et exige par conséquent des débats entre les différentes visions du monde. Significativement, les opposants de la commission s’indignent qu’on veuille poser des limites, qui vont "discriminer" - c’est-à-dire récuser des souhaits. Ils légitiment l’inflation des droits. Les conservateurs, au contraire, pensent que les droits humains ne dépendent pas de nos désirs, qui sont en effet exponentiels, mais d’exigences humaines plus profondes et plus complexes. Refuser d’en débattre, c’est donner la prime aux émotions, qui dans ce genre d’affaires ne sont jamais bonnes conseillères.
* De l’Institut. "La Démocratie dans l’adversité et les démocraties illibérales", enquête internationale codirigée par Chantal Delsol et Giulio De Ligio, vient de paraître aux Éditions du Cerf.
Avec l'autorisation de l'auteur - Paru dans Le Figaro, 13 septembre 2019


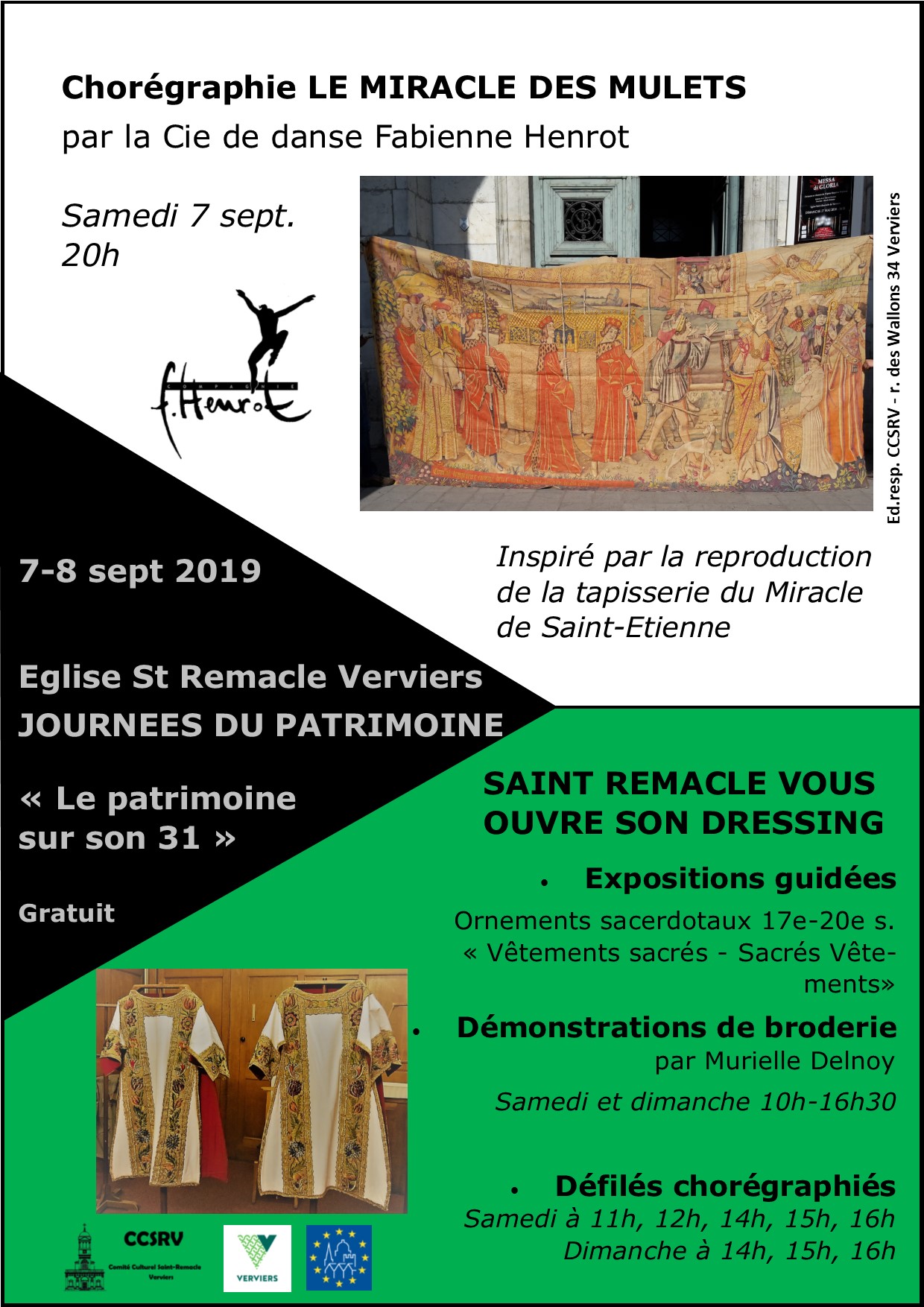
.png)