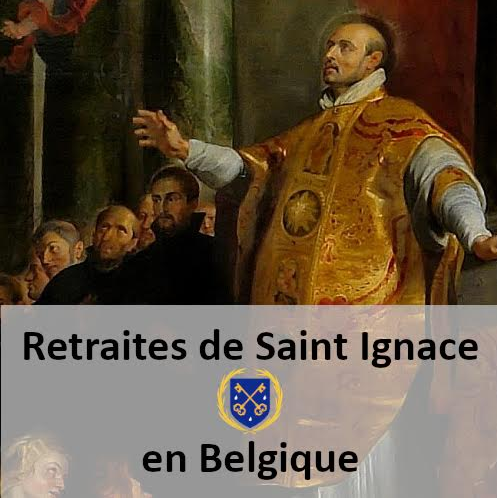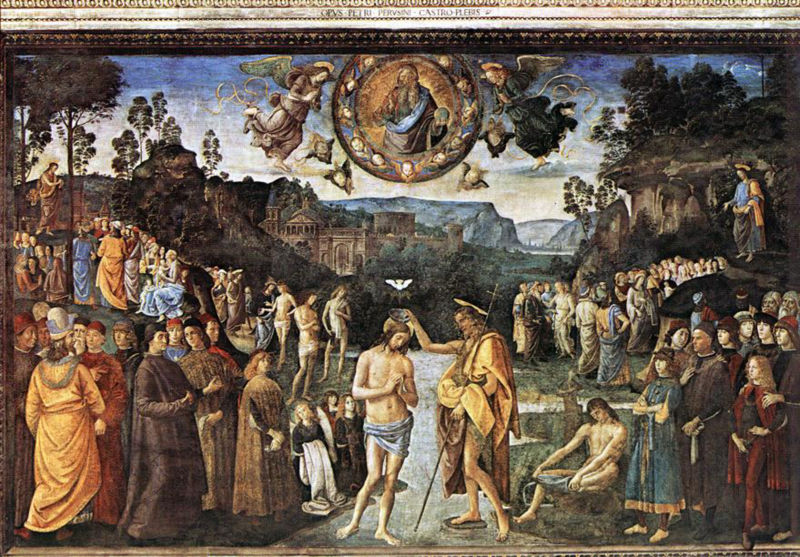Du cardinal Gerhard Müller sur kath.net/news :
« C’est vrai : Dieu aime tout le monde. Mais il faut ajouter : Dieu n’aime pas tout. »
21 janvier 2024
En raison de l’idéologie athée du genre, les jeunes sont perturbés dans leur identité et « séduits par les sociétés médicales pour qu’ils se mutilent le corps pour beaucoup d’argent ». Sermon pour la fête de St. Agnès 2024. Par Card. Gerhard Müller, Rome
Rome (kath.net) kath.net documente dans son intégralité le sermon du cardinal Gerhard Müller pour le patronage de son église titulaire Sainte-Agnès à Agone le 21 janvier 2024 et remercie SE pour l'aimable autorisation de publier :
La critique des Juifs et des Chrétiens contre l’ancien polythéisme n’est pas du tout que les païens se tournaient vers une puissance supérieure, mais qu’ils adoraient ses créatures comme des dieux au lieu du Dieu unique et véritable. Bien que chaque être humain soit capable de reconnaître la puissance éternelle et l'existence de Dieu à partir des œuvres de la création grâce à sa raison, la plupart des gens étaient encore séduits par la splendeur du monde, la richesse, la puissance, la renommée. La tragédie qui s'est produite ici est résumée par Paul au début de sa lettre aux Romains : « Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge ; ils ont adoré la créature et l'ont honorée au lieu du Créateur. » (Rm 1, 25) .
Dans un monde nihiliste où prévaut la devise : « Mangeons et buvons, car demain nous serons morts » (1 Co 15, 32), l'idéal de vie ascétique et sacrificiel des chrétiens doit agir comme un chiffon rouge sur lequel le taureau de la jouissance nue de la vie bondit avec une fureur sauvage. Ce qui était le culte des idoles dans le monde antique est maintenant le culte de la personnalité des riches, des beaux et des puissants. Mais la vérité s’applique également aux oligarques frivoles et aux élites arrogantes du Nouvel Ordre Mondial et de l’Agenda 2030 : la gloire du monde s’estompe et tous les peuples doivent mourir un jour. Les machinations criminelles entourant le banquier d’investissement américain Jeffrey Epstein et ses amis éminents, qui ont été étouffées par la grande presse, prouvent le mensonge mortel du nouveau paganisme, qui ne peut être exposé et vaincu que par la vérité de Dieu.
"Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur." (Romains 6:23)
Si cette parole de l’Écriture est vraie, alors la conclusion est la suivante : aucun prêtre du Christ ne peut bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un péché qui est contre la nature de l’homme créé par Dieu. C'est vrai : Dieu aime tout le monde. Mais il faut ajouter : Dieu n’aime pas tout, mais il déteste le péché parce qu’il nous entraîne dans la mort éternelle. Par conséquent, nous devons interpréter l’amour divin non pas comme il convient aux gens, mais comme il nous montre sa miséricorde en Christ. Dieu lui-même nous révèle la raison et le sens de son amour pour les pécheurs comme seule voie de salut : « Tant que je vis - déclare le Seigneur Dieu - je n'ai pas de plaisir à la mort du coupable, mais à ce qu'il se détourne de sa voie et reste en vie » (Ez 33, 11 ; cf. Jr 31, 20).
Sainte Agnès, que nous vénérons aujourd'hui, fut une martyre chrétienne lors des dernières étapes de la persécution des chrétiens dans l'Empire romain. Cette vierge martyre est l'idéal d'une vie nouvelle en Dieu notre Créateur et Rédempteur. Nous n’avons pas besoin d’une idole sexuelle de l’ancien et du nouveau paganisme comme objet de notre désir, engourdissant le sentiment nihiliste d’être sans Dieu. Les catholiques du monde entier admirent la jeune Romaine de 12 ans pour son héroïsme et la vénèrent comme une sainte et une défenseure de la jeunesse chrétienne. À propos de sa mort consacrée à Dieu, le grand père de l'Église Ambroise de Milan dit : « Ainsi, dans l'unique sacrifice, vous avez un double martyre, celui de la virginité et celui de l'adoration : elle est restée vierge, elle a obtenu la couronne du martyr. (De virg. II, 9).