PAPE FRANCOIS - AUDIENCE GÉNÉRALE
Salle Paul VI - Mercredi 27 décembre 2023
_______________________________________
Catéchèse. Vices et vertus. 1. introduction : garder le cœur
Chers frères et sœurs, bonjour !
Aujourd'hui, je voudrais introduire un cycle de catéchèse sur le thème des vices et des vertus. Et nous pouvons commencer au tout début de la Bible, où le livre de la Genèse, à travers le récit des premiers parents, présente la dynamique du mal et de la tentation. Pensons au Paradis terrestre. Dans le tableau idyllique que représente le jardin d'Eden, apparaît un personnage qui devient le symbole de la tentation : le serpent, ce personnage qui séduit. Le serpent est un animal insidieux : il se déplace lentement, en rampant sur le sol, et parfois on ne remarque même pas sa présence - il est silencieux -, parce qu'il parvient à se fondre dans son environnement et surtout, il est dangereux.
Lorsqu'il entame son dialogue avec Adam et Ève, il montre qu'il est aussi un dialecticien raffiné. Il commence, comme on le fait pour les mauvaises langues, par une question malicieuse : "Est-il vrai que Dieu a dit : Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?" (Gn 3,1). La phrase est fausse : Dieu a effectivement offert à l'homme et à la femme tous les fruits du jardin, sauf ceux d'un arbre précis : l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette interdiction ne vise pas à interdire à l'homme l'usage de la raison, comme cela est parfois mal interprété, mais constitue une mesure de sagesse. Comme pour dire : reconnais la limite, ne te crois pas maître de tout, car l'orgueil est le commencement de tous les maux. Ainsi, l'histoire nous dit que Dieu place les premiers parents comme seigneurs et gardiens de la création, mais qu'il veut les préserver de la présomption de toute-puissance, de se rendre maîtres du bien et du mal, ce qui est une tentation. une mauvaise tentation encore aujourd'hui. C'est l'écueil le plus dangereux pour le cœur humain.
Comme nous le savons, Adam et Ève n'ont pas su résister à la tentation du serpent. L'idée d'un Dieu pas très bon, qui voulait les soumettre, s'est insinuée dans leur esprit : d'où l'effondrement de tout.
Par ces récits, la Bible nous explique que le mal ne commence pas chez l'homme de manière retentissante, lorsqu'un acte est déjà manifeste, mais qu'il commence bien plus tôt, lorsqu'on commence à s'en divertir, à le bercer d'imagination, de pensées, et qu'on finit par se laisser piéger par ses attraits. Le meurtre d'Abel n'a pas commencé par une pierre lancée, mais par la rancune que Caïn a méchamment entretenue, faisant de lui un monstre en son for intérieur. Dans ce cas aussi, les recommandations de Dieu ne servent à rien.
Avec le diable, chers frères et sœurs, il n'y a pas de dialogue. Jamais ! Il ne faut jamais discuter. Jésus n'a jamais dialogué avec le diable, il l'a chassé. Et dans le désert, lors des tentations, il n'a pas répondu par le dialogue, il a simplement répondu par les paroles de l'Écriture Sainte, par la Parole de Dieu. Attention : le diable est un séducteur. Ne dialoguez jamais avec lui, parce qu'il est plus intelligent que nous tous et qu'il nous le fera payer. Quand la tentation arrive, ne dialoguez jamais. Fermez la porte, fermez la fenêtre, fermez votre cœur. Ainsi, nous nous défendons contre cette séduction, car le diable est rusé, il est intelligent. Il a essayé de tenter Jésus avec des citations bibliques, en se présentant comme un grand théologien. Attention. Avec le diable, nous ne conversons pas, et avec la tentation, nous ne devons pas entrer en dialogue. La tentation vient : nous fermons la porte, nous gardons le cœur.
Il faut être le gardien de son propre cœur. Et c'est pourquoi nous ne conversons pas avec le diable. C'est la recommandation - garder le cœur - que nous trouvons chez divers pères, les saints. Et nous devons demander cette grâce d'apprendre à garder le cœur. C'est une sagesse de savoir comment garder son cœur. Que le Seigneur nous aide dans ce travail. Mais celui qui garde son cœur, garde un trésor. Frères et sœurs, apprenons à garder le cœur.





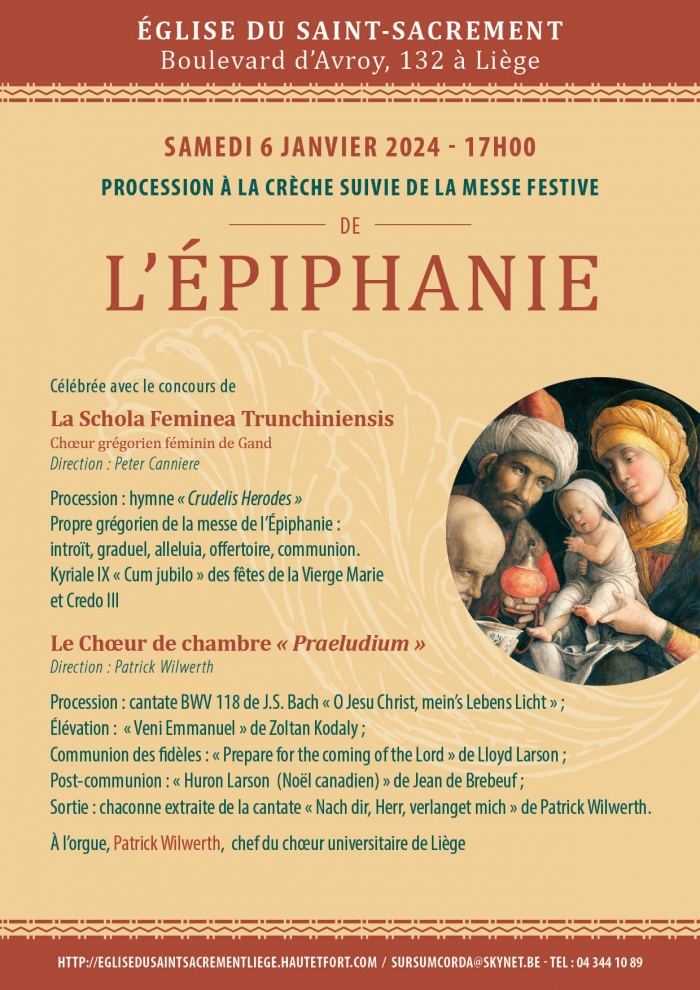
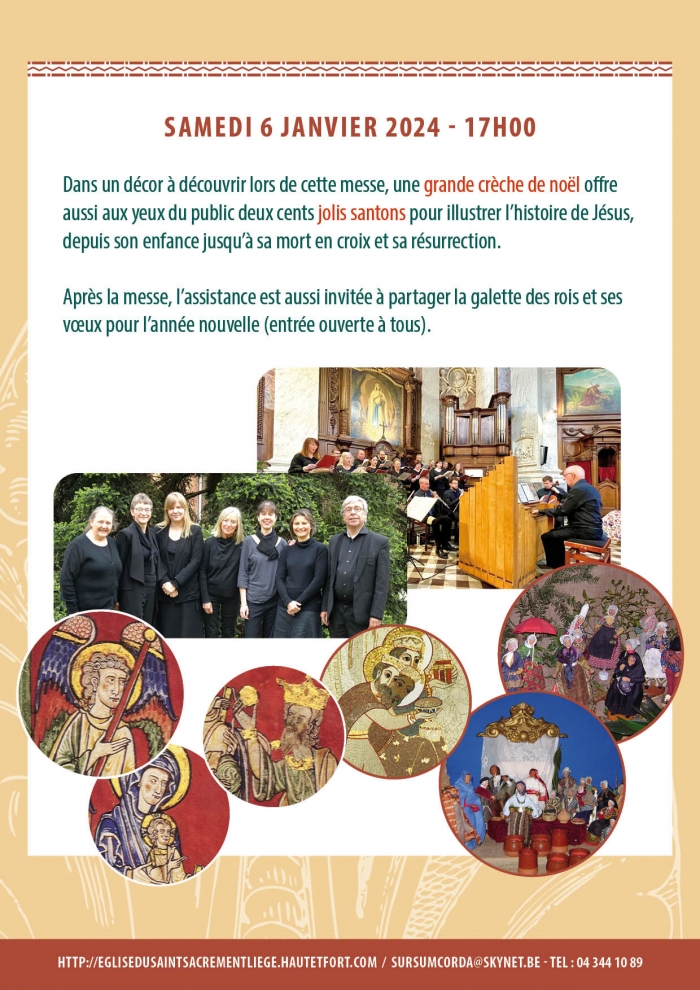

 (CNS photo/Vatican Media)
(CNS photo/Vatican Media)