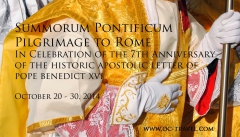 Les « supporters » de la liturgie romaine traditionnelle sont en pèlerinage à Rome ce week-end. Ils ont reçu du pape émérite Benoît XVI un message d’encouragement très appuyé et chaleureux. Lu samedi sur le site « riposte catholique » :
Les « supporters » de la liturgie romaine traditionnelle sont en pèlerinage à Rome ce week-end. Ils ont reçu du pape émérite Benoît XVI un message d’encouragement très appuyé et chaleureux. Lu samedi sur le site « riposte catholique » :
« Le 3ème pèlerinage Summorum Pontificum à Rome, qui a commencé jeudi soir, dans la paroisse de la Trinité des Pèlerins, a trouvé son sommet aujourd’hui, à la Basilique Saint-Pierre, avec un Pontifical célébré par le cardinal Raymond Burke (encore) Préfet du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.
Une très longue file de clercs et de fidèles est partie de la Basilique Saint-Laurent in  Damaso, à côté de la Chancellerie Apostolique, s’est engagée dans les rues de Rome, a traversé le Tibre sur le Pont Saint-Ange, a remonté enfin la via de la Conciliation pour entrer dans la Basilique par la grande porte au chant du Credo. Le tout pour la joie des Romains, des pèlerins-photographes, et, il est vrai, pour la pénitence des automobilistes…
Damaso, à côté de la Chancellerie Apostolique, s’est engagée dans les rues de Rome, a traversé le Tibre sur le Pont Saint-Ange, a remonté enfin la via de la Conciliation pour entrer dans la Basilique par la grande porte au chant du Credo. Le tout pour la joie des Romains, des pèlerins-photographes, et, il est vrai, pour la pénitence des automobilistes…
2 000 fidèles, 300 prêtres au moins (de nombreux prêtres en clergyman dans la foule), ont participé à la messe pontificale en l’honneur de la Sainte Vierge, avec la présence du cardinal William Levada, ancien Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la Foi, de Mgr Guido Pozzo, secrétaire de la Commission pontificale Ecclesia Dei, et d’autres prélats. La liturgie a été rehaussée par les chants du propre et du kyriale, assurés par le Pontifical North American College, le séminaire américain de Rome.
L’émotion a été maximale lorsque le cardinal Burke, visiblement fatigué par les labeurs des éprouvantes semaines précédentes, mais parlant avec une voix particulièrement ferme, a célébré dans son homélie l’œuvre de Benoît XVI pour la liturgie, la place éminente du « magistère » du culte divin et spécialement de la liturgie selon la forme extraordinaire.
L’importance du nombre de clercs souvent jeunes, prêtres, religieux et séminaristes, notamment des séminaristes romains, avait créé l’étonnement lors des derniers pèlerinages, mais était cette fois plus notable encore. Visiblement, était là, en chair et en os, ce phénomène que tout le monde observe : celui de l’intérêt que le jeune clergé porte à la messe traditionnelle, et qui est une des raisons de la renaissance de la liturgie antique de l’Église romaine.
Dimanche, en la solennité du Christ-Roi, le cardinal Walter Brandmüller présidera pontificalement une messe en la Basilique Saint-Benoît, à Nurcie, et Mgr François Bacqué, nonce apostolique, célèbrera, à Rome, la messe pontificale en la paroisse de la Trinité des Pèlerins.
Lors de la messe à Saint-Pierre, Mgr Pozzo a lu un message du Secrétaire d’État, le cardinal Pietro Parolin, transmettant la bénédiction apostolique du Pape François, au cardinal Burke, aux prêtres et fidèles présents, leur souhaitant « un élan renouvelé pour le témoignage du message immuable de la foi chrétienne ». À la grande joie des fidèles, dont il a fallu contenir les applaudissements, il a lu aussi un message du Pape émérite Benoît XVI adressé au délégué général du Cœtus Internationalis Summorum Pontificum, Guiseppe Cappocia, exprimant sa grande joie de savoir que la messe selon l’usage ancien se développait aujourd’hui, notamment avec des jeunes fidèles, grâce, a-t-il souligné, à « de bons cardinaux », et disant aux pèlerins : « Je suis spirituellement avec vous ».
Ref. Benoît XVI au pèlerinage Summorum Pontificum : « Je suis spirituellement avec vous»
Le blog du « suisse romain » (abbé Rimaz) reproduit les termes mêmes choisis par Benoît XVI : « Je suis très heureux que l’usus antiquus vive maintenant dans la pleine paix de l’Eglise, même chez les jeunes, soutenue et célébrée par de grands cardinaux. Spirituellement je serai avec vous. Mon état de “moine cloîtré” ne me permet pas une présence à l’extérieur. Je ne sors de ma clôture que dans des cas particuliers, invité personnellement par le Pape. »
JPSC
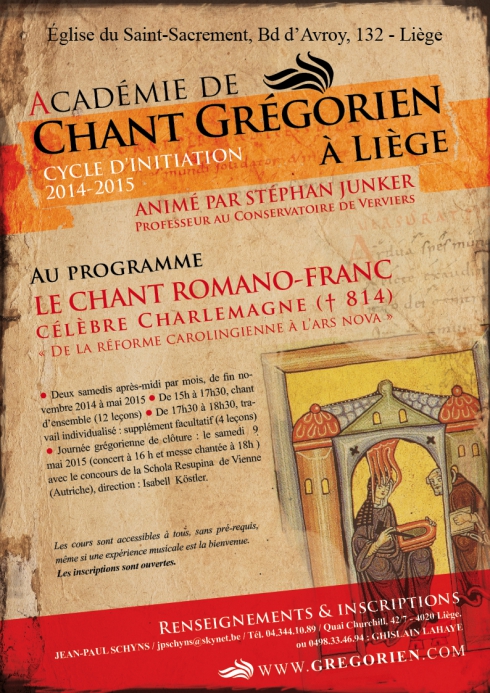
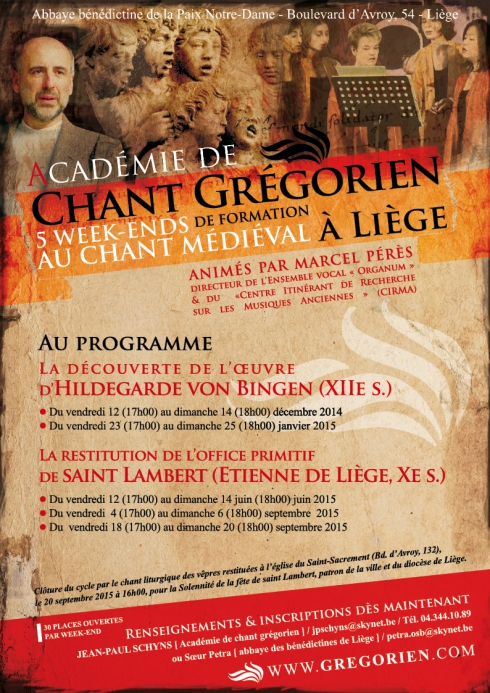

 Le 3e pèlerinage Summorum Pontificum s’est déroulé à Rome du 23 au 26 octobre derniers, et la messe Pontificale célébrée par le cardinal Raymond Burke, préfet de la Signature Apostolique, dans la Basilique Saint-Pierre, en présence de plus de 300 prêtres et 2 000 pèlerins venus du monde entier, en a été l’événement le plus important. Correspondance européenne a interviewé l’abbé Claude Barthe, aumônier du pèlerinage.
Le 3e pèlerinage Summorum Pontificum s’est déroulé à Rome du 23 au 26 octobre derniers, et la messe Pontificale célébrée par le cardinal Raymond Burke, préfet de la Signature Apostolique, dans la Basilique Saint-Pierre, en présence de plus de 300 prêtres et 2 000 pèlerins venus du monde entier, en a été l’événement le plus important. Correspondance européenne a interviewé l’abbé Claude Barthe, aumônier du pèlerinage.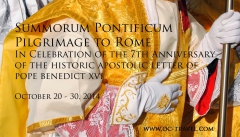 Les « supporters » de la liturgie romaine traditionnelle sont en pèlerinage à Rome ce week-end. Ils ont reçu du pape émérite Benoît XVI un message d’encouragement très appuyé et chaleureux. Lu samedi sur le site « riposte catholique » :
Les « supporters » de la liturgie romaine traditionnelle sont en pèlerinage à Rome ce week-end. Ils ont reçu du pape émérite Benoît XVI un message d’encouragement très appuyé et chaleureux. Lu samedi sur le site « riposte catholique » : Damaso, à côté de la Chancellerie Apostolique, s’est engagée dans les rues de Rome, a traversé le Tibre sur le Pont Saint-Ange, a remonté enfin la via de la Conciliation pour entrer dans la Basilique par la grande porte au chant du Credo. Le tout pour la joie des Romains, des pèlerins-photographes, et, il est vrai, pour la pénitence des automobilistes…
Damaso, à côté de la Chancellerie Apostolique, s’est engagée dans les rues de Rome, a traversé le Tibre sur le Pont Saint-Ange, a remonté enfin la via de la Conciliation pour entrer dans la Basilique par la grande porte au chant du Credo. Le tout pour la joie des Romains, des pèlerins-photographes, et, il est vrai, pour la pénitence des automobilistes…