La péninsule de l’Athos est un lieu haut. Située à l’est de la Grèce, ce bras de terre long d’une cinquantaine de kilomètres n’est relié à la terre que par une maigre bande recouverte de végétation. Il n’y a que le bateau pour entrer dans cet Etat dans l’Etat. Oui, cela fait mille ans que ce territoire étonnant n’est peuplé que de … moines. C’est aussi pour cela qu’on l’appelle la Sainte Montagne. Ici la Mère de Dieu, la Theotokos, est partout chez elle ; près de 3000 moines, quelques visiteurs de passage, pour l’essentiel des orthodoxes. Malgré la grande rupture entre l’Orient et l’Occident en 1054, des bénédictins latins sont restés sur l’Athos environ trois siècles encore. On peut admirer ce que furent leurs monastères : une haute tour émerge de la cime des arbres, bien plantée. Quelques catholiques, quoiqu’en nombre réduit, sont aujourd’hui autorisés à se rendre chaque année dans cette patrie du monachisme byzantin.
Rattachés au Patriarcat de Constantinople, une vingtaine de monastères compose ce terroir de traditions et de spiritualité. Les offices sont souvent nocturnes et durent longtemps. La psalmodie est grave et solennelle ; on est là pour adorer Dieu. Voici quelques noms de ces forteresses de la contemplation : Vatopedi, Saint Panteleimon, Simonos Petra, Chilandar, Koutloumousiou…
Le sommet de la péninsule n’est autre que le fameux Mont Athos. Il culmine à 2033 mètres d’altitude. Lorsque le soleil couchant libère ses derniers feux, l’ombre de la croix plantée tout en haut se couche littéralement sur la mer. Elle nous dit que le sacrifice du Christ est étroitement lié à la lumière, que la souffrance ne fait jamais écran à l’espérance.
Catholique, j’empruntais l’an dernier les chemins de la Sainte Montagne, pèlerin vers la Vierge ma Mère, en ami des orthodoxes, avec eux. Nous étions un groupe réuni par la conviction que la société n’est vraiment libre que lorsqu’elle choisit le Christ.
In hoc signo vinces – par ce signe tu vaincras - avait pu lire sur le fronton du ciel l’empereur Constantin, à la veille d’une bataille. Et c’était une croix qui lui était apparue, incandescente. C’est cette croix que les moines ont choisi de porter, dans leur cœur, comme un appel à marcher à la suite de celui qui est la Résurrection et la Vie. Nous en étions sûr, et nous le demeurons plus que jamais, le relèvement de notre vieille Europe ne pourra se faire en dehors de ses racines.
Toujours en Europe, en Occident cette fois, il est une autre citadelle de prière, comment ne pas parler d’elle… Adossée comme sa sœur d’Orient à un calvaire situé sur un sommet à 2033 mètres d’altitude, le « Grand Som », il faut le voir pour le croire, elle est consacrée à la Mère de Dieu depuis les origines.
Blotti au cœur des Alpes dans un désert de silence et de solitude, le monastère de la Grande Chartreuse prie depuis bientôt mille ans. Près de trois cents monastères sont issus de ce tronc qui ressemble plus à un baobab qu’à un noisetier. Ses hôtes ne sont pas cénobites mais plutôt ermites, comme les anachorètes des kalyves de l’Athos. Et leurs chants, empruntant leurs douces mélodies au pape saint Grégoire le Grand, sont un hymne d’adoration. Plus encore, c’est le Christ lui-même qui chante et aime le Père, dans l’Esprit-Saint. Mystère de don, de vie, capable de susciter chez l’homme le désir de se consacrer tout entier et pour toujours selon les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance.
Bientôt, je retournerai à l’Athos, avec au cœur un mot d’ordre de saint Bruno, fondateur de la Chartreuse et homme de l’an mil : « Ce que la solitude et le silence du désert apportent d'utilité et de divine jouissance à ceux qui les aiment, ceux-là seuls le savent, qui en ont fait l'expérience ».
Et cette expérience est unifiante, elle donne un avant-goût du mystère de communion dans le Christ et son Eglise auquel nous sommes tous appelés. Maintenant et à jamais.
Guillaume d’Alançon
NDLR.: bien détachés du monde de par leur situation géographique et spirituelle (au statut protégé par le droit international et la Constitution grecque), une bonne partie des vingt monastères athonites – pourtant rattachés au Patriarcat de Constantinople – ont refusé de suivre le patriarche Bartholomée dans sa création de toutes pièces et sur l’instigation (géo-stratégique d'isolement de la Russie, et financière) des USA d’une église ukrainienne « autocéphale » à lui entièrement soumise, envers et contre l’église ukrainienne canonique sous l’omophore du Patriarcat de Moscou (depuis quatre siècles), d’où un ferment de division hélas introduit artificiellement sur la « sainte montagne »… Par ailleurs, voilà déjà près d'une décennie que l'archimandrite Parthénius, abbé du monastère athonite de Saint-Paul (une centaine de moines) avait prédit aux croyants chrétiens « des souffrances qui dépasseraient celles infligées aux grands martyrs des premiers siècles » (…), les événements dans le monde indiquant que « bientôt, les hommes devaient perdre la liberté que le Seigneur leur a donnée - la liberté personnelle - en devenant totalement soumis (…) à ceux qui complotent tout cela, qui sont dans le mal, et veulent régner et gouverner le monde en tous lieux. Par exemple, un Constantin cessera de porter son (pré)nom et sera le numéro cent-trente-cinquième ou cent-cinquante-troisième ». Le Père Parthénius n'en exprimait pas moins sa confiance dans « le renouveau de la Foi en Russie dont témoigne le si grand nombre de saints dans le peuple russe ». Et d’ajouter : « vous pouvez résister à tout ce mal qu’il faut combattre avec courage comme un lion se bat, mais seulement avec la foi et l’espérance en Dieu ». L'année dernière, le saint moine déclarait encore : « Seul le Seigneur peut nous délivrer de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. La nouvelle ère va tout détruire. Elle détruira la famille, elle essayera de détruire l'Église, tout détruire afin qu'il ne reste plus rien. Les gens se dirigent vers le mal à une allure vertigineuse. Qui peut arrêter cette course ? Seul le bon Dieu qui garde le monde... Une tempête arrive, qui est pire que le communisme... Ce qui s'approche maintenant est pire. Que le Seigneur nous bénisse tous ! », concluait l'archimandrite Parthenius Murelatos, un des plus anciens moines d'Athos, bientôt nonagénaire. Installé sur le Mont Athos en 1954, il est depuis plus de 40 ans l’abbé du monastère de Saint-Paul, connu pour conserver les dons des mages parmi ses saintes reliques. ALC
 « En vacances depuis le 25 juillet au fort de Brégançon (Var), Brigitte et Emmanuel Macron se sont rendus dimanche dernier à l’abbaye du Thoronet afin de visiter et découvrir les trésors de ce lieu presque millénaire.
« En vacances depuis le 25 juillet au fort de Brégançon (Var), Brigitte et Emmanuel Macron se sont rendus dimanche dernier à l’abbaye du Thoronet afin de visiter et découvrir les trésors de ce lieu presque millénaire.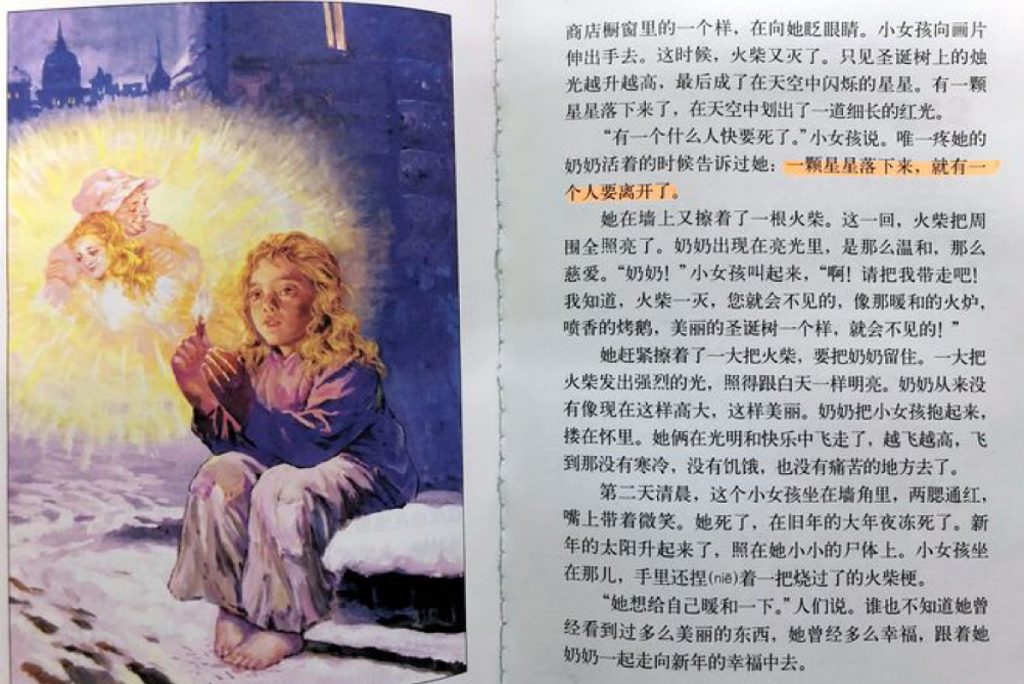

 Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour contribuer à la
Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour contribuer à la 


