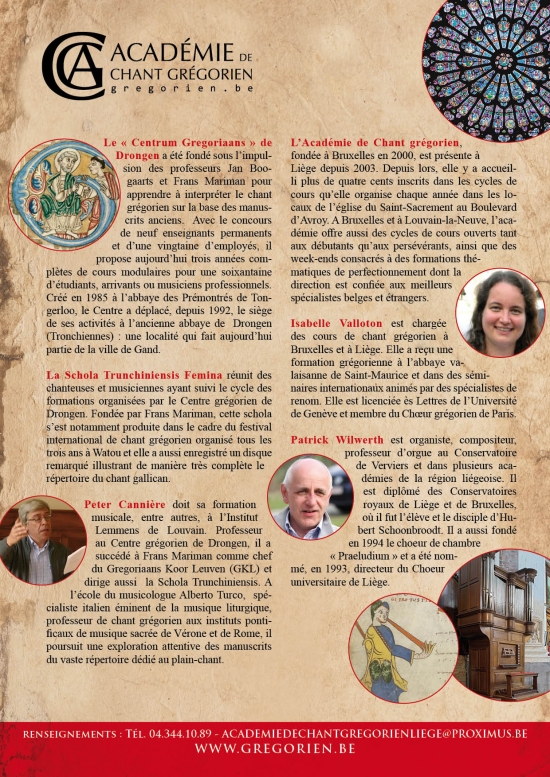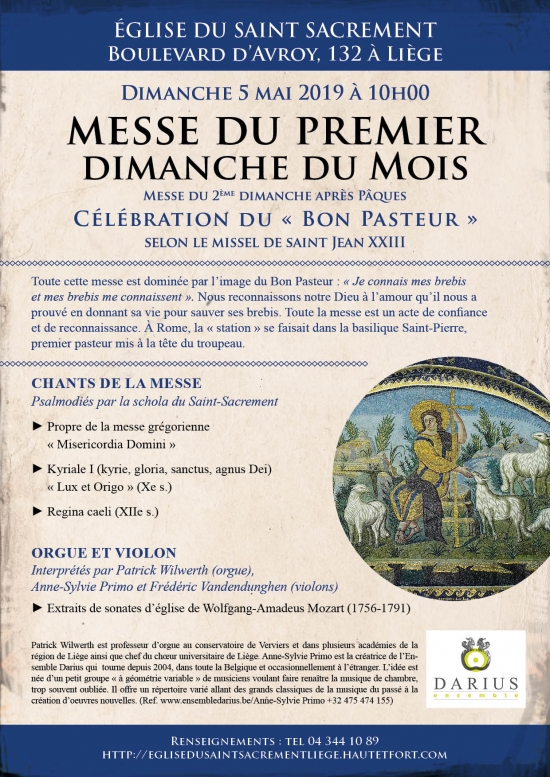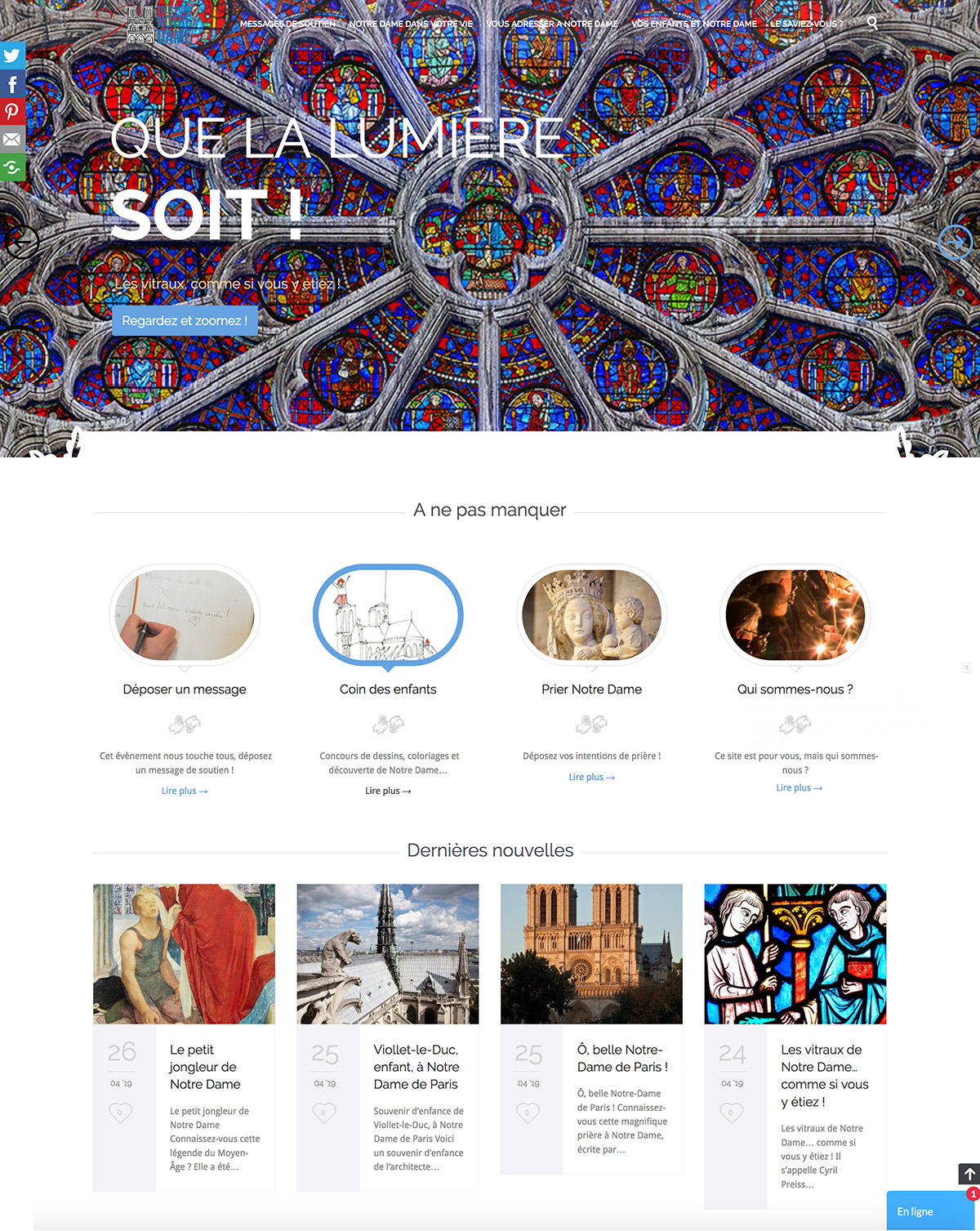Les évêques de France continuent de porter avec attention la question de l’avenir de nos églises. Des groupes de travail ont été mis en place ces dernières années pour rappeler les règles en matière de désaffectation et pour insister sur la dimension pastorale. Dans le cadre de ces réflexions, un colloque a eu lieu au Collège des Bernardins en mars 2018. Trois conclusions s’étaient imposées à l’issue de ce beau colloque : une invitation au dialogue avec les partenaires multiples — les élus, les amoureux du patrimoine, les communautés chrétiennes, les habitants des communes ; une invitation à la vigilance, dans un temps où bien des repères sont perdus : redire ce qu’est une église et sa vocation au sens large du terme ; une invitation à l’espérance : nos églises sont une chance pour la nouvelle évangélisation.
Allons-nous devoir désacraliser de nombreuses églises ?
Ces réflexions se conduisent sur un fond d’inquiétude : allons-nous devoir désaffecter, désacraliser des églises de façon massive, dans les années qui viennent ? Il n’est pas illégitime de se poser cette question. Elle nous attriste, elle peut même nous faire peur. Notons qu’il serait aussi irresponsable de ne pas se la poser. Les enjeux sont nombreux : ils sont pastoraux, mais aussi sociaux, politiques, juridiques, canoniques ou patrimoniaux.
Aborder cette question, c’est entrer sur un terrain à la fois passionnant et un peu miné. Cette réflexion, nous ne sommes pas les seuls à la porter. Bien d’autres pays connaissent cette situation : en novembre dernier à Rome, le Conseil pontifical pour la culture organisait à son tour un colloque au titre évocateur : Dieu n’habite plus en ce lieu ? Au cours de cette rencontre, où fut évoquée la désaffection des lieux de culte, des Italiens, des Canadiens et des représentants venus des pays de l’Est de l’Europe sont venus partager des expériences d’utilisation nouvelle de leurs églises. Ainsi, la problématique n’est pas que française, même si elle se pose en France d’une façon originale suite aux lois de 1905 et 1907.
Jusqu’où peut-on aller dans l’utilisation non-cultuelle d’une église ?
Le plus souvent, on retrouve une tension sous-jacente entre l’option d’une utilisation non-cultuelle d’une église et la décision radicale de sa désaffection. Quels critères pouvons-nous nous donner ? Nous savons que la culture, la beauté, le patrimoine sont une porte d’entrée pour une évangélisation par les pierres, d’où l’importance des églises ouvertes, bien entretenues, accueillantes. Il y a dans ce domaine un bouillonnement et des initiatives très encourageantes. On se souvient de la belle expression que le pape Benoît XVI avait employée, la via pulchritudinis, la voie de la beauté pour nous faire accéder à Dieu.
Lors du colloque romain, le pape François a adressé un message aux participants invitant à creuser la piste sociale. Comment un « bâtiment-église » peut-il être mis au service de finalités sociales ? Le Pape évoquait la figure du diacre saint Laurent dont l’iconographie sacrée le montre en train de vendre de précieux objets du culte pour en distribuer le produit aux pauvres. Pour le Pape, « ceci constitue un enseignement ecclésial constant qui, tout en inculquant le devoir de protection et de conservation des biens de l’Église, et en particulier des biens culturels, déclare qu’ils n’ont pas de valeur absolue mais qu’en cas de nécessité ils doivent servir au plus grand bien de l’être humain, et spécialement au service des pauvres ». Une église où, par exemple, on donnerait à manger, où les personnes seraient accueillies, ne serait que la mise en pratique de l’Évangile : « J’avais faim, vous m’avez donné à manger… j’étais un étranger, vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35). Agir en ce sens nous inviterait à reconsidérer le canon 1214 qui définit une église comme « l’édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est public ».
En cas de désaffection d’une église
Devant la décision radicale de la désaffection d’une église, trois questions surgissent. Premièrement, la future utilisation du bâtiment n’est-elle pas inconvenante (cf. canon 1222, non sordidum) ? Ensuite, en quoi un bâtiment qui n’est plus une église mais qui continue de lui ressembler, peut-il demeurer un signe ? Ne risque-t-il pas aussi de devenir un « contresigne » laissant penser qu’autrefois il y avait des chrétiens, mais que maintenant c’est fini ? Enfin, tout est-il fait « pour assurer un nouvel usage religieux ou culturel, compatible autant que possible avec l’intention initiale de la construction »1 ? L’intention peut être excellente, mais le risque est de dédier une ancienne église par exemple au silence, à la beauté, à l’intériorité, à l’harmonie, en mettant sur un même plan une certaine religiosité ambiante avec le message initialement chrétien du bâtiment.
On le voit, ces questions sont complexes, ne pas les regarder en face serait irresponsable, les traiter trop rapidement aussi. Dans la conclusion du colloque romain, il a été demandé à plusieurs reprises que le peuple de Dieu dans son ensemble soit engagé dans ces réflexions. Chaque évêque, dans son diocèse, est invité à une réflexion ample, qui continuera de nous mobiliser dans les années qui viennent.
[1] Texte d’orientation du colloque de Rome Dieu n’habite plus en ce lieu ?