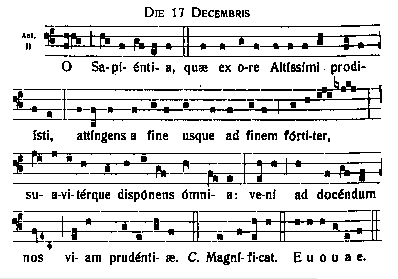L'hymne du « Rorate Cæli desuper » est par excellence le chant grégorien du Temps de l'Avent. Son refrain est tiré du Livre d'Isaïe (45, 8) : « Cieux, épanchez-vous là-haut, et que les nuages déversent la justice, que la terre s’ouvre et produise le salut ». Cette rosée qui tombe du ciel pour féconder la terre et faire descendre le Juste, c'est-à-dire Dieu Lui-même, c'est le Saint-Esprit, et la terre qui s'ouvre sous cette influence céleste et fait germer le Sauveur, c'est bien évidemment le sein très pur de la Vierge Marie.
- Roráte caeli désuper, et nubes pluant iustum.
- Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le Juste.
- Ne irascáris, Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis:
- Ne te mets pas en colère, Seigneur, ne garde plus souvenir de l’injustice.
ecce cívitas Sancti tui facta est desérta:
Voici, la cité sainte est devenue déserte,
Sion desérta facta est : Ierúsalem desoláta est:
Sion a été désertée, Jérusalem est en désolation,
domus sanctificatiónis tuae et glóriae tuae, ubi laudáverunt te patres nostri
la maison de ta sanctification et de ta gloire, où nos pères avaient dit tes louanges.
- Peccávimus, et facti sumus tamquam immúndus omnes nos,
- Nous avons péché et sommes devenus impurs.
et cecídimus quasi fólium univérsi
Nous sommes tombés comme des feuilles mortes
et iniquitátes nostrae quasi ventus abstúlerunt nos :
et nos iniquités nous ont balayés comme le vent.
abscondísti fáciem tuam a nobis, et allilísti nos in manu iniquitátis nostrae.
Tu as détourné de nous ta face, et nous as brisés sous le poids de nos fautes.
- Vide Dómine, afflictiónem pópuli tui
- Vois, Seigneur, l’affliction de ton peuple,
et mitte quem missúrus es :
et envoie celui que tu dois envoyer :
emítte agnum dominatórem terrae, de petra desérti, ad montem fíliae Sion :
envoie l’Agneau, le maître de la terre, de Pétra dans le désert jusqu’à la montagne de ta fille Sion,
ut áuferat ipse jugum captivitátis nostrae
afin qu’il ôte le joug de notre captivité.
- Consolámini, consolámini, pópule meus, cito véniet salus tua.
- Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple : vite viendra ton salut,
Quare mærore consúmeris, quia innovávit te dolor ?
Pourquoi es-tu consumé dans l’affliction, pourquoi la douleur se renouvelle-t-elle en toi ?
Salvábo te, noli timere; Ego enim sum Dóminus Deus tuus,
Je te sauverai, n’aie pas peur, moi, je suis le Seigneur Dieu,
Sanctus Israël Redémptor tuus.
Le Saint d’Israël, ton Rédempteur.
JPSC