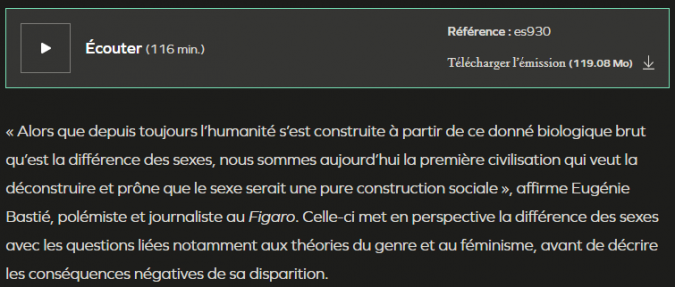De Stefano Chiappalone sur le Daily Compass :
"Canoniser Camara, c'est canoniser le communisme"
14-12-2022
Dom Helder Camara pourrait bientôt être déclaré vénérable. Protagoniste de la théologie de la libération, sympathisant de l'URSS et de la Chine, la lutte armée révolutionnaire était promue dans son diocèse. Un saint "médiatique et idéologique", plutôt que religieux, explique au Compass Julio Loredo, président de la TFP italienne.
Un pas décisif a été franchi pour la cause de béatification de Mgr Helder Camara (1909-1999), l'"évêque rouge" brésilien qui pourrait bientôt être déclaré vénérable. L'annonce a été faite par Mgr Fernando Saburido, son successeur dans l'archidiocèse d'Olinda et de Recife, gouverné par Camara entre 1964 et 1985. Un prélat sui generis, qui s'est rangé du côté de l'aile la plus progressiste des Pères du Concile et qui, une fois le Concile terminé, a souhaité un Vatican III qui surpasse son prédécesseur (à gauche, naturellement). Protagoniste de la théologie de la libération, sur le plan politique, il était résolument favorable aux dictatures communistes, de l'Union soviétique à la Chine, en passant par Cuba, toujours sous la bannière de la "défense des pauvres" à laquelle il s'identifiait de manière propagandiste dans la vie comme dans la mort. Si Monseigneur Camara devait un jour accéder à la sainteté, il serait un modèle pour le moins controversé. C'est ce que revendique, en espérant que la cause soit suspendue, Tradition, Famille et Propriété (TFP), un réseau d'associations né au Brésil de l'action de Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995), leader catholique, engagé dans la " bataille culturelle " sur des positions opposées à celles de Dom Camara. Julio Loredo, président de la TFP italienne, en parle avec le Daily Compass.
Loredo, pourrait-on avoir un "évêque rouge" comme saint ?
Dom Helder Camara a été une figure clé du progressisme ecclésial des années 1930 à sa mort, un protagoniste du virage à gauche de l'Action catholique au Brésil. La théologie de la libération est également apparue dans le cadre de ce processus. En outre, dans les années 1950 et 1960, il a joué un rôle central dans le remplacement (générationnel mais aussi idéologique) de l'épiscopat brésilien, en favorisant la nomination de prélats progressistes avec le nonce de l'époque, Mgr Armando Lombardi.
Une parabole qui partait pourtant du front opposé.....
Et pas en tant que simple militant : il était le numéro deux du parti pro-nazi Action Intégraliste Brésilienne, fondé par Plinio Salgado. Lorsqu'il a été ordonné prêtre en 1931, il portait l'uniforme de la milice intégriste sous sa soutane. Grâce à une étude de Plinio Correa de Oliveira, qui a montré son incompatibilité avec la doctrine catholique, le soutien ecclésiastique au mouvement, qui a ensuite été mis hors la loi par le président Getulio Vargas, a été retiré. Après sa dissolution et l'exil de Salgado, Camara a entamé son virage idéologique à gauche - que nous avons décrit au début - vers la théologie de la libération et la constitution de Communautés Ecclésiales de Base (CEB), préfigurées par le pédagogue marxiste brésilien Paulo Freire, inspirateur du Movimento de Educação de Base.
Comment Dom Camara s'est-il comporté pendant le Concile?
Bien qu'il n'ait jamais pris la parole dans l'assemblée, il était absolument central dans les coulisses de Vatican II. C'est lui qui a coordonné les réunions entre les représentants de l'aile progressiste (curieusement, même sur le front traditionaliste, l'impulsion est venue du Brésil, grâce aux réunions coordonnées par Plinio Correa de Oliveira, d'où est sorti le Coetus Internationalis Patrum). Au cours de ces années, Dom Helder, déjà partie intégrante de la théologie de la libération, poursuit sa dissidence avec le magistère également sur le plan moral, notamment en critiquant Humanae Vitae de Paul VI et en défendant l'avortement.
Un politicien plutôt qu'un évêque ?
En 1969, il prononce un célèbre discours à New York dans lequel il soutient le communisme international. Il défend l'URSS et la Chine de Mao. L'un des épisodes les plus choquants remonte à 1968 : le document Comblin. En juin 1968, un document révèle qu'une révolution communiste armée est prévue au Brésil. Joseph Comblin était un prêtre belge, professeur à l'Institut de théologie de Recife. C'était donc dans le diocèse et sous l'égide de Mgr Camara, qui n'a pas nié l'authenticité du document, se contentant de dire qu'il était officieux. Le projet prévoyait, par exemple, l'abolition de la propriété privée et des forces armées, la censure de la presse, de la radio et de la télévision, et des tribunaux populaires. En pratique, une révolution bolchévique au Brésil. Correa de Oliveira a recueilli deux millions de signatures demandant l'intervention de Paul VI pour bloquer cette infiltration marxiste dans l'Église brésilienne, mais n'a reçu aucune réponse.
En fait, le prélat controversé est resté en fonction jusqu'à l'âge canonique de 75 ans.
En 1984, Jean-Paul II a nommé son successeur José Cardoso Sobrinho, qui a tenté de mettre de l'ordre dans le diocèse, allant jusqu'à fermer l'Institut de théologie et à en créer un autre. La même année, l'instruction du Vatican Libertatis Nuntius a été publiée, condamnant les aspects extérieurs de la théologie de la libération, mais c'était comme fermer la porte de l'écurie quand le cheval était déjà parti.
Et il n'est jamais revenu sur ses positions ?
Pas à ce que l'on sache. Et lorsqu'il est mort en août 1999, il a bénéficié d'une sorte de canonisation médiatique. Certains journaux italiens titrent : "Prophète des pauvres", "Saint des favelas", "Voix du tiers-monde", et même "Saint Helder d'Amérique".
Une "renommée de sainteté" idéologique, plutôt que religieuse.
Si Dom Helder Camara était canonisé, ce serait aussi la canonisation du communisme, de la théologie de la libération, de la dissidence. On l'appelle déjà le "saint des pauvres", mais il a défendu des régimes qui provoquent la pauvreté, comme le résume Indro Montanelli : "La gauche aime tellement les pauvres que chaque fois qu'elle arrive au pouvoir, elle augmente leur nombre". En ce qui concerne la "falsification de la foi chrétienne" opérée par la théologie de la libération, Benoît XVI a déclaré qu'"il faut aussi s'y opposer par amour pour les pauvres et pour le service qui doit leur être rendu".