De Giovanni Bernardi sur La Luce di Maria :
Dernière étude sur le linceul - Ce qu'ils ont découvert bouleverse les conclusions précédentes
20/04/2022
Une nouvelle étude sur le Saint Suaire contredit ce que divers chercheurs ont tenté d'affirmer ces derniers temps, et dévoile ce qui est l'un des plus grands mystères que la science ait jamais rencontrés, mais qui est pourtant parfaitement clair aux yeux de la foi.
Les conclusions de l'étude présentent en fait de nouvelles données sur le tissu le plus mystérieux de l'humanité, nous ramenant une fois de plus à Jérusalem, au jour où toute l'histoire a changé à jamais.

source web de la photo
Le Suaire est un miracle qui continue sans interruption à nous ramener à ce moment unique, il y a deux mille ans, au jour où le Seigneur Jésus a vaincu la mort pour toute l'humanité, donnant la vie éternelle à tous ceux qui décident de croire en Lui et en son chemin de rédemption du péché et de l'iniquité du mal.
L'objet le plus mystérieux de toute l'histoire
Il s'agit de l'objet archéologique le plus étudié au monde, qui a impliqué des milliers de scientifiques et de professeurs de dizaines de disciplines différentes au cours des siècles. Aujourd'hui encore, il reste de nombreux mystères inexpliqués que seul le regard de la foi peut aligner, au point d'être touché par cet objet extraordinaire.
Chaque année, de nouvelles études sont menées sur le voile spécial qui a été placé sur le corps de Jésus une fois sur le Saint-Sépulcre. Les dernières recherches révèlent un fait très intéressant, rapporté par le journal Libero dans un article du journaliste Antonio Socci. L'étude, quant à elle, est parue dans la revue scientifique "Heritage" et s'intitule "X-ray Dating of a Turin Shroud's Linen Sample".
Elle a été réalisée par les scientifiques du CNR Liberato De Caro, Teresa Sibillano, Rocco Lassandro et Cinzia Giannini, en collaboration avec le professeur Giulio Fanti de l'université de Padoue. La recherche applique une nouvelle méthode pour retrouver la date d'origine du suaire. L'analyse des fils de lin permet d'étudier "le degré de vieillissement naturel de la cellulose qui constitue les fibres des fils de lin de l'échantillon étudié, par analyse aux rayons X".
La conclusion extraordinaire de la recherche
La conclusion est extraordinaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Il explique que le tissu du Linceul est beaucoup plus ancien que ce que l'on voudrait nous faire croire suite à la datation au radiocarbone de 1988, qui a tenté de mystifier l'origine du Linceul en affirmant qu'il n'avait que sept siècles. Ces conclusions ont été remises en question par divers spécialistes, qui ont longtemps demandé les données des expériences qui ont conduit à ces conclusions aujourd'hui considérées comme totalement non fiables.
En particulier avec les conclusions critiques de quatre chercheurs publiées dans les plus importantes revues internationales, dont la revue d'Oxford Archaeometry, du laboratoire de recherche d'Oxford pour l'archéologie et l'histoire de l'art. Au contraire, les résultats de cette dernière étude affirment au contraire qu'il y a une compatibilité totale avec l'hypothèse que le Suaire est une relique de 2000 ans, comme l'affirme la tradition chrétienne.
Lire également : Saint Suaire : une universitaire livre un témoignage choquant | Voici ce qu'elle a découvert
La condition pour que cette thèse soit possible est que le linceul ait été conservé à des températures environnementales plus élevées que celles enregistrées en Europe. Il y a sept siècles, le Suaire a été apporté en Europe par le chevalier Godefroid de Charny, qui a fait construire une église à Lirey, en France, pour préserver le tissu sacré qui a enveloppé le Christ pendant sa Passion.
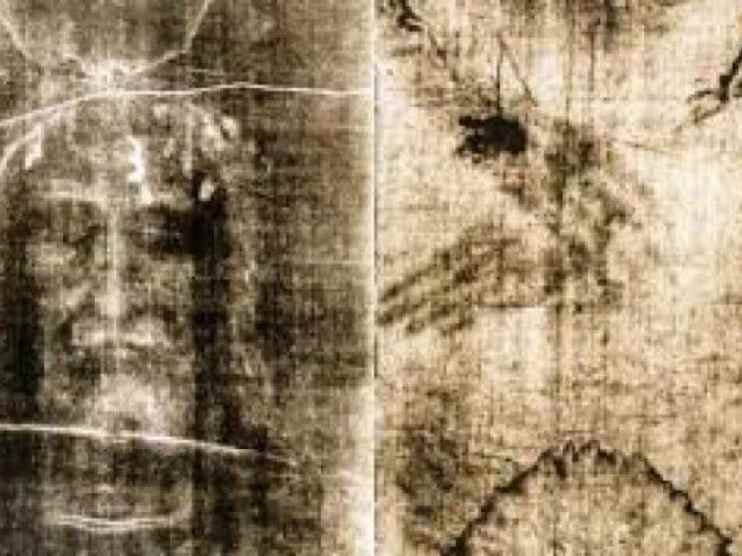
source web de la photo
Mais avant son arrivée sur le Vieux Continent, elle se trouvait au Moyen-Orient. Et les températures requises pour le type de conservation mentionné dans l'expérience sont précisément celles qui sont typiques du Moyen-Orient. De plus, l'étude explique que l'arrivée en Europe a permis la conservation du tissu, ce qui a permis de limiter le vieillissement naturel de la cellulose du lin, mais aussi de préserver l'image du corps sur celui-ci.
Lire également : Jésus se lève le troisième jour - La signification du chiffre trois dans les Saintes Écritures
Reste le mystère de l'impression de l'image sur le tissu, qui renvoie à un phénomène de photoradiaison de nature inconnue, rappelle Socci dans son article. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que l'âge du tissu est de deux mille ans et qu'il provient de la région de Jérusalem, la même région où Jésus-Christ a été torturé et crucifié, comme en témoigne le suaire.
Lire également : New Scientific Technique Dates Shroud of Turin to Around the Time of Christ’s Death and Resurrection



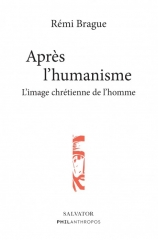 Rémi Brague est professeur émérite de philosophie médiévale, arabe et juive. Membre de l’Institut de France et auteur d’une œuvre importante. Voici, le texte de interview qu’il a accordée à Christophe Geffroy, fondateur et directeur du mensuel La Nef à propos de son dernier livre : « Après l’humanisme. L’image chrétienne de l’homme » Salvator, 2022, 210 pages, 20 € :
Rémi Brague est professeur émérite de philosophie médiévale, arabe et juive. Membre de l’Institut de France et auteur d’une œuvre importante. Voici, le texte de interview qu’il a accordée à Christophe Geffroy, fondateur et directeur du mensuel La Nef à propos de son dernier livre : « Après l’humanisme. L’image chrétienne de l’homme » Salvator, 2022, 210 pages, 20 € :