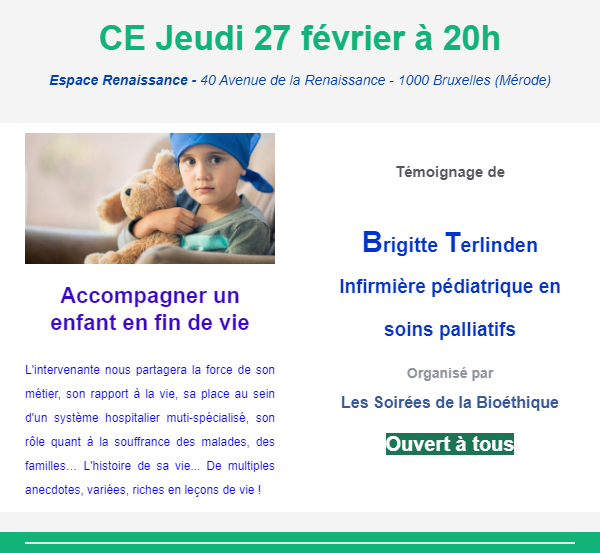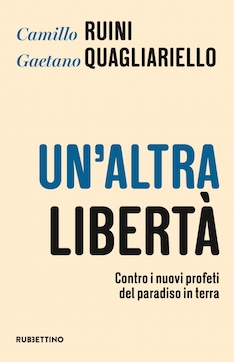Ethique - Page 190
-
Belgique : toutes les institutions de soins et communautés risquent d'être forcées d'autoriser la pratique de l'euthanasie dans leurs murs
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Ethique, Politique, Santé, Société 0 commentaire -
Le Sénat américain a rejeté deux projets de loi “pro-life”
De Vatican News :
États-Unis: les évêques consternés par le rejet de projets de loi pro-vie au Sénat
Le 25 février dernier, le Sénat américain a rejeté deux projets de loi “pro-life”, visant à raccourcir le délai de l’avortement et à prolonger le statut juridique d’un enfant ayant survécu à un avortement. Une décision «effrayante» selon la Conférence épiscopale des évêques américains.Anne-Quitterie Jozeau – Cité du Vatican
Le Sénat américain – à majorité républicaine - a refusé en début de semaine deux projets de lois pro-vie, celui sur la «protection des enfants à naître» contre la douleur (S. 3275) et celui sur la «protection des survivants d’avortement» nés vivants (S. 311).
La première loi visait à interdire et rendre illégal un possible avortement après 20 semaines. À ce stade de la grossesse, l’enfant peut souffrir lors de l’avortement; il peut également survivre, après cette tentative d’interruption volontaire de grossesse.
Le deuxième projet de loi Born-Alive centré sur la «protection des survivants d’avortement» souhaitait faire prolonger et renforcer la protection juridique aux enfants nés vivants après une tentative d’interruption de grossesse. Ce projet de loi avait pour but d’interdire tout infanticide qui découlerait d’un avortement échoué, et de garantir les premiers soins à un enfant né à la suite d’un avortement qui a échoué, afin de préserver sa santé et sa vie.
À ce jour, six autres pays dans le monde entier autorisent l’avortement après 20 semaines: le Canada, le Vietnam, Singapour, la Corée du Nord, la Chine et les Pays-Bas.
Réaction de la Conférence épiscopale
La Conférence épiscopale des États-Unis (USCCB) a vivement réagi, notamment Mgr Joseph F. Naumann, archevêque de Kansas City et président du comité des activités pro-life de l’USCCB. Il a déclaré dans une lettre ouverte relayée par le site de la conférence épiscopale américaine: «aujourd'hui, le Sénat des États-Unis n'a pas réussi à faire avancer deux réformes essentielles en matière de droits de l'homme que la plupart des Américains soutiennent fermement».
L’archevêque a poursuivi: «Il est consternant que même un seul sénateur, et encore moins plus de 40, ait voté en faveur de la poursuite du démembrement brutal de bébés presque adultes et ait voté contre la protection des enfants qui ont survécu à un avortement».
«Notre nation est meilleure que cela, et la majorité des Américains qui soutiennent ces projets de loi doivent faire entendre leur voix», a conclu Mgr Naumann dans sa déclaration.
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Politique, Société 0 commentaire -
La Cour constitutionnelle fédérale allemande de Karlsruhe a décidé d’autoriser le suicide assisté
De Vatican News :
Allemagne: le jugement sur l'euthanasie est une "réévaluation des valeurs"
La Cour constitutionnelle fédérale allemande de Karlsruhe a décidé ce mercredi d’autoriser le suicide assisté en censurant une loi de 2015 sur ce sujet. Les Églises catholique et protestante allemandes ont protesté vigoureusement contre cette décision qui tourne le dos à la promotion de la vie. Le représentant de la Conférence des évêques allemands auprès des institutions politiques allemandes.Entretien réalisé par Mario Galgano – Cité du Vatican
Mgr. Karl Jüsten, le représentant officiel de l´Église catholique auprès des institutions politiques à Berlin, nous explique la position de l’Église allemande.
Mgr Jüsten, pourquoi la décision de Karlsruhe n'est-elle pas acceptable d'un point de vue catholique?
Nous considérons le jugement comme une réévaluation des valeurs. Jusqu'à présent, l'objectif le plus élevé a en fait toujours été la protection de la vie, ce qui a été confirmé à maintes reprises par la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe. Pour la première fois, nous disposons d'un jugement dans lequel la protection de la vie n'est plus la priorité absolue, mais plutôt le droit de décision de l'individu au suicide. C'est là le véritable changement de paradigme et, à mon avis, le véritable problème de ce jugement.
Dans les pays voisins comme les Pays-Bas et surtout en Suisse, il existe déjà une expérience avec des organisations d'euthanasie légale. Jusqu'à présent, il est même arrivé que des Allemands se rendent en Suisse pour y mourir. Ces personnes ont déclaré qu'elles voulaient le faire parce qu'elles voulaient décider elles-mêmes quand et comment elles devaient mourir. Comprenez-vous cela?
Tout d'abord, les pays étrangers en particulier montrent que de telles réglementations créent des incitations et que les gens s'ôtent ainsi la vie. En tant qu'Église, nous préconisons toujours d'aider les personnes qui sont fatiguées de la vie, afin qu'elles puissent trouver le courage de vivre à nouveau et de revenir à une vie normale. Pour nous, le suicide n'est donc pas l'ultima ratio - le dernier recours - mais c'est toujours une défaite, car il faut toujours aider les gens à retrouver une vie normale.
Après tout, l'Église catholique s'appuie avant tout sur les soins palliatifs. Pourquoi ce type de soins médicaux est-il si négligé? Y a-t-il un manque de volonté politique?
Nous avons réalisé des améliorations considérables dans le domaine des soins palliatifs au cours des dernières années. Ces mesures commencent lentement à produire leurs effets. C'est pourquoi je ne comprends pas cette décision de justice, à savoir qu'il n'y a pas d'examen initial pour savoir s'il y a d'autres moyens de soulager les souffrances des gens. Dans l'ensemble, nous y sommes favorables et nous nous efforçons de promouvoir les soins palliatifs dans les hôpitaux et les hospices catholiques.
Qu'espérez-vous maintenant après cette décision à Karlsruhe ? Qu'attendez-vous de la société allemande à cet égard?
Dans l'ensemble de la société allemande, nous avons toujours un très haut niveau de protection de la vie. Les gens ont toujours le sentiment qu'ils ne devraient pas eux-mêmes quitter la vie par suicide. Cela doit être soutenu et renforcé globalement, afin que nous apportions notre aide et notre main lorsqu'ils meurent, mais pas pour qu'ils meurent. Nous voulons aider le processus de mort, mais pas aider au meurtre lui-même ni l'encourager. Un autre point est que nous devons parler aux tribunaux. Je trouve assez effrayant que la Cour constitutionnelle fédérale se soit écartée de la tradition à ce stade et ait ainsi introduit un changement de paradigme. Il me semble que c'est le problème le plus important. Parce que le législateur avait en fait trouvé une très bonne approche au cours de la dernière législature et que le législateur est en fait le miroir de la société. Je vois donc le principal problème ailleurs.
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Justice, Politique, Santé, Société 0 commentaire -
L'affaire Jean Vanier : distinguer péché et crime
D'Arnaud Dumouch :
L'affaire Jean Vanier : distinguer péché et crime (11 mn)
22 février 2020
La direction de l’Arche, une association catholique donnée aux personnes handicapées, dénonce publiquement les actes qui ont accompagné la vie leur fondateur, Jean Vanier : il aurait eu des relations sexuelles sans aller au bout, avec six femmes adultes et non handicapées. Leur consentement était réel mais entaché d’une suspicion de dépendance, Jean Vanier étant leur conseiller spirituel, ce qui est une circonstance à regarder. https://www.youtube.com/watch?v=xGu4v... Rappel de la loi civile et de la loi de l’Eglise : Il faut distinguer « crime » (viol, pédophilie, détournement de mineur ou de personne en état de faiblesse) et péché (acte sexuel avec une maîtresse adulte et consentante, fréquentation de sites pornographique, regard consentis immoraux voir Matthieu 5, 28). L’attitude de l’Eglise, depuis 60 ans, est passée de charybde en Scylla : Dans les années 80, on cache crimes et péchés. Dans les années 2020, on dévoile publiquement crimes et péchés. Les deux attitudes sont absurdes. Dans la situation, on doit revenir aux fondamentaux décrits par Jésus dans ce texte : « Jean 8, 8 Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux ; et il fut laissé seul, avec la femme toujours là au milieu. » Jésus ne dévoile pas le péché des personnes. Mais un jour, face au jugement individuel, tout sera dévoilé sans que nous puissions condamner les autres puisque notre propre péché sera à nu.
-
Bruxelles, ce 27 février : accompagner un enfant en fin de vie (témoignage de Brigitte Terlinden, infirmière pédiatrique en soins palliatifs)
-
Entretien exclusif avec un chartreux sur les abus spirituels
Qu’est-ce qu’un abus spirituel ? Comment le déceler ? Comment l’Église réagit ? Dom Dysmas de Lassus, prieur de la Grande Chartreuse, a enquêté durant quatre ans sur un fléau qui peut conduire « à des drames inouïs ». Entretien de Samuel Pruvot et Hugues Fefèbvre publié sur le site de l’hebdomadaire « Famille Chrétienne » :
« Pourquoi avoir travaillé durant quatre années sur le drame des abus spirituel ?
Avant tout, je peux dire franchement que j’ai trouvé dans la vie religieuse plus de bonheur que je n’aurais pu en rêver. Et ce n’est pas fini ! Je ne dis pas pour autant que c’est facile. Des accidents, il y en a toujours, mais ce n’est pas en fermant les yeux qu’on va les éviter. Prenons l’exemple de l’avion. Les accidents d’avion frappent par leur ampleur. Pourtant, c’est le moyen de transport le plus sécurisé. Cette sécurité, l’avion l’a conquise à force de persévérance. Chaque accident grave a donné lieu à une enquête approfondie afin de trou-ver la cause exacte du drame pour éviter qu’il ne se reproduise.
Enquêter pour guérir, c’est donc l’objet de votre travail...
Ce qui a motivé mon enquête, c’est la rencontre avec plusieurs personnes abîmées par des abus spirituels. C’est quand même dramatique d’entendre des religieuses qui avaient embrassé cette vie avec générosité et qui sont devenues incapables de prier ! Chaque cas est unique, mais j’ai été étonné de constater la cohérence de tous ces témoignages entre eux. Par ailleurs, je crois qu’on ne peut plus taire ces situations ! Pour les fidèles, le fait d’avoir caché des abus est peut-être un scandale plus grand encore que les abus eux-mêmes. L’attitude de l’Église visant à écouter les victimes et à les mettre au centre est quelque chose de nouveau.
Je crois qu’on ne peut plus taire ces situations !

Dom Dysmas
Vraiment ? De quand datez-vous ce tournant ?
L’Église a changé en 2019, en France. C’est moins évident dans d’autres pays comme les États-Unis. Là-bas, on ne veut plus d’ennuis, donc il ne faut plus de victimes. Mais est-ce bien à elles qu’on pense en premier ? Pour revenir à la France, dans le cadre des abus sexuels, beaucoup d’études sont parues sur le sujet. Ensuite, plusieurs événements ont poussé l’Église à enfin réagir. Le procès Barbarin, pour lamentable qu’il ait été par certains côtés, aura eu un effet considérable. À cette occasion, tout comme lors de la réunion des évêques de France à Lourdes fin 2018 ou bien lors du sommet à Rome sur les abus en 2019, les participants ont toujours dit que ce qui avait changé leur regard était d’avoir pu entendre directe-ment des victimes.
Soyons francs : s’il n’y avait pas eu tout ce processus de révélations fracassantes et humiliantes pour l’Église, nous serions encore dans la boue, et les abus auraient continué. Ce qui est un peu triste, c’est que l’Église n’a pas été capable de faire le travail toute seule et qu’il a fallu que des journalistes, ou parfois des personnes malveillantes, fassent ce boulot. Ce n’était pas la meilleure manière de faire. Mais elle a permis une rupture. L’Église a réagi alors sur la question des abus sexuels. Je considère même qu’on peut être fier d’elle, aujourd’hui, non pas sur ce passé évidemment, mais sur la manière dont désormais les choses sont traitées. Le même travail reste encore à faire sur la question des abus spirituels.
-
Rwanda : une centaine de personnes rendent hommage au chanteur dissident Kizito Mihigo à Bruxelles
Lu sur le site de la Libre Afrique :
 « Une centaine de personnes ont rendu samedi dernier un dernier hommage au chanteur et dissident rwandais Kizito Mihigo, devant le palais de justice de Bruxelles, place Poelaert. L’artiste, dont la musique a été interdite par le pouvoir, a été retrouvé mort lundi matin dans une cellule du poste de police de Remera, à Kigali, trois jours après avoir tenté de fuir le pays.
« Une centaine de personnes ont rendu samedi dernier un dernier hommage au chanteur et dissident rwandais Kizito Mihigo, devant le palais de justice de Bruxelles, place Poelaert. L’artiste, dont la musique a été interdite par le pouvoir, a été retrouvé mort lundi matin dans une cellule du poste de police de Remera, à Kigali, trois jours après avoir tenté de fuir le pays.La police nationale rwandaise a attribué ce décès à un suicide, soulevant de nombreuses questions au Rwanda. Critique du régime de Paul Kagame, Kizito Mihigo avait été condamné à 10 ans de prison en 2015 pour conspiration contre le gouvernement, avant d’être remis en liberté en septembre 2018. Durant son procès, ses avocats avaient souligné qu’il n’y avait aucune preuve contre le chanteur. En 2014, ce dernier avait déjà été accusé de mobiliser des jeunes en faveur des mouvements rebelles en exil.
La Société Civile Rwandaise en Belgique a organisé à Bruxelles des événements tout au long de la journée de samedi pour rendre hommage au chanteur militant. Une messe s’est tenue ainsi à 12h00 en l’église Saint-Roch, dans le quartier Nord. Après cet hommage religieux, une commémoration publique est organisée à 14h00 au Passage 44, boulevard du Botanique. À 16h00, les participants ont eu l’occasion de débattre sur la lutte contre l’impunité au Rwanda.
En 2013, Kizito Mihigo questionnait en chanson la version officielle du génocide qui a opposé Hutu et Tutsi en 1994. »
Ref. une centaine de personnes rendent hommage au chanteur dissident Kizito Mihigo à Bruxelles
Kizito Mihigo : un chrétien rwandais qui était aussi musicien de talent :
JPSC
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Culture, Ethique, Foi, International, Politique, Société, Solidarité, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -
Avorter ne relève pas d'une juste conception de la liberté
De Sandro Magister (Settimo Cielo) en traduction française sur Diakonos.be :
Éloge de la liberté, la vraie. Dialogue entre un cardinal et un penseur laïc
L’explosion des désirs individuels que l’on érige en droits pour tous fait désormais partie de notre quotidien, en Occident et ailleurs. Sans plus aucune de limite. Cela touche à la naissance et à la mort, aux techniques et à l’environnement, à la politique et aux migrations, à la nature même de l’homme, en somme. Mais s’agit-il vraiment d’un triomphe de la liberté ou plutôt d’une dictature aux dépens des plus faibles ? Et quelle est alors cette autre liberté, celle qui se nourrit de la vérité et qui ne peut subsister sans elle ?
À 89 ans, le cardinal Camillo Ruini, qui a mené une longue vie de pasteur et de philosophe, en discute avec Gaetano Quaglieriello, sénateur italien, professeur d’histoire contemporaine à la Libre université internationale des études sociales de Rome et président de la Fondation Magna Carta, dans un livre lucide et passionné, qui est en vente depuis le 20 février en Italie :
Nous vous en proposons un avant-goût ci-dessous. Dans ces trois passages, le cardinal Ruini aborde la question de l’avortement volontaire.
Tout d’abord en tant que donnée factuelle, puis en analysant ce phénomène à la lumière de la raison seule et enfin avec une attention particulière à l’enseignement de l’Église qui culmine dans la déclaration « infaillible et irréformable » de Jean-Paul II dans l’encyclique « Evangelium vitae », une encyclique qui « semble être avoir été écrite aujourd’hui », tant ses prédictions se sont avérées exactes mais que trop de personnes – note le cardinal – semblent avoir mise de côté.
*
L’avortement, miroir de la crise de l’Occident
de Camillo Ruini
(extrait de : « Un’altra libertà. Contro i nuovi profeti del ‘paradiso in terra’»)
1. Le courage de l’appeler “homicide”
Dans les cas qui concernent le début de la vie, la revendication de la liberté individuelle est hors de propos, parce que l’on décide non pas de soi-même mais bien d’un autre, l’enfant à naître, à moins de penser que cet enfant à naître ne fasse tout simplement partie du corps de la mère : une absurdité indéfendable puisqu’il dispose de son propre ADN, d’un développement spécifique et qu’il interagit avec la mère, comme cela apparaît toujours plus clairement.
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Idées, Politique, Société 1 commentaire -
Les responsables de l’Arche déterminés à revisiter l’histoire de la communauté depuis son origine
De Philippe Oswald sur la Sélection du Jour :
Un douloureux retour sur la personnalité de Jean Vanier
Nous avions consacré au fondateur de la communauté de l’Arche une « sélection du jour » (LSDJ n°645) à l’occasion de son décès, dans sa 91e année, le 7 mai 2019. Dans cet article, nous relevions le contraste entre la personnalité de ce laïc, ancien officier de marine, reconnu dans le monde entier (prix Templeton, commandeur de la Légion d’honneur) pour son œuvre au service des personnes handicapées, et son mentor, le père Thomas Philippe, un dominicain qui jouera un grand rôle dans sa vie et dans la fondation de l’Arche, association regroupant aujourd’hui 154 communautés réparties dans 38 pays. Nous écrivions notamment que « l’innocence » de Jean Vanier « aura été soumise à rude épreuve » par les révélations en 2015 d'abus sexuels dont des femmes accusaient le dominicain, un demi-siècle après qu’un procès canonique resté secret l’avait déjà privé du droit d'enseigner, d'exercer tout ministère et d'administrer les sacrements pour des motifs similaires, ce qui laisse ouverte la question de « l’oubli » de cette sanction des années plus tard.
Or voici qu’un communiqué de l’Arche (22 février) sur les conclusions d’une enquête indépendante mandatée par les responsables de la communauté, met à mal cette « innocence » du fondateur de l’Arche. Résumée dans un article de La Vie (22 février), cette enquête révèle que Jean Vanier, « non seulement […] avait bien connaissance des abus perpétrés par son père spirituel, Thomas Philippe, dans les années 1950-1970, mais a lui-même agressé sexuellement des femmes en accompagnement spirituel à cette époque et jusqu'en 2005 ». Une première femme avait témoigné contre lui en 2016. « Jean a reconnu à l'époque ce qu'il voyait comme une relation réciproque », a déclaré Stephan Posner, responsable international du mouvement, en présentant les résultats de l’enquête. « Il a demandé pardon à cette femme, qui lui en a été reconnaissante. » Mais un nouveau témoignage d’une femme en mars 2019 a relancé l’enquête, alors confiée à un organisme britannique spécialisé dans le conseil pour la protection contre l'exploitation et l'abus sexuel, et soumise à l’évaluation d’un comité de surveillance composé de deux anciens haut-fonctionnaires français sans lien avec l’Arche. Ensuite, quatre autres femmes se sont manifestées. Au total, les enquêteurs ont recueilli les témoignages concordants de six femmes adultes et non handicapées, célibataires, mariées ou consacrées, n’ayant pas de liens entre elles et ne connaissant pas leurs histoires respectives, concernant des abus dont elles se disent victimes sur la période 1970-2005. Toutes indiquent que Jean Vanier aurait initié avec elles des relations sexuelles, généralement dans le cadre d’un accompagnement spirituel : « Toutes ont décrit comment ce comportement a eu, par la suite, un impact de longue durée et négatif sur leur vie personnelle et sur leurs relations interpersonnelles et conjugales » lit-on dans le communiqué de l'Arche. Les investigations se poursuivent avec l’apport des archives que les dominicains ont ouvertes aux enquêteurs, et de la correspondance entre Jean Vanier et son père spirituel Thomas Philippe. L’Arche a confié ces documents à l'historien Antoine Mourges pour qu’il approfondisse l’analyse sur la relation entre les deux hommes. Dans un communiqué du Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France publié ce 22 février, les évêques dénoncent un « comportement mêlant emprise spirituelle et abus sexuel dans la suite de la relation spirituelle que Jean Vanier a eue avec le père Thomas Philippe, dominicain, et sous l’influence des doctrines perverses de ce dernier ».
Surmontant la sidération qui les a saisis, les actuels responsables de l’Arche à l’origine de cette vaste enquête sont résolus à la poursuivre jusqu’au bout : c’est toute l’histoire de la communauté qu’il faut revisiter depuis son origine. Aussi douloureuse soit-elle, cette investigation ne peut être que salutaire. Elle s’insère dans le mouvement de vérité sur soixante-dix ans de la vie de l’Eglise entrepris par le pape Benoît XVI (qui avait révélé en 2010 le scandale touchant les Légionnaires du Christ en condamnant son fondateur, Martial Maciel Degollado), et poursuivi aujourd’hui par le pape François. Le souverain pontife a d’ailleurs reçu au début de ce mois les responsables de l’Arche pour les encourager à « faire toute la vérité ». Dans un entretien à KTO (en lien ci-dessous, vidéo de 30’) Stephan Posner, responsable de l’Arche international, explique en détail les motifs, les circonstances et les premières conclusions de cette enquête qui a déjà conduit à entreprendre la réécriture de la charte de l'Arche.
Philippe Oswald
L'Arche révèle que Jean Vanier a commis des abus >>> Voir sur : KTO
-
La face cachée de Jean Vanier : des révélations attristantes
-
Le secret pontifical existe-t-il encore ?
De sur Smart Reading Press :
LE SECRET PONTIFICAL EXISTE-T-IL ENCORE ?

La décision a été qualifiée d’«historique» par certains médias annonçant que, par le biais de deux rescrits publiés 17 décembre 2019 et s’appliquant depuis le 1er janvier 2020, le Souverain Pontife avait «aboli» le secret pontifical. À lire cette presse, le secret pontifical n’existerait plus dans aucun domaine ni pour aucune compétence de l’Église. En est-on si sûr ?
Regardons de plus près les deux rescrits que le pape François a fait publier le 17 décembre 2019 dans le journal L’Osservatore Romano et dans le journal officiel du Saint-Siège, les Acta Apostolicæ Sedis. Ils sont d’une grande importance1 : l’un signé en date du 6 décembre 2019 sur la «confidentialité des causes» pénales canoniques, l’autre signé en date du 3 décembre de la même année sur «la détention d’images pédopornographiques2». Tous deux visent l’abolition du secret pontifical (dans certaines conditions) et s’appliquent depuis le 1er janvier 2020. Ils répondent à des inquiétudes adressées à la Curie romaine sur les problèmes dits de «pédophilie» qui font scandale dans l’Église et dans la société.
En d’autres termes, pour les affaires d’agressions sexuelles sur des mineurs ou sur des majeurs «vulnérables» commises par un membre du clergé, tout doit semble-t-il être dévoilé, toujours selon la presse, de ce qui relève d’un procès canonique à ce sujet, avec les décisions qui peuvent en découler. C’est ainsi que l’on voudrait interpréter la pensée pontificale pour ces tristes cas, qui ne sont tout de même pas légion chez les ecclésiastiques, même si ce sont à chaque fois des actes odieux et regrettables, souvent mal gérés par les pasteurs, et qui choquent3. Actes qu’il faut, certes, corriger sans anti-juridisme, mais selon la loi canonique et dans le respect des lois civiles propres à chaque pays.
Que faut-il en penser, et pouvons-nous suggérer quelques observations sur ce sujet hautement sensible ? Après avoir situé la portée exacte du secret pontifical, qui n’a rien d’une dissimulation dommageable en soi (I), notons les délits exclus du secret pontifical (II) et mesurons ce qui ne devrait pas être source d’iniquité en l’espèce, dans le sens où tout ne peut pas être révélé (III).
-
Euthanasie : une offensive généralisée en Europe
De Pauline Quillon sur le site de Famille Chrétienne :
Offensive du lobby pro-euthanasie en Europe
20/02/2020
MAGAZINE – Jusqu’à quand ? Les digues qui protègent l’interdit de tuer céderont-elles dans les pays latins où les militants pro-euthanasie insistent et réinsistent ? En Espagne, le 11 février, date de la Journée mondiale des malades, la Chambre des députés a donné son accord pour porter au calendrier législatif un projet de loi sur le droit à l’aide à mourir – euthanasie et suicide assisté. Les socialistes, porteurs du projet, avaient déjà fait deux tentatives infructueuses. Une première barrière a donc été franchie au-delà des Pyrénées. En Italie, l’idée fait aussi son macabre chemin. Le 12 février, le Conseil de l’ordre des médecins a décidé de supprimer les sanctions disciplinaires à l’encontre des médecins qui pratiquent « l’aide médicale à mourir ». Il affirme s’aligner sur le code pénal, la Cour constitutionnelle ayant posé en septembre que « le suicide assisté pouvait être licite ».
Au Portugal, également, un projet de loi en faveur de la dépénalisation de l’euthanasie, bloqué en 2018, revient au parlement de Lisbonne le 20 février. En France, enfin, le lobby pro-euthanasie est actif et influent. Le groupe d’étude sur la fin de vie de l’Assemblée nationale, présidé par Jean-Louis Touraine, ouvertement pro-euthanasie, a auditionné le 12 février Jean-Luc Romero, président de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité. Ce dernier a avancé lors d’une réunion publique à Périgueux que Jean-Louis Touraine déposerait une proposition en ce sens dans les prochaines semaines.
▶︎ À LIRE AUSSI Euthanasie : les Pays-Bas introduiront-ils la notion de « vie accomplie » ?