De Mario Tosatti (San Pietro e dintorni), traduit sur le site "Benoît et moi" :
GÄNSWEIN, LE PAPE ET L'EGLISE. SUR TOUS LES SUJETS
Georg Gänswein, secrétaire du pape Benoît XVI et préfet de la Maison pontificale, a donné ces jours-ci une longue interview à la Schwäbische Zeitung, dans laquelle avec beaucoup de franchise il a parlé de lui-même, du Pontife régnant et de l'Eglise allemande (cf. l'original en allemand).
Le fait d'avoir été secrétaire de Benoît XVI, et son travail précédent à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi représentent «une marque de Caïn» aux yeux de beaucoup dans l'Eglise en Allemagne. Ce qui rend improbable qu'il puisse retourner en Allemagne comme évêque. Dans les diocèses allemands, le chapitre de la cathédrale joue un rôle important dans la sélection des candidats, et en général, a déclaré Gänswein, les membres ne sont pas connus pour «avoir la plus grande fidélité à Rome». Et de toute façon, il n'a pas «l'ambition de devenir un évêque diocésain».
Quoi qu'il en soit, dit-il, l'Eglise allemande a un gros problème, et c'est l'argent. La loi allemande donne à l'Eglise un pourcentage sur les impôts payés. Cela fait de l'Eglise allemande un organisme très riche, et le deuxième plus grand employeur après l'Etat.
Mais si vous choisissez de ne pas plus être enregistré comme catholique, vous êtes exclu. «Oui, c'est un problème sérieux. L'Eglise réagit par l'expulsion automatique de la communauté, en d'autres termes, l'excommunication! C'est excessif, incompréhensible. Si vous mettez en cause un dogme, personne ne s'en soucie, ils ne vous chassent pas. Le non-paiement de la taxe à l'Eglise est-elle une offense plus grande à la foi que la violation des principes de Foi?».
Et il a poursuivi: "Les caisses sont pleines et les églises vides, ce fossé est terrible, et cela ne pourra pas continuer longtemps de la sorte. Si les caisses se remplissent et les bancs se vident, il y aura un jour une implosion. Une église vide ne peut pas être prise au sérieux». Et «l'effet François» que quelque évêque allemand avait prédit en Allemagne après l'élection «ne semble pas s'être réalisé».
Sur les controverses qui ont suivi l'exhortation apostolique "Amoris Laetitia", notamment en ce qui concerne la possibilité pour les divorcés-remariés d'être admis aux sacrements, Gänswein a dit: «Si un pape veut changer un aspect de la doctrine, il doit le faire avec clarté, pour le rendre obligatoire. Des principes magistériels importants ne peuvent pas être modifiés par des demi-phrases ou des notes de bas de page de façon quelque peu ambiguë. Les déclarations qui peuvent être interprétées de différentes manières sont une chose risquée».
Sur le rapport des fidèles, en particulier ceux qui sont les plus conservateurs, avec le Pontife actuel, il a dit: «La certitude que le Pape, comme un roc face aux vagues, était la dernière ancre, est en effet en train de se dissoudre. Si cette perception correspond à la réalité et reflète correctement l'image de François, ou bien si c'est une image médiatique, je ne peux pas en juger. Mais les absences de certitude et parfois même la confusion et le désordre ont augmenté ... il y a un court-circuit entre la réalité des médias et la réalité des faits».
Mgr Gänswein a répondu à une question sur la façon de communiquer le Pontife, et il a admis que «dans le discours, parfois, en comparaison de ses prédécesseurs, il est un peu imprécis, voire incorrect,simplement il faut l'accepter. Chaque pape a son style personnel. C'est sa façon de parler, même avec le risque de conduire à des malentendus, et parfois même des interprétations extravagantes. Mais il continuera à parler sans langue de bois».
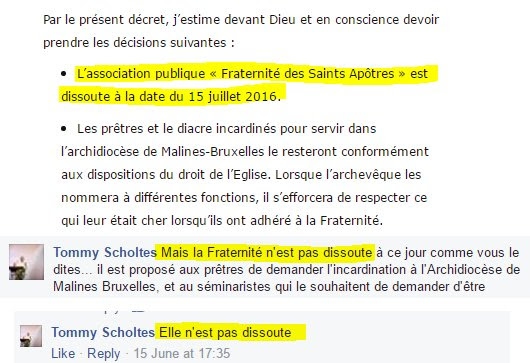
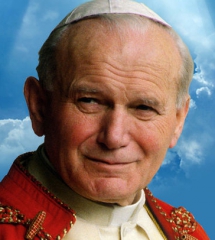 « Comment un religieux, devenu SDF, errant dans les rues de Rome fut sauvé en entendant la confession du saint Pape polonais. Nous vous en avions déjà parlé il y a quelques mois, à l’occasion des 24 heures avec le Seigneur nous vous proposons de vous replonger dans cette histoire bouleversante.
« Comment un religieux, devenu SDF, errant dans les rues de Rome fut sauvé en entendant la confession du saint Pape polonais. Nous vous en avions déjà parlé il y a quelques mois, à l’occasion des 24 heures avec le Seigneur nous vous proposons de vous replonger dans cette histoire bouleversante.
