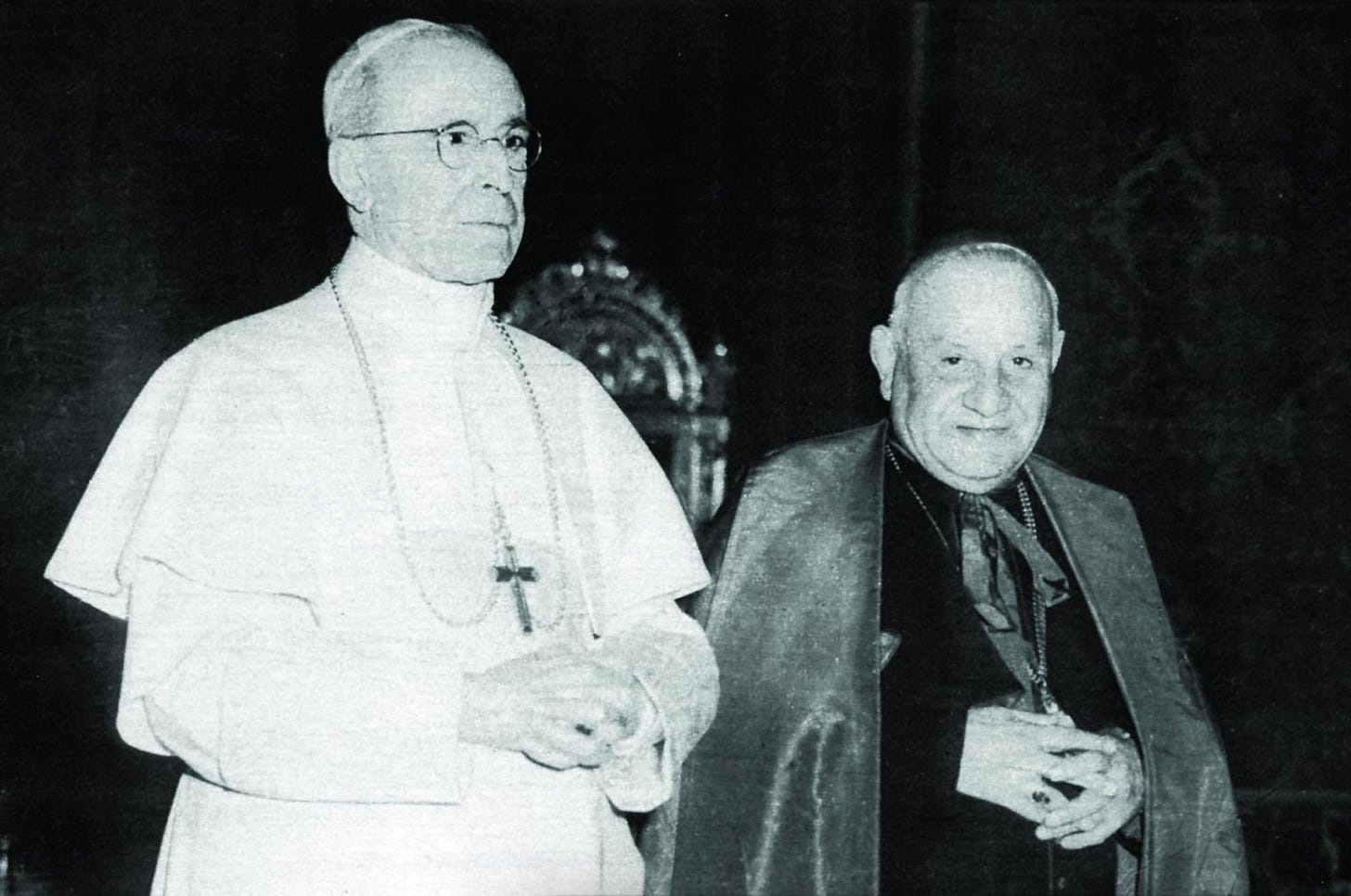Commençons par le signe de la croix, car nous sommes tous ici parce que le Christ, qui est mort et ressuscité, nous a donné la vie et nous a appelés à servir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous !
Chers frères dans le sacerdoce,
Chers formateurs, séminaristes, animateurs de services de vocations, amis dans le Seigneur !
C'est pour moi une grande joie d'être ici aujourd'hui avec vous. Au cœur de l'Année Sainte, nous voulons témoigner ensemble qu'il est possible d'être des prêtres heureux, car le Christ nous a appelés, le Christ a fait de nous ses amis (cf. Jn 15, 15) : c'est une grâce que nous voulons accueillir avec gratitude et responsabilité.
Je tiens à remercier le cardinal Lazzaro et tous les collaborateurs du Dicastère pour le clergé pour leur service généreux et compétent : un travail vaste et précieux, qui se déroule souvent dans le silence et la discrétion et qui produit des fruits de communion, de formation et de renouveau.
Grâce à ce moment d'échange fraternel, un échange international, nous pouvons valoriser le patrimoine d'expériences déjà acquises, en encourageant la créativité, la coresponsabilité et la communion dans l'Église, afin que ce qui est semé avec dévouement et générosité dans tant de communautés puisse devenir lumière et stimulant pour tous.
Les paroles de Jésus « Je vous ai appelés amis » (Jn 15, 15) ne sont pas seulement une déclaration affectueuse envers les disciples, mais une véritable clé de compréhension du ministère sacerdotal. Le prêtre, en effet, est un ami du Seigneur, appelé à vivre avec Lui une relation personnelle et confiante, nourrie par la Parole, par la célébration des sacrements, la prière quotidienne. Cette amitié avec le Christ est le fondement spirituel du ministère ordonné, le sens de notre célibat et l'énergie du service ecclésial auquel nous consacrons notre vie. Elle nous soutient dans les moments d'épreuve et nous permet de renouveler chaque jour le « oui » prononcé au début de notre vocation.
En particulier, très chers amis, je voudrais tirer de ce mot-clé trois implications pour la formation au ministère sacerdotal.
Tout d'abord, la formation est un cheminement relationnel. Devenir amis du Christ, c'est être formés dans la relation, et pas seulement dans les compétences. La formation sacerdotale ne peut donc se réduire à l'acquisition de notions, mais elle est un cheminement de familiarité avec le Seigneur qui engage toute la personne, le cœur, l'intelligence, la liberté, et la façonne à l'image du Bon Pasteur. Seul celui qui vit en amitié avec le Christ et est imprégné de son Esprit peut annoncer avec authenticité, consoler avec compassion et guider avec sagesse. Cela exige une écoute profonde, la méditation et une vie intérieure riche et ordonnée.
Deuxièmement, la fraternité est un style essentiel de la vie presbytérale. Devenir amis du Christ implique de vivre comme des frères entre prêtres et entre évêques, et non comme des concurrents ou des individualistes. La formation doit donc aider à construire des liens solides au sein du presbytérium, comme expression d'une Église synodale, dans laquelle on grandit ensemble en partageant les peines et les joies du ministère. En effet, comment pourrions-nous, ministres, être des bâtisseurs de communautés vivantes, si une fraternité effective et sincère ne régnait pas d'abord entre nous ?
De plus, former des prêtres amis du Christ, c'est former des hommes capables d'aimer, d'écouter, de prier et de servir ensemble. C'est pourquoi il faut veiller avec soin à la préparation des formateurs, car l'efficacité de leur travail dépend avant tout de l'exemple de leur vie et de la communion entre eux. L'institution même des séminaires nous rappelle que la formation des futurs ministres ordonnés ne peut se faire de manière isolée, mais exige l'engagement de tous les amis du Seigneur qui vivent en disciples missionnaires au service du Peuple de Dieu.
À ce sujet, je voudrais dire quelques mots sur les vocations. Malgré les signes de crise qui traversent la vie et la mission des prêtres, Dieu continue d'appeler et reste fidèle à ses promesses. Il faut qu'il y ait des espaces adéquats pour écouter sa voix. C'est pourquoi il est important d'avoir des environnements et des formes de pastorale des jeunes imprégnés de l'Évangile, où les vocations au don total de soi puissent se manifester et mûrir. Ayez le courage de faire des propositions fortes et libératrices ! En regardant les jeunes qui, en ces temps qui sont les nôtres, disent avec générosité « me voici » au Seigneur, nous ressentons tous le besoin de renouveler notre « oui », de redécouvrir la beauté d'être des disciples missionnaires à la suite du Christ, le Bon Pasteur.
Très chers amis, célébrons cette rencontre à la veille de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus : c'est de ce « buisson ardent » que prend son origine notre vocation ; c'est de cette source de grâce que nous voulons nous laisser transformer.
L'encyclique du pape François Dilexit nos, si elle est un don précieux pour toute l'Église, elle l'est tout particulièrement pour nous, prêtres. Elle nous interpelle fortement : elle nous demande de concilier mystique et engagement social, contemplation et action, silence et annonce. Notre époque nous interpelle : beaucoup semblent s'être éloignés de la foi, et pourtant, au fond de beaucoup de personnes, surtout des jeunes, il y a une soif d'infini et de salut. Beaucoup font l'expérience d'une absence de Dieu, et pourtant chaque être humain est fait pour Lui, et le dessein du Père est de faire du Christ le cœur du monde.
C'est pourquoi nous voulons retrouver ensemble l'élan missionnaire. Une mission qui propose avec courage et amour l'Évangile de Jésus. Par notre action pastorale, c'est le Seigneur lui-même qui prend soin de son troupeau, rassemble ceux qui sont dispersés, se penche sur ceux qui sont blessés, soutient ceux qui sont découragés. En imitant l'exemple du Maître, nous grandissons dans la foi et devenons ainsi des témoins crédibles de la vocation que nous avons reçue. Quand quelqu'un croit, cela se voit : le bonheur du ministre reflète sa rencontre avec le Christ, qui le soutient dans sa mission et son service.
Chers frères dans le sacerdoce, merci d'être venus de loin ! Merci à chacun pour son dévouement quotidien, en particulier dans les lieux de formation, dans les périphéries existentielles et dans les lieux difficiles, parfois dangereux. Alors que nous nous souvenons des prêtres qui ont donné leur vie, parfois jusqu'au sang, nous renouvelons aujourd'hui notre disponibilité à vivre sans réserve un apostolat de compassion et de joie.
Merci pour ce que vous êtes ! Parce que vous rappelez à tous qu'il est beau d'être prêtre, et que tout appel du Seigneur est avant tout un appel à sa joie. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes amis du Christ, frères entre nous et fils de sa tendre Mère Marie, et cela nous suffit.
Tournons-nous vers le Seigneur Jésus, vers son Cœur miséricordieux qui brûle d'amour pour chaque personne. Demandons-lui la grâce d'être des disciples missionnaires et des pasteurs selon sa volonté : en cherchant ceux qui sont perdus, en servant les pauvres, en guidant avec humilité ceux qui nous sont confiés. Que son Cœur inspire nos projets, transforme nos cœurs et nous renouvelle dans la mission. Je vous bénis avec affection et je prie pour vous tous.