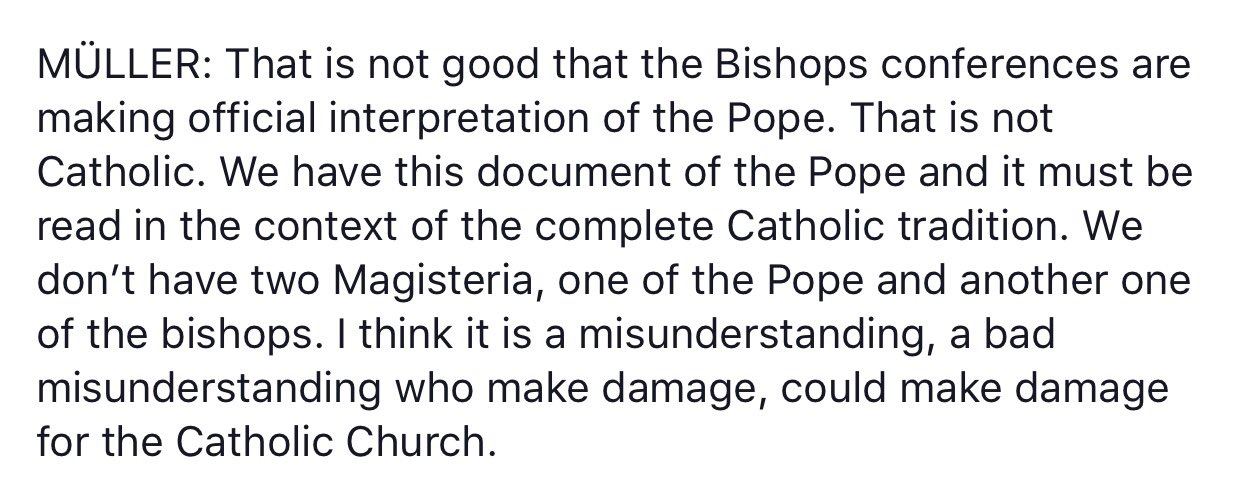« Voilà ce que je voudrais dire aux jeunes prêtres : vous êtes choisis, vous êtes chers au Seigneur ! Dieu vous regarde avec la tendresse d’un Père et, après avoir permis que vos cœurs soient amoureux, il ne laissera pas vaciller vos pas » : c’est aux jeunes prêtres que le pape François a choisi de s’adresser surtout, dans son audience accordée aux participants à l’assemblée plénière de la Congrégation pour le clergé, ce jeudi 1er juin 2017, au Vatican.
Les jeunes sont capables de « se mettre en jeu avec générosité », a souligné le pape, encourageant les jeunes prêtres à « être créatifs dans l’évangélisation », à s’impliquer « avec discernement » dans les « nouveaux lieux de la communication » et à « rester en réseau » entre eux.
Rappelant que le prêtre est un « disciple missionnaire en formation permanente », comme l’indique la Ratio Fundamentalis – le document élaboré en décembre 2016 par le dicastère, pour la formation des futurs prêtres – le pape a souligné trois « comportements importants » : prier sans se lasser, sinon « notre pêche ne pourra pas avoir de succès » ; marcher toujours, car « un prêtre n’est jamais ‘arrivé’ » et partager avec son cœur car « les jeunes n’ont pas besoin d’un professionnel du sacré ni d’un héros » mais de quelqu’un qui « sait s’impliquer sincèrement dans leur vie ».
Le pape s’est aussi adressé aux évêques, leur demandant de ne pas remplir les séminaires « avec des personnes qui n’ont pas été appelées par le Seigneur » : « Accueillir uniquement parce que nous avons besoin », leur a-t-il dit, « c’est une hypothèque pour l’Église ! ». De même, il les a exhortés à être proches des prêtres, affirmant qu’ « on ne peut pas gouverner un diocèse sans proximité, on ne peut pas faire grandir et sanctifier un prêtre sans la proximité paternelle de l’évêque ».
Voici notre traduction intégrale du discours qu’il leur a adressé.
CR
Discours du pape François
Messieurs les cardinaux,
Chers frères et sœurs,
Je vous adresse à tous mes salutations cordiales et je vous exprime ma gratitude pour votre généreux engagement au service des prêtres et de leur formation. Je remercie de tout cœur le cardinal Beniamino Stella pour ses paroles et pour tout le travail qu’il effectue.
Je me réjouis de pouvoir dialoguer avec vous sur le grand don du ministère ordonné, à quelques mois de la promulgation de la nouvelle Ratio Fundamentalis. Ce document parle d’une formation intégrale, c’est-à-dire capable d’inclure tous les aspects de la vie ; et il indique ainsi la voie pour former le disciple missionnaire. Une route fascinante et en même temps exigeante.
En réfléchissant à ces deux aspects – la fascination de l’appel et les exigences importantes qu’elle comporte – j’ai pensé en particulier aux jeunes prêtres qui vivent la joie des débuts du ministère et qui, en même temps, en perçoivent le poids. Le cœur d’une jeune prêtre vit entre l’enthousiasme des premiers projets et l’anxiété des efforts apostoliques, dans lesquels il s’immerge avec une certaine crainte, qui est signe de sagesse. Il sent profondément la joie et la force de l’onction reçue, mais ses épaules commencent à être progressivement chargées du poids de la responsabilité, des nombreux engagements pastoraux et des attentes du peuple de Dieu.
Comment un jeune prêtre vit-il tout cela ? Que porte-t-il dans son cœur ? De quoi a-t-il besoin pour que ses pieds, qui courent apporter la joyeuse annonce de l’Évangile, ne se paralysent pas devant les peurs et les premières difficultés, pour qu’il n’ait pas, ne suive pas la tentation de se réfugier dans la rigidité ou de tout laisser et d’être un « perdu » ?
Il faut admettre que, souvent, les jeunes sont jugés de façon un peu superficielle et ils sont trop facilement étiquetés comme génération « liquide », privée de passions et d’idéaux. Certes, il y a des jeunes fragiles, désorientés, fragmentés ou contaminés par la culture du consumérisme et de l’individualisme. Mais cela ne doit pas nous empêcher de reconnaître que les jeunes sont capables de miser « fermement » sur la vie et de se mettre en jeu avec générosité, de diriger leur regard vers l’avenir et d’être, ainsi, un antidote par rapport à la résignation et à la perte d’espérance qui marque notre société, d’être créatifs et imaginatifs, courageux pour changer, magnanimes quand il s’agit de se dépenser pour les autres ou pour des idéaux comme la solidarité, la justice et la paix. Avec toutes leurs limites, ils sont toujours une ressource.
Nous pouvons alors nous demander : parmi nos prêtres, comment regardons-nous les jeunes prêtres ? Laissons-nous avant tout éclairer par la Parole de Dieu, qui nous montre que le Seigneur appelle les jeunes, leur fait confiance et les envoie pour la mission.
Tandis que « la parole du Seigneur était rare en ces jours-là » (1 Sam 3,1), parce que le peuple s’était perverti et n’écoutait plus la voix du Seigneur, Dieu s’adresse au jeune Samuel, un petit « servant de messe » qui devient prophète pour le peuple (cf. 1 Sam 3,1-10). Puis le regard du Seigneur, dépassant les apparences, choisit David, le plus petit des fils de Jessé et il l’oint roi d’Israël (cf. 1 Sam 16,1-13). À Jérémie, préoccupé d’être trop jeune pour la mission, le Seigneur offre ses propos rassurants et paternels : « Ne dis pas : ‘Je suis un enfant’ […] parce que je suis avec toi » (Jér 1,7-8). Des Évangiles aussi, nous pouvons apprendre que le choix du Seigneur retombe sur les petits et la mission d’annoncer l’Évangile, confiée aux disciples, ne se base pas sur la grandeur des forces humaines, mais sur la disponibilité à se laisser guider par le don de l’Esprit.
Voilà ce que je voudrais dire aux jeunes prêtres : vous êtes choisis, vous êtes chers au Seigneur ! Dieu vous regarde avec la tendresse d’un Père et, après avoir permis que vos cœurs soient amoureux, il ne laissera pas vaciller vos pas. À ses yeux vous êtes importants et il est convaincu que vous serez à la hauteur de la mission à laquelle il vous a appelés. Comme il est important que les jeunes prêtres trouvent des curés et des évêques qui les encouragent dans cette perspective et qui ne les attendent pas seulement parce qu’il est nécessaire de changer et de remplir des places vides !
À ce sujet, je voudrais dire deux choses spontanément. Des places vides : ne remplissez pas ces places avec des personnes qui n’ont pas été appelées par le Seigneur, ne prenez pas n’importe où, examinez bien la vocation d’un jeune, l’authenticité, et s’il vient pour se réfugier ou bien parce qu’il sent l’appel du Seigneur. Accueillir uniquement parce que nous avons besoin, chers évêques, c’est une hypothèque pour l’Église ! Une hypothèque.
Deuxièmement : ne les laissez pas seuls. La proximité : les évêques, proches des prêtres, les évêques, proches des prêtres. Combien de fois ai-je entendu les plaintes de prêtres… Ceci, je l’ai souvent dit – peut-être l’aurez-vous entendu – : j’ai appelé l’évêque, il n’était pas là et la secrétaire m’a dit qu’il n’était pas là, j’ai demandé un rendez-vous : « Tout est plein pour trois mois… ». Et ce prêtre reste loin de son évêque. Mais si toi, évêque, tu sais que dans la liste des appels que te laisse ton secrétaire ou ta secrétaire, un prêtre a appelé et que ton agenda est plein, ce jour-même, le soir ou le lendemain – pas plus tard – rappelle-le au téléphone et dis-lui comment sont les choses, évaluez ensemble, si c’est urgent, pas urgent… Mais l’important est que ce prêtre sentira qu’il a un père, un père proche. Proximité. Proximité à l’égard des prêtres. On ne peut pas gouverner un diocèse sans proximité, on ne peut pas faire grandir et sanctifier un prêtre sans la proximité paternelle de l’évêque.
Je me réjouis toujours quand je rencontre des jeunes prêtres, parce qu’en eux je vois la jeunesse de l’Église. C’est pourquoi, en pensant à la nouvelle Ratio, qui parle du prêtre comme d’un disciple missionnaire en formation permanente (cf. n.3), je désire souligner, surtout pour les prêtres jeunes, certains comportements importants : prier sans se lasser, marcher toujours et partager avec son cœur.
Prier sans se lasser. Parce que nous pouvons être des « pêcheurs d’hommes » uniquement si nous, les premiers, nous reconnaissons que nous avons été « pêchés » par la tendresse du Seigneur. Notre vocation a commencé quand, ayant abandonné la terre de notre individualisme et de nos projets personnels, nous nous sommes mis en marche pour le « saint voyage » en nous remettant à cet Amour qui nous a cherchés dans la nuit et à cette Voix qui a fait vibrer notre cœur. Ainsi, comme les pêcheurs de Galilée, nous avons laissé nos filets pour saisir ceux que nous a confiés le Maître. Si nous ne restons pas étroitement liés à lui, notre pêche ne pourra pas avoir de succès. Prier toujours, j’insiste !
Pendant les années de formation, les horaires de nos journées étaient rythmés de manière à nous laisser le temps nécessaire pour la prière ; après, on ne peut pas avoir tout ainsi planifié – la vie est autre chose – tout est organisé, à partir du moment où l’on est immergé dans les rythmes parfois pressants, des engagements pastoraux. Toutefois, ce que nous avons justement acquis pendant le temps du séminaire – en vivant l’harmonie entre prière, travail et repos – représente une ressource précieuse pour affronter les fatigues apostoliques. Nous avons besoin de nous arrêter tous les jours, de nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et de rester devant le tabernacle. « Mais je cherche, mais… je m’endors devant le tabernacle ». Endors-toi, cela plaît au Seigneur, mais reste là, devant lui. Et avoir soin d’écouter aussi notre corps, qui est un bon médecin et qui nous avertit quand la fatigue a dépassé les limites. La prière, la relation à Dieu, le soin de la vie spirituelle donne une âme au ministère et le ministère, pour ainsi dire, donne un corps à la vie spirituelle : parce que le prêtre se sanctifie lui-même et les autres dans l’exercice concret de son ministre, surtout en prêchant et en célébrant les sacrements.
Deuxièmement : marcher toujours parce qu’un prêtre n’est jamais « arrivé ». Il reste toujours un disciple, pèlerin sur les routes de l’Évangile et de la vie, présent sur le seuil du mystère de Dieu et sur la terre sacré des personnes qui lui sont confiées. Il ne pourra jamais se sentir satisfait ni éteindre l’inquiétude salutaire qui le fait tendre les mains vers le Seigneur pour se laisser former et remplir. Pour cela, toujours se mettre à jour et rester ouvert aux surprises de Dieu ! Dans cette ouverture vers ce qui est nouveau, les jeunes prêtres peuvent être créatifs dans l’évangélisation, fréquentant avec discernement les nouveaux lieux de la communication, où rencontrer les visages, les histoires et les questions des personnes, développant des capacités de sociabilité, de relation et d’annonce de la foi. De la même manière, ils peuvent « rester en réseau » avec les autres prêtres et empêcher que le ver de l’autoréférentialité ne freine l’expérience régénératrice de la communion sacerdotale. En effet, dans tous les domaines de la vie presbytérale, il est important de progresser dans la foi, dans l’amour et dans la charité pastorale, sans se raidir dans ses propres acquisitions ou se fixer dans ses propres schémas.
Enfin, partager avec le cœur parce que la vie presbytérale n’est pas une agence bureaucratique ni un ensemble de pratiques religieuses ou liturgiques à briguer. Nous avons beaucoup parlé du « prêtre bureaucrate » qui est un « clerc de l’État » et non un pasteur du peuple. Être prêtre, c’est jouer sa vie pour le Seigneur et pour ses frères, en portant dans sa propre chair les joies et les angoisses du peuple, en passant du temps à écouter pour guérir les blessures des autres et en offrant à tous la tendresse du Père. En partant du souvenir de leur expérience personnelle – quand ils allaient au patronage, cultivant des rêves et des amitiés animés par leur amour juvénile pour le Seigneur -, les nouveaux prêtres ont la grande opportunité de vivre ce partage avec les jeunes et les adolescents. Il s’agit de rester parmi eux – ici aussi, la proximité ! – non seulement comme un ami parmi les autres, mais comme quelqu’un qui sait partager leur vie avec son cœur, écouter leurs questions et participer concrètement aux différentes vicissitudes de leur vie. Les jeunes n’ont pas besoin d’un professionnel du sacré ni d’un héros qui, de haut et de l’extérieur, réponde à leurs interrogations ; ils sont plutôt attirés par celui qui sait s’impliquer sincèrement dans leur vie, restant à leurs côtés avec respect et les écoutant avec amour. Il s’agit d’avoir un cœur plein de passion et de compassion, surtout envers les jeunes.
Prier sans se lasser, toujours marcher et partager avec le cœur, cela signifie vivre la vie sacerdotale en regardant vers le haut et en pensant en grand. Ce n’est pas une tâche facile, mais on peut mettre toute sa confiance dans le Seigneur parce qu’il nous précède toujours sur le chemin ! Que la très sainte Vierge Marie, qui a prié sans se lasser, a marché derrière son Fils et a partagé sa vie jusque sous la croix, nous guide et intercède pour nous. S’il vous plaît, priez pour moi !
 « Le Général des Jésuites vient de déclarer au journal El Mundo que Satan n'existait pas et qu'après avoir ouvert la porte au diaconat féminin, d'autres portes s'ouvriront pour une Eglise dotée d'une autre structure avec une hiérarchie différente grâce à la créativité féminine.
« Le Général des Jésuites vient de déclarer au journal El Mundo que Satan n'existait pas et qu'après avoir ouvert la porte au diaconat féminin, d'autres portes s'ouvriront pour une Eglise dotée d'une autre structure avec une hiérarchie différente grâce à la créativité féminine. Un entretien du mensuel « La Nef » (n° 293, juin 2017) avec Dom Louis-Marie, Père-Abbé de l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux. Celui-ci
Un entretien du mensuel « La Nef » (n° 293, juin 2017) avec Dom Louis-Marie, Père-Abbé de l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux. Celui-ci 


 Dirigée depuis 1997 par Olga Roudakova, sa branche féminine, Voix de femmes, rassemble une douzaine de chanteuses de nationalités et formations musicales variées, couronnées des prix décernés par divers conservatoires et concours musicaux. Multipliant les concerts et tournées internationales, l’Ensemble s’est produit, notamment, aux Festivals de Musique Sacrée de la Ville de Paris ou « Voix et Route romane » à Strasbourg , au Festival d’art sacré « L’éclat d’Orient » d’Angers , aux Festivals internationaux de Chant Grégorien du Luxembourg, de Watou (Belgique) ou de Tomar (Portugal), aux Estivales de l’Orgue à Rennes, au Festival d’art sacré « L’éclat d’Orient » d’Angers et d’année en année à Saint-Pétersbourg (Russie). Depuis 2004 les « Voix de femmes » résident à l’église Saint-Germain l’Auxerrois de Paris pour y animer les messes grégoriennes de dimanche soir.
Dirigée depuis 1997 par Olga Roudakova, sa branche féminine, Voix de femmes, rassemble une douzaine de chanteuses de nationalités et formations musicales variées, couronnées des prix décernés par divers conservatoires et concours musicaux. Multipliant les concerts et tournées internationales, l’Ensemble s’est produit, notamment, aux Festivals de Musique Sacrée de la Ville de Paris ou « Voix et Route romane » à Strasbourg , au Festival d’art sacré « L’éclat d’Orient » d’Angers , aux Festivals internationaux de Chant Grégorien du Luxembourg, de Watou (Belgique) ou de Tomar (Portugal), aux Estivales de l’Orgue à Rennes, au Festival d’art sacré « L’éclat d’Orient » d’Angers et d’année en année à Saint-Pétersbourg (Russie). Depuis 2004 les « Voix de femmes » résident à l’église Saint-Germain l’Auxerrois de Paris pour y animer les messes grégoriennes de dimanche soir.  des week-ends consacrés à des formations thématiques de perfectionnement dont la direction est
des week-ends consacrés à des formations thématiques de perfectionnement dont la direction est