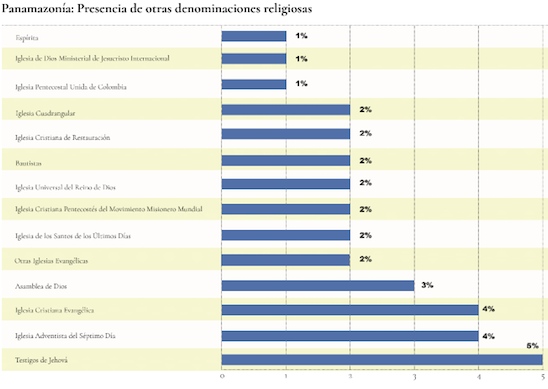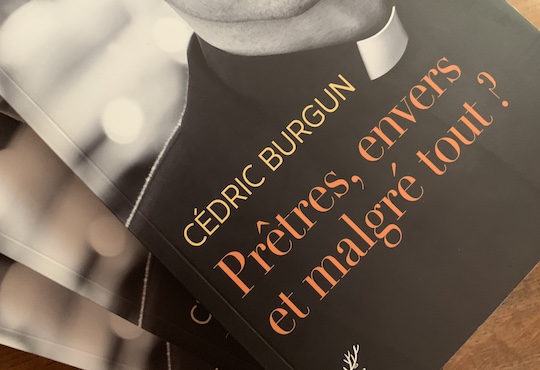De Marie et Pablo González Depreter en Carte blanche sur le site du Vif :
Les bras d'une maman
18/10/19
Il y a des moments dans la vie que personne n'oublie : bons ou mauvais, ils nous font grandir et forgent notre façon d'être. Parfois ils arrivent soudainement et nous prennent à l'improviste ; et parfois nous les voyons venir.

Nous vivons à Madrid. Mariés depuis le mois d'avril 2018 et désireux d'agrandir notre petite famille, nous apprenons quelques mois plus tard la bonne nouvelle : un bébé est en route. Date prévue de l'accouchement : 17 juin 2019.
Les semaines défilent à toute vitesse. À onze semaines de grossesse, nous sommes frappés de découvrir pour la première fois la vie de ce petit être qui mesure tout juste 4,3 cm ! Pendant cette première échographie, son coeur bat à mille à l'heure. Nous nageons dans le bonheur.
Le temps passe à vive allure. Nous attendons avec impatience la 20e semaine pour connaître le sexe de notre bébé. Entre temps, Marie se prive de ces mille petites choses qui sont déconseillées aux femmes enceintes : finis les sushis, les McDonald's, le Brie, le saucisson et le jambon d'Espagne !
Arrive enfin le jour tant attendu où nous devions connaître le sexe de notre bébé. Au bout de quelques minutes d'échographie, nous sentons que quelque chose ne va pas. Le médecin se concentre longtemps sur une zone spécifique. L'inquiétude s'empare de nous. Nous lançons, tout bas, une petite prière au ciel. Le médecin, jusque-là d'un silence sépulcral, s'adresse à Marie - et à elle seulement.
Ses mots sont terribles -et marqués par un énorme manque de tact. Notre bébé a une malformation très grave. Est-ce que Marie souhaite avorter ?
Nous demeurons un moment silencieux, sans pouvoir répondre. Mentalement, nous essayons de rembobiner la scène en marche arrière. Mais il n'y a pas de retour en arrière possible.
Nous refusons d'avorter. Dévastée, mon épouse essaie de déconnecter pendant que le médecin développe un peu plus, nous répétant que l'avortement est la meilleure option possible. "Arrêter la grossesse, c'est très simple : vous venez demain et en une demi-heure, c'est fait."
Notre bébé souffre d'anencéphalie. Probabilité de vivre pendant la grossesse : élevée. Probabilité de mourir pendant l'accouchement : de 40% à 60%. Probabilité de vivre après l'accouchement si l'enfant y survit : 0,00%.
Nous sommes repartis en pleurs, sans même connaître le sexe de notre bébé. Que dire ? Que faire ? Comment réagit-on lorsque survient ce qu'on a envisagé de pire ?
Nous ne pouvons l'accepter et nous ne sommes pas disposés à baisser les bras. Nous reprenons la voiture. Nous avons besoin d'un deuxième avis : peut-être allons-nous nous réveiller de ce cauchemar ? Trois heures plus tard, nous arrivons à Burgos, ville où le père de Pablo travaille comme médecin, et où l'on nous confirme la malformation.
Jour triste s'il en est : ni célébration ni sourire, mais seulement un sentiment écrasant d'impuissance. Nous ne pouvons rien faire, et ça nous glace le sang. Seule petite lumière dans ces ténèbres : nous apprenons que notre bébé est une fille, et nous l'appelons Elena.
Le temps devient à présent notre ennemi. Démarre un compte à rebours implacable avant le terme, que nous redoutons plus que tout. C'est dans ces moments difficiles que nous pensons le plus souvent à Dieu, et pas vraiment en bien. Pourtant nous nous rapprochons de lui : en quête de réponse, d'explication ou de miracle, nous fréquentons plus souvent la messe. Dans ces moments de grande obscurité, nous nous rendons rapidement compte que nous ne sommes pas seuls : tout le monde se démène pour nous aider, et c'est pour nous comme une éclaircie dans notre obscurité.
La Clinique Universitaire de Navarre à Madrid, où nous savions que serait acceptée notre décision de ne pas avorter, devient notre nouvel hôpital. Notre nouvelle gynécologue, une personne souriante qui déborde de vitalité, change nos vies. Elle nous apprend à voir ce que nous ne pouvions voir, à comprendre que le peu de temps que nous allons passer avec notre fille peut être le moment le plus heureux de notre vie. Elle nous explique, très simplement, qu'Elena peut avoir une longue vie. "Le temps, nous dit-elle, personne ne le voit, mais nous savons tous qu'il existe. Si au lieu de le mesurer chronologiquement, nous le mesurons en amour, quelle vie longue et dense aura votre fille Elena ! "
Le terme arrive. Comme Elena ne semble guère pressée de quitter sa maman et que la date prévue est dépassée, on programme l'accouchement pour le 20 juin.
Marie entre en clinique le 19 dans la soirée. Nous le savons, l'accouchement va être long. Cette nuit-là, ainsi que toutes les autres, Pablo reste dormir près d'elle. À Dieu, nous ne demandons que de toutes petites choses. Nous prions pour qu'Il nous donne la foi et le courage de vivre ce moment. Pablo espère pouvoir baptiser la petite.
Étant tous deux issus de familles nombreuses (dont l'une réside en Belgique), rassembler tout ce monde à Madrid n'est pas chose aisée. Et pourtant tous sont présents en ce jour.
Les contractions débutent vers 7h45 du matin avec l'aide de l'ocytocine administrée par les médecins à ma femme. Après des heures de douleur, les médecins décident de procéder par césarienne.
Dans ces cas-là, on ne permet en général pas au mari d'entrer dans la salle d'opération. Notre gynécologue accepte toutefois une exception. "Pablo, me dit-elle, tu vas entrer dans la salle d'opération et tu la baptiseras toi-même".
À 20h20, Pablo entre en salle d'opération pour accompagner Marie jusqu'au bout. À 20h40, Elena voit le jour. Pendant quelques minutes, Pablo la regarde, submergé de bonheur, avant de la baptiser. Il le fait deux fois... juste au cas où Dieu ne l'aurait pas bien entendu.
Les heures suivantes sont probablement les plus belles de toute notre vie. Toute cette terrible attente, toute cette souffrance endurée trouvaient là leur aboutissement, dans l'intensité de ce moment : voir Elena, la toucher, lui donner notre amour, l'embrasser encore et encore, la présenter à toute notre famille. Il y a un mystère dans toute vie, et ce mystère ne se découvre à aucun autre moment de façon aussi singulière et si dense que dans l'émerveillement de la naissance.
Après deux heures et onze minutes, Elena s'est éteinte dans les bras de sa mère, ayant reçu tout l'amour que nous pouvions lui prodiguer durant ce court moment d'éternité. Nous avons été et nous sommes les parents les plus heureux qui soient.
Chaque vie mérite d'être vécue. Nous serions prêts à revivre tout, de bout en bout, la souffrance, l'attente, les désillusions, l'espoir et le désespoir, pour voir Elena une seconde de plus. Nous lui avons donné tout ce que nous pouvions lui donner. Nous lui avons offert de pouvoir vivre et mourir dans les bras de sa maman.
Plus tard, la petite soeur de Pablo dira : "Je suis la seule de ma classe à être la tante d'une sainte". Ce à quoi nous ajoutons : "Il n'y a pas de plus grande fierté que d'avoir une fille sainte".
Marie et Pablo González Depreter