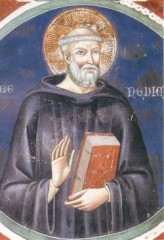De Bernadette Mary Reis sur Vatican News :
Le sacrifice héroïque des sœurs carmélites déchaussées de Compiègne
Tout commence par un rêve. En 1693, une femme de 29 ans, porteuse de handicap, vivant au carmel de Compiègne rêve de Jésus en compagnie de sa mère, de sainte Thérèse d'Avila et de deux autres carmélites qui avaient vécu dans le même monastère. Après avoir reçu des instructions sur sa propre vocation, elle a une vision dans laquelle elle voit un certain nombre de carmélites choisies pour «suivre l'Agneau».
Un bond en avant, en 1786: mère Thérèse de Saint-Augustin, nouvellement élue prieure du même monastère, trouve un récit de la vision que sœur Elisabeth Baptiste a eue avant de prononcer ses vœux de carmélite. Mère Thérèse a le pressentiment que ce rêve est une prophétie concernant sa communauté.
Evacuation des monastères et saisie des biens
Quelques années plus tard, la Révolution éclate en France et le régime de la Terreur est mis en place. En février 1790, la suspension provisoire des vœux religieux est ratifiée. Le 4 août, les biens de la communauté carmélite sont inventoriés; le lendemain, toutes les religieuses sont interrogées et se voient offrir la possibilité de renoncer à leurs vœux. Au grand regret des dirigeants révolutionnaires, toutes les religieuses expriment leur ferme détermination à rester fidèles à leurs vœux jusqu'à la mort.
Pâques 1792: le 6 avril, le port de l'habit religieux devient illégal; deux jours plus tard, le rêve de sœur Elisabeth Baptiste est raconté aux sœurs de la communauté. Les événements se précipitent: en août, les monastères de femmes sont fermés et évacués et les biens des religieuses saisis.
Les vingt carmélites de Compiègne quittent leur monastère le 14 septembre, fête de l'Exaltation de la Croix. Avec l'aide d'amis, elles trouvent refuge dans quatre localités différentes et parviennent à acheter des vêtements civils pour chacune d'entre elles: elles n'ont pas assez d'argent pour acheter également des vêtements de rechange et leur demande de soutien auprès du gouvernement reste lettre morte.
Peu de temps après, mère Thérèse de Saint-Augustin consulte les quatre religieuses du chœur, les plus âgées, sur la proposition à faire à toute la communauté d'offrir leur vie pour le salut de la France: sa proposition s'enracine dans le désir de sainte Thérèse d'Avila de réformer le carmel. De manière compréhensible, elle se heurte à une résistance: qui, en réalité, se soumettrait volontairement à une décapitation au moyen de la guillotine nouvellement inventée?
Acte du don de soi
Mais curieusement, quelques heures plus tard, deux des religieuses les plus âgées demandent à la prieure de leur pardonner leur manque de courage: cela ouvre la voie à mère Thérèse, qui propose aux autres membres de la communauté un acte de don de soi. A partir du 27 novembre, toutes les sœurs récitent un «acte de don de soi» pour le salut de la France, écrit par la prieure. Par la suite est ajoutée une intention pour que de moins en moins de personnes soient exécutées au moyen de la guillotine, et pour la libération des personnes arrêtées.
Le 21 juin 1794, des soldats perquisitionne les logements des religieuses. Le lendemain, elles sont arrêtées sur la base de preuves apparues lors de la perquisition, utilisées pour prouver qu'elles continuent à mener une vie consacrée et qu'elles sympathisent avec la monarchie. La communauté carmélite, qui comptait alors seize religieuses, se retrouve en état d'arrestation dans l'ancien couvent de la Visitation avec dix-sept sœurs bénédictines anglaises. Le 12 juillet, le maire de Compiègne fait irruption dans le couvent avec des soldats, surpris de trouver les femmes vêtues de leurs habits religieux: la seule tenue civile qu'elles possédaient était complètement trempée. A ce stade, le départ pour Paris, où le procès les attend, est inévitable.
Le 17 juillet, les seize carmélites et 24 autres prisonniers sont reconnus coupables d'être des «ennemis du peuple» - entre autres chefs d'accusation - et condamnés à mort. Les religieuses se préparent à l'accomplissement du rêve prophétique: bientôt elles suivront l'agneau.
Le soir même, Paris résonne de la voix des religieuses qui chantent l'office divin tandis qu’elles traversent les rues de la ville; le bourreau leur permet de terminer leurs prières pour les mourants, notamment le chant du Te Deum, suivi du Veni Creator et du renouvellement de leurs vœux. Après être montées à la potence, elles reçoivent une dernière bénédiction de la prieure, embrassent la statue de Notre-Dame et suivent l'agneau sacrifié.
Robespierre fut arrêté dix jours plus tard et exécuté le jour suivant. Les martyrs de Compiègne ont été béatifiées par Pie X en 1909, et le procès en vue de leur canonisation équipollente est actuellement en cours.