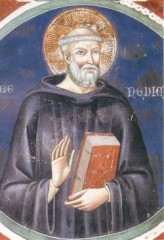De David Quinn sur The Catholic Herald :
L'obsession des médias pour les « nonnes maléfiques » est remise en question par un rapport irlandais sur le foyer pour mères et bébés de Tuam
1er juillet 2025
Les lecteurs se souviendront peut-être de l'affirmation sensationnelle qui a fait le tour du monde en 2014, selon laquelle près de 800 bébés avaient été retrouvés dans une fosse septique sur le terrain d'un ancien foyer pour mères et bébés à Tuam, dans le comté de Galway, à l'ouest de l'Irlande.
L'affirmation a été faite lorsqu'une historienne locale, Catherine Corless, a examiné les certificats de décès de 796 bébés et jeunes enfants décédés dans ce foyer au cours de son existence, de 1925 à 1961.
Sous les terrains restants de l'ancienne maison se trouvent des chambres situées dans ce qui faisait autrefois partie du système d'égouts de la maison. Beaucoup ont immédiatement conclu - mais pas Corless, il faut le souligner - que les corps avaient tous été jetés dans une fosse septique.
Le foyer était géré par les sœurs du Bon Secours pour le compte du conseil du comté de Galway et fait à nouveau parler de lui parce que des fouilles viennent de commencer sur le site, financées par l'État, pour tenter de retrouver les corps, prélever des échantillons d'ADN et tenter ensuite de les associer à des membres vivants de la famille des défunts qui sont disposés à fournir des échantillons d'ADN (14 au total l'ont fait jusqu'à présent). Il s'agit d'une opération complexe qui prendra environ deux ans.
Les gens étaient parfaitement disposés à accepter que les bébés aient été affamés ou négligés jusqu'à la mort, ou qu'ils aient été tués par les méchantes religieuses avant d'être jetés dans la fosse septique (qui était toujours utilisée à cette fin, selon les rumeurs les plus folles).
Lorsque les religieuses sont aujourd'hui représentées à l'écran dans des films tels que le récent Small Things Like These, The Magdalene Sisters ou Philomena, elles sont presque invariablement dépeintes comme des personnages issus d'un film d'horreur gothique, sortant parfois littéralement de l'ombre. J'ai du mal à imaginer un groupe de femmes plus diabolisé.
À la suite de l'hystérie qui a entouré les premières plaintes en 2014, le gouvernement irlandais a créé une commission d'enquête officielle qui, il y a quatre ans, a publié un énorme rapport sur les foyers pour mères et bébés du pays, ainsi que sur les maisons de comté qui étaient les successeurs directs des maisons de travail de l'histoire de Dickens.
Le nombre de décès dans les foyers pour mères et bébés, ainsi que dans les foyers de comté, était extrêmement élevé. Ils fonctionnaient principalement à une époque d'extrême pauvreté, de faim généralisée et de mauvaise santé.
La mortalité infantile et juvénile était très élevée à l'époque et avant l'utilisation généralisée des vaccins et des antibiotiques dans les années 1950. Mais elle était encore plus élevée dans les maisons de retraite parce qu'elles étaient surpeuplées et que les maladies s'y propageaient rapidement. Les enfants mouraient par groupes, comme ce fut le cas dans les maisons de retraite lors de la pandémie de Covid-19.
Mais le fait est qu'ils sont tous morts de causes naturelles. On peut arguer à juste titre que ces maisons manquaient de ressources et étaient surpeuplées, et qu'elles n'auraient pas dû exister, mais les religieuses n'ont pas délibérément négligé les bébés, sans parler de les tuer ou de les jeter dans une fosse septique en activité.
Les femmes qui entraient dans les foyers pour mères et bébés pour y avoir leurs enfants étaient presque toujours célibataires et très pauvres, bien qu'environ 10 % des femmes qui entraient au Tuam Children's Home, pour donner à ce lieu son nom propre, étaient mariées et y avaient été poussées par la pauvreté. Elles n'avaient littéralement aucun autre endroit où élever leurs enfants.
Ces foyers pour mères et bébés n'étaient d'ailleurs pas l'apanage de l'Irlande. La Grande-Bretagne, entre autres, en a connu un grand nombre jusque dans les années 1970 et la grande majorité d'entre eux n'étaient pas gérés par l'Église catholique.
Si les foyers pour mères et bébés n'existent plus aujourd'hui, c'est parce que les mères célibataires ont les moyens d'élever elles-mêmes leurs enfants, ou parce que l'État leur apporte son soutien, ou encore parce que les futures mères interrompent leur grossesse.
Le rapport susmentionné de la commission d'enquête jette un éclairage considérable sur la question, même s'il ne peut répondre à toutes les questions car trop de temps s'est écoulé.
Lire la suite