 Jeanne Haze - 1782-1876 - source
Jeanne Haze - 1782-1876 - source
Jeanne était la fille du secrétaire du dernier prince-évêque de Liège, et naquit à Liège (Belgique) le 17 février 1782 (1), avant-dernière de six enfants.
La France révolutionnaire occupa la Belgique jusqu’en 1815. La famille Haze dut fuir, et le père mourut dans ces circonstances à Düsseldorf. Les deux sœurs, Fernande et Jeanne, seraient volontiers entrées en religion, mais les lois antireligieuses interdisaient encore les congrégations religieuses et les deux sœurs s’organisèrent à domicile, discrètement, en groupe de piété. Elles vivaient de leçons privées à domicile.
La mère mourut à son tour en 1820.
Les deux demoiselles s’occupèrent à Liège des pauvres et des enfants abandonnés de la ville, au lendemain des ravages causés par l’esprit révolutionnaire français.
En 1824, on leur demanda de prendre en charge une école paroissiale, privée et très discrète, officiellement interdite par le pouvoir hollandais. Mais quand la Belgique acquit son indépendance (1830), Jeanne put faire reconnaître son établissement. Puis, avec quelques compagnes, elle donna naissance à la Congrégation des Filles de la Croix.
Dès 1833 elles prononcèrent leurs premiers vœux. Jeanne prit le nom religieux de Marie-Thérèse du Sacré-Cœur de Jésus. En 1845 l’archevêque les reconnut officiellement, et approuva les constitutions en 1851.
Le mot d’ordre de Jeanne était : Aller aux pauvres avec un cœur de pauvre.
La priorité des nouvelles Religieuses allait à l’éducation des jeunes filles, mais aussi aux malades à domicile, aux femmes incarcérées, à la catéchèse, aux personnes âgées et handicapées, à la broderie, pour occuper les enfants durant la journée et les adultes dans les soirées. On commençait à les connaître dans la ville : elles avaient la charge de la prison des femmes, d’une maison pour réhabiliter les prostituées, d’une maison d’accueil pour les mendiants.
Bien vite s’ouvrirent d’autres maisons en Allemagne (1849), en Inde (1861), en Angleterre (1863) et particulièrement dans le monde anglophone… jusqu’à cinquante communautés et près d’un millier de Religieuses, lorsque la Fondatrice s’éteignit.
Jeanne Haze mourut à Liège le 7 janvier 1876, à l’âge vénérable de quatre-vingt quatorze ans. Cinquante ans plus tard, le corps exhumé apparaissait intact.
Elle a été béatifiée en 1991.
Outre les pays mentionnés plus haut, les Filles de la Croix de Liège sont actuellement environ un millier, présentes dans cent treize maisons en Italie, au Congo belge, au Pakistan et au Brésil. En Inde, elles ont d’importants centres en pleine expansion. (2)
Elles ont donné naissance à trois congrégations indigènes devenues autonomes, les Sœurs du Cœur Immaculé de Marie, en Inde et au Congo-Kinshasa.
(1) On trouve aussi 27 février 1777, ce qui ferait mourir la Bienheureuse à quatre-vingt dix-neuf ans. Mais cette date semble moins officielle que celle qu’on a choisie ci-dessus.
(2) De wikipedia : La maison généralice a quitté la rue Hors-Château de Liège (Belgique) pour s'installer en Angleterre en septembre 2012. Une communauté restant présente à Liège à quelques pas de l'ancienne maison généralice, celle-ci étant reprise par la Haute École HELMo pour y construire des classes afin de former de futurs enseignants.
La chapelle de la rue Hors-Château reste propriété de la Congrégation des Filles de la Croix.


 Israël. Encore une église byzantine mise au jour (
Israël. Encore une église byzantine mise au jour ( De Sandro Magister
De Sandro Magister 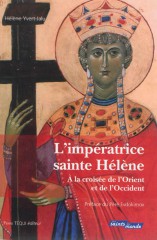 L'impératrice sainte Hélène : à la croisée de l'Orient et de l'Occident : histoire, traditions, légendes
L'impératrice sainte Hélène : à la croisée de l'Orient et de l'Occident : histoire, traditions, légendes Lu
Lu  Jeanne Haze -
Jeanne Haze - 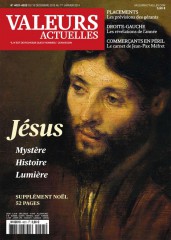 Valeurs Actuelles a consacré
Valeurs Actuelles a consacré  Notre ami Ludovic Werpin a rencontré Marcel Otte qui lui a accordé un entretien autour de son livre "A l'aube spirituelle de l'humanité" (2012).
Notre ami Ludovic Werpin a rencontré Marcel Otte qui lui a accordé un entretien autour de son livre "A l'aube spirituelle de l'humanité" (2012).