On commémore, ces jours-ci, le vingtième anniversaire de la tragédie rwandaise de 1994. Sans que la communauté internationale veuille ou puisse faire grand’chose, on a compté alors près huit cent mille morts, dans une guerre civile tournant au génocide déclenché en avril de cette année-là par le pouvoir hutu, mais finalement gagnée trois mois plus tard par les Tutsis du front patriotique de Paul Kagame. Vingt ans après, les choses en sont toujours là : l’ordre règne à Kigali, sans qu’on puisse présumer d’une « revanche » possible. Mais nous sommes ici dans une séquence de l’histoire longue.
Le mythe fondateur d’un ordre social
 Dans un livre paru chez Fayard en 1983 (« Afrique, Afrique»), Omer Marchal, un ancien de l’Afrique belge, raconte cette légende : lorsqu’Imana, le Dieu qui fit le ciel et la terre, eût créé les mille collines rwandaises et les grands lacs qui les baignent, il en fut séduit au point de revenir doucement dans la nuit bleue constellée, caresser ce paysage d’éternel printemps qu’il avait si bien façonné.
Dans un livre paru chez Fayard en 1983 (« Afrique, Afrique»), Omer Marchal, un ancien de l’Afrique belge, raconte cette légende : lorsqu’Imana, le Dieu qui fit le ciel et la terre, eût créé les mille collines rwandaises et les grands lacs qui les baignent, il en fut séduit au point de revenir doucement dans la nuit bleue constellée, caresser ce paysage d’éternel printemps qu’il avait si bien façonné.
Un soir, alors que brillaient le croissant de la lune et Nyamuhiribona, l’Etoile du Berger, dans le silence à peine troublé par les grillons et les meuglements assourdis des vaches Inyambo aux longues cornes-lyres, Imana descendit de l’empyrée céleste pour confier une jarre de lait à chacun des trois ancêtres des « races » qui peuplent son pays préféré : Gatwa était le père des Batwa, Gahutu, celui des Bahutu et Gatutsi celui des Batutsi.
A l’aube de cette nuit des temps, Il revint s’enquérir de son dépôt. Or, Gatura avait renversé le lait, dans son sommeil. Gahutu avait eu soif et l’avait bu. Seul Gatutsi veillait auprès de la jarre qui lui avait été confiée. « Tu n’aimes pas mon lait ? » lui dit Imana. « Si, Seigneur, mais je l’ai conservé pour Toi, répond-il, prends en bois ! ». Alors Dieu dit à Gatutsi : « Ganza ! », Règne !
De la légende à l’histoire
 Maintenant que s’efface ou s’occulte dans la mémoire des Belges le temps où la région des grands lacs d’Afrique fut aussi la leur, je note, avec les miens, les souvenirs personnels et l’histoire mêlés que consignèrent, avec bien d’autres, Omer Marchal (« Pleure, Rwanda bien-aimé », Villance-en-Ardenne, 1994) et le prince Eugène de Ligne (« Africa », librairie générale, Bruxelles 1961) :
Maintenant que s’efface ou s’occulte dans la mémoire des Belges le temps où la région des grands lacs d’Afrique fut aussi la leur, je note, avec les miens, les souvenirs personnels et l’histoire mêlés que consignèrent, avec bien d’autres, Omer Marchal (« Pleure, Rwanda bien-aimé », Villance-en-Ardenne, 1994) et le prince Eugène de Ligne (« Africa », librairie générale, Bruxelles 1961) :
La légende des jours anciens simplifie l’histoire. Celle-ci commence voici mille ans lorsque, venus des confins du Nil, les premiers pasteurs batutsis, longues silhouettes félines drapées dans des toges blanches, installèrent leurs troupeaux de vaches pharaoniques sur les hauts-plateaux du Rwanda. « Seigneurs de l’Herbe », ils y construisirent une hiérarchie féodale, se mélangeant plus ou moins avec les Hutus et les Twas dans les lignages de douze ou treize clans génériques.
ans lorsque, venus des confins du Nil, les premiers pasteurs batutsis, longues silhouettes félines drapées dans des toges blanches, installèrent leurs troupeaux de vaches pharaoniques sur les hauts-plateaux du Rwanda. « Seigneurs de l’Herbe », ils y construisirent une hiérarchie féodale, se mélangeant plus ou moins avec les Hutus et les Twas dans les lignages de douze ou treize clans génériques.
 Car, à leur arrivée, le pays n’était pas vide : les pygmoïdes batwa y vivaient déjà de la chasse et de la cueillette à l’âge à l'âge néolithique, suivis, bien avant l’an mil, par les ancêtres du « Peuple de la Houe », les agriculteurs bahutu.
Car, à leur arrivée, le pays n’était pas vide : les pygmoïdes batwa y vivaient déjà de la chasse et de la cueillette à l’âge à l'âge néolithique, suivis, bien avant l’an mil, par les ancêtres du « Peuple de la Houe », les agriculteurs bahutu.
Non sans abus, certes, ni ces cruautés inhérentes à la nature blessée de l’homme, une société s’organise ensuite autour de ce lieu fondamental : l’Umurenge – la Colline- avec son armée, l’Ingabo et ses guerriers Intore, dont les célèbres danses ressemblaient à des parades amoureuses, avec son artisanat, ses metiers, les abacuzi, les abashumba, les abagaragu…
blessée de l’homme, une société s’organise ensuite autour de ce lieu fondamental : l’Umurenge – la Colline- avec son armée, l’Ingabo et ses guerriers Intore, dont les célèbres danses ressemblaient à des parades amoureuses, avec son artisanat, ses metiers, les abacuzi, les abashumba, les abagaragu…
Protégé par son lignage, son chef d’armée, le chef des pâtures et celui des terres, le paysan mène ses bêtes ou cultive l’Isambu, son champ. La plus petite Umurenge vit aussi sous un autre regard, celui du prince des nobles tutsis, le « Maître des Tambours », le mwami-roi représenté par les chefs locaux mais qui, lui-même, est loin d’être inaccessible. Le petit homme des collines peut monter jusqu’à lui. Et il en fut largement ainsi jusqu’au sanglant avènement de « Démokarasi », un dieu femelle dont les blancs inspirèrent le culte au tournant des années soixante du siècle dernier.
paysan mène ses bêtes ou cultive l’Isambu, son champ. La plus petite Umurenge vit aussi sous un autre regard, celui du prince des nobles tutsis, le « Maître des Tambours », le mwami-roi représenté par les chefs locaux mais qui, lui-même, est loin d’être inaccessible. Le petit homme des collines peut monter jusqu’à lui. Et il en fut largement ainsi jusqu’au sanglant avènement de « Démokarasi », un dieu femelle dont les blancs inspirèrent le culte au tournant des années soixante du siècle dernier.
Comment en est on arrivé là ?
En 1896, un explorateur allemand, le comte von Götzen, fit tirer quelques coups de feu par ses ascaris zanzibarites puis plaça le pays sous protectorat du Reich, sans le dire au Mwami Rwabagiri, qui le reçut après mille ruses.
Au lendemain de la Grande Guerre, la Société des Nations transféra le mandat à la Belgique, qui s’était d’ailleurs emparé de Kigali dès 1916. L’administration belge, suivant en cela les principes du maréchal Lyautey au Maroc, ne détruisit pas l’organisation traditionnelle de la société : elle s’y superposa (comme au Congo) pour combattre les pratiques barbares et les abus féodaux, développer un réseau économique moderne mais aussi social, hospitalier, éducatif. Elle fut secondée en cela par l’Eglise et, singulièrement, les Pères Blancs d’Afrique qui convertirent alors le royaume au Dieu de Jésus-Christ : « Que ton Tambour résonne » sur la terre comme au ciel, chantait autrefois le Notre-Père rwandais.
 En 1931, la reine-mère Kanjogera et le mwami Musinga Yuhi V, dont l’immoralité n’avait d’égal que les outrages qu’il fit subir aux missionnaires, furent relégués à Kamembe (Cyangugu), proche de la ville congolaise de Bukavu sur l’autre rive du lac Kivu (photo) et de la Ruzizi : les « tambours sacrés ont alors été remis à l’un de ses soixante fils, Charles Mutara III Rudahingwa, dont l’éducation avait été prise en main par les « abapadri
En 1931, la reine-mère Kanjogera et le mwami Musinga Yuhi V, dont l’immoralité n’avait d’égal que les outrages qu’il fit subir aux missionnaires, furent relégués à Kamembe (Cyangugu), proche de la ville congolaise de Bukavu sur l’autre rive du lac Kivu (photo) et de la Ruzizi : les « tambours sacrés ont alors été remis à l’un de ses soixante fils, Charles Mutara III Rudahingwa, dont l’éducation avait été prise en main par les « abapadri  ».
».
Une image me revient à l’esprit : en 1955, sur une route bordée d’eucalyptus, un géant noir aux yeux en amandes, le nez fin et droit, s’avance appuyé sur sa houlette au milieu de ses vassaux. Un grand pagne blanc drape son corps comme une toge et, de haut en bas, sa coiffe en crinière est rehaussée de poils de singe. C’est Charles Mutara, quarante cinq ans, qui accueille le jeune Roi Baudouin.
Péché mortel
Charles n’a pas d’enfants et il meurt quatre ans plus tard, en juillet 1959, dans les bras de son médecin blanc qui vient de lui administrer une piqûre : « mortelle » diront alors de mauvaises langues tutsies pressées de mettre fin à la tutelle coloniale avant que celle-ci ne remette le pouvoir, au nom de la démocratie, au parti des hutus largement majoritaire.
Sur les lieux mêmes de l’inhumation du Mwami Mutara, les féodaux écartent son frère Rwigmera, partisan modéré des réformes, et, sous les yeux médusés du Résident Général Harroy, proclament mwami Kigeri V, un demi-frère, fils parfaitement obscur de Musinga.
Les événements suivront alors leur pente fatale : le « Parmehutu » de Grégoire Kayibanda monte en graine, soutenu par le lobby de la démocratie chrétienne, les Pères Blancs de Monseigneur Perraudin et le Colonel Logiest, résident militaire spécial de 1959 à 1962
Car, tout commence à la Toussaint rouge de 1959. Les Hutus brandissent l’Umhoro. Sur à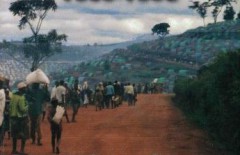 la noblesse. Les tutsis répliquent à coup de flèches. Premier bain de sang. La Tutelle impose les élections. « Pour manger le royaume » accusent les Tutsis regroupés au sein de l’Unar. De fait, ils ne sont pas 25% de la population et, au petit jeu « one man, one vote », ils n’ont aucune chance : ils le refusent. La cause est alors entendue. Le « Parmehutu » s’installe au pouvoir communal en juillet 1960, puis national en septembre 1961. Le Mwami est déchu. Le Rwanda sera donc une république dont l’indépendance est fêtée le 1er juillet 1962 : Kayibanda préside à ses destinées. A ses côté un nouvel ambassadeur : l’ancien résident belge Guy Logiest.
la noblesse. Les tutsis répliquent à coup de flèches. Premier bain de sang. La Tutelle impose les élections. « Pour manger le royaume » accusent les Tutsis regroupés au sein de l’Unar. De fait, ils ne sont pas 25% de la population et, au petit jeu « one man, one vote », ils n’ont aucune chance : ils le refusent. La cause est alors entendue. Le « Parmehutu » s’installe au pouvoir communal en juillet 1960, puis national en septembre 1961. Le Mwami est déchu. Le Rwanda sera donc une république dont l’indépendance est fêtée le 1er juillet 1962 : Kayibanda préside à ses destinées. A ses côté un nouvel ambassadeur : l’ancien résident belge Guy Logiest.
L’apocalypse et après
 Le décor est ainsi planté pour l’exil ou la mort atroce, au gré des vagues sanglantes qui se succéderont pendant trente ans, pour aboutir au génocide déclenché par le meurtre du successeur de Kayibanda, Juvénal Habyiarimana, et la percée décisive du Front patriotique en 1994 : Interhamwe hutus contre Inkotanyi tutsis mais aussi tout un peuple sans défense. Deux millions de réfugiés, et plus d’un demi-million de morts au moins, en quelques mois.
Le décor est ainsi planté pour l’exil ou la mort atroce, au gré des vagues sanglantes qui se succéderont pendant trente ans, pour aboutir au génocide déclenché par le meurtre du successeur de Kayibanda, Juvénal Habyiarimana, et la percée décisive du Front patriotique en 1994 : Interhamwe hutus contre Inkotanyi tutsis mais aussi tout un peuple sans défense. Deux millions de réfugiés, et plus d’un demi-million de morts au moins, en quelques mois.
Dans cette tragédie, l’Eglise elle-même fut alors réduite au silence et sa hiérarchie décapitée avec le régime dont elle fut si (trop) proche, même si quelques étoiles scintillèrent dans la nuit.
Quoi qu’on dise aujourd’hui, le Rwanda, terre catholique, a toujours (bien plus que de rééducations à la chinoise) un immense besoin sacramentel : celui du pardon et de la vraie réconciliation des âmes. A ce prix seulement, il deviendra une nation, l’Imbuga y’Inyiabutatu, le peuple des trois « races » qui ont fondé autrefois la terre des mille collines.
rééducations à la chinoise) un immense besoin sacramentel : celui du pardon et de la vraie réconciliation des âmes. A ce prix seulement, il deviendra une nation, l’Imbuga y’Inyiabutatu, le peuple des trois « races » qui ont fondé autrefois la terre des mille collines.
En 1982 déjà, la Vierge Marie apparue de façon prémonitoire à Kibeho, lieu même d’épouvantables massacres en avril 1994, avait appelé au repentir et à la conversion des cœurs : un message que l’Eglise a authentifié en 2001. Il n’a nullement perdu son actualité.
JPSC
 Se retranchant derrière la laïcité, François Hollande n'a pas souhaité une bonne fête de Pâques aux catholiques français. On se souvient pourtant qu'il avait adressé ses vœux aux musulmans de France pour la fête de l'Aïd. Deux poids, deux mesures ? De Gérard Leclerc sur « Figarovox » :
Se retranchant derrière la laïcité, François Hollande n'a pas souhaité une bonne fête de Pâques aux catholiques français. On se souvient pourtant qu'il avait adressé ses vœux aux musulmans de France pour la fête de l'Aïd. Deux poids, deux mesures ? De Gérard Leclerc sur « Figarovox » :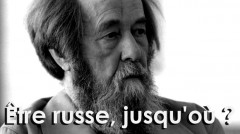 « Il y a un peu plus de vingt ans, le système communiste s’effondra et l’Union soviétique disparut. Aussitôt, des nations que l’on croyait disparues ont resurgi. La résurrection la plus surprenante de toutes a été celle de la Russie. Pour en comprendre la réalité et la portée, j’eus l’honneur de conduire à Moscou, au nom du Parlement européen, une délégation de responsables politiques et religieux, d’universitaires et d’éditorialistes, venus débattre d’un projet ambitieux : examiner sur quelles bases l’Union européenne tout juste née et la Russie revenue à la vie pouvaient établir des relations stables, étroites et confiantes.
« Il y a un peu plus de vingt ans, le système communiste s’effondra et l’Union soviétique disparut. Aussitôt, des nations que l’on croyait disparues ont resurgi. La résurrection la plus surprenante de toutes a été celle de la Russie. Pour en comprendre la réalité et la portée, j’eus l’honneur de conduire à Moscou, au nom du Parlement européen, une délégation de responsables politiques et religieux, d’universitaires et d’éditorialistes, venus débattre d’un projet ambitieux : examiner sur quelles bases l’Union européenne tout juste née et la Russie revenue à la vie pouvaient établir des relations stables, étroites et confiantes.
 Dans un livre paru chez Fayard en 1983 (« Afrique, Afrique»), Omer Marchal, un ancien de l’Afrique belge, raconte cette légende : lorsqu’Imana, le Dieu qui fit le ciel et la terre, eût créé les mille collines rwandaises et les grands lacs qui les baignent, il en fut séduit au point de revenir doucement dans la nuit bleue constellée, caresser ce paysage d’éternel printemps qu’il avait si bien façonné.
Dans un livre paru chez Fayard en 1983 (« Afrique, Afrique»), Omer Marchal, un ancien de l’Afrique belge, raconte cette légende : lorsqu’Imana, le Dieu qui fit le ciel et la terre, eût créé les mille collines rwandaises et les grands lacs qui les baignent, il en fut séduit au point de revenir doucement dans la nuit bleue constellée, caresser ce paysage d’éternel printemps qu’il avait si bien façonné. Maintenant que s’efface ou s’occulte dans la mémoire des Belges le temps où la région des grands lacs d’Afrique fut aussi la leur, je note, avec les miens, les souvenirs personnels et l’histoire mêlés que consignèrent, avec bien d’autres, Omer Marchal (« Pleure, Rwanda bien-aimé », Villance-en-Ardenne, 1994) et le prince Eugène de Ligne (« Africa », librairie générale, Bruxelles 1961) :
Maintenant que s’efface ou s’occulte dans la mémoire des Belges le temps où la région des grands lacs d’Afrique fut aussi la leur, je note, avec les miens, les souvenirs personnels et l’histoire mêlés que consignèrent, avec bien d’autres, Omer Marchal (« Pleure, Rwanda bien-aimé », Villance-en-Ardenne, 1994) et le prince Eugène de Ligne (« Africa », librairie générale, Bruxelles 1961) : ans lorsque, venus des confins du Nil, les premiers pasteurs batutsis, longues silhouettes félines drapées dans des toges blanches, installèrent leurs troupeaux de vaches pharaoniques sur les hauts-plateaux du Rwanda. « Seigneurs de l’Herbe », ils y construisirent une hiérarchie féodale, se mélangeant plus ou moins avec les Hutus et les Twas dans les lignages de douze ou treize clans génériques.
ans lorsque, venus des confins du Nil, les premiers pasteurs batutsis, longues silhouettes félines drapées dans des toges blanches, installèrent leurs troupeaux de vaches pharaoniques sur les hauts-plateaux du Rwanda. « Seigneurs de l’Herbe », ils y construisirent une hiérarchie féodale, se mélangeant plus ou moins avec les Hutus et les Twas dans les lignages de douze ou treize clans génériques. Car, à leur arrivée, le pays n’était pas vide : les pygmoïdes batwa y vivaient déjà de la chasse et de la cueillette à l’âge à l'âge néolithique, suivis, bien avant l’an mil, par les ancêtres du « Peuple de la Houe », les agriculteurs bahutu.
Car, à leur arrivée, le pays n’était pas vide : les pygmoïdes batwa y vivaient déjà de la chasse et de la cueillette à l’âge à l'âge néolithique, suivis, bien avant l’an mil, par les ancêtres du « Peuple de la Houe », les agriculteurs bahutu. blessée de l’homme, une société s’organise ensuite autour de ce lieu fondamental : l’Umurenge – la Colline- avec son armée, l’Ingabo et ses guerriers Intore, dont les célèbres danses ressemblaient à des parades amoureuses, avec son artisanat, ses metiers, les abacuzi, les abashumba, les abagaragu…
blessée de l’homme, une société s’organise ensuite autour de ce lieu fondamental : l’Umurenge – la Colline- avec son armée, l’Ingabo et ses guerriers Intore, dont les célèbres danses ressemblaient à des parades amoureuses, avec son artisanat, ses metiers, les abacuzi, les abashumba, les abagaragu… paysan mène ses bêtes ou cultive l’Isambu, son champ. La plus petite Umurenge vit aussi sous un autre regard, celui du prince des nobles tutsis, le « Maître des Tambours », le mwami-roi représenté par les chefs locaux mais qui, lui-même, est loin d’être inaccessible. Le petit homme des collines peut monter jusqu’à lui. Et il en fut largement ainsi jusqu’au sanglant avènement de « Démokarasi », un dieu femelle dont les blancs inspirèrent le culte au tournant des années soixante du siècle dernier.
paysan mène ses bêtes ou cultive l’Isambu, son champ. La plus petite Umurenge vit aussi sous un autre regard, celui du prince des nobles tutsis, le « Maître des Tambours », le mwami-roi représenté par les chefs locaux mais qui, lui-même, est loin d’être inaccessible. Le petit homme des collines peut monter jusqu’à lui. Et il en fut largement ainsi jusqu’au sanglant avènement de « Démokarasi », un dieu femelle dont les blancs inspirèrent le culte au tournant des années soixante du siècle dernier. En 1931, la reine-mère Kanjogera et le mwami Musinga Yuhi V, dont l’immoralité n’avait d’égal que les outrages qu’il fit subir aux missionnaires, furent relégués à Kamembe (Cyangugu), proche de la ville congolaise de Bukavu sur l’autre rive du lac Kivu (photo) et de la Ruzizi : les « tambours sacrés ont alors été remis à l’un de ses soixante fils, Charles Mutara III Rudahingwa, dont l’éducation avait été prise en main par les « abapadri
En 1931, la reine-mère Kanjogera et le mwami Musinga Yuhi V, dont l’immoralité n’avait d’égal que les outrages qu’il fit subir aux missionnaires, furent relégués à Kamembe (Cyangugu), proche de la ville congolaise de Bukavu sur l’autre rive du lac Kivu (photo) et de la Ruzizi : les « tambours sacrés ont alors été remis à l’un de ses soixante fils, Charles Mutara III Rudahingwa, dont l’éducation avait été prise en main par les « abapadri  ».
».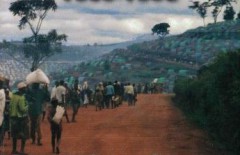 la noblesse. Les tutsis répliquent à coup de flèches. Premier bain de sang. La Tutelle impose les élections. « Pour manger le royaume » accusent les Tutsis regroupés au sein de l’Unar. De fait, ils ne sont pas 25% de la population et, au petit jeu « one man, one vote », ils n’ont aucune chance : ils le refusent. La cause est alors entendue. Le « Parmehutu » s’installe au pouvoir communal en juillet 1960, puis national en septembre 1961. Le Mwami est déchu. Le Rwanda sera donc une république dont l’indépendance est fêtée le 1er juillet 1962 : Kayibanda préside à ses destinées. A ses côté un nouvel ambassadeur : l’ancien résident belge Guy Logiest.
la noblesse. Les tutsis répliquent à coup de flèches. Premier bain de sang. La Tutelle impose les élections. « Pour manger le royaume » accusent les Tutsis regroupés au sein de l’Unar. De fait, ils ne sont pas 25% de la population et, au petit jeu « one man, one vote », ils n’ont aucune chance : ils le refusent. La cause est alors entendue. Le « Parmehutu » s’installe au pouvoir communal en juillet 1960, puis national en septembre 1961. Le Mwami est déchu. Le Rwanda sera donc une république dont l’indépendance est fêtée le 1er juillet 1962 : Kayibanda préside à ses destinées. A ses côté un nouvel ambassadeur : l’ancien résident belge Guy Logiest. Le décor est ainsi planté pour l’exil ou la mort atroce, au gré des vagues sanglantes qui se succéderont pendant trente ans, pour aboutir au génocide déclenché par le meurtre du successeur de Kayibanda, Juvénal Habyiarimana, et la percée décisive du Front patriotique en 1994 : Interhamwe hutus contre Inkotanyi tutsis mais aussi tout un peuple sans défense. Deux millions de réfugiés, et plus d’un demi-million de morts au moins, en quelques mois.
Le décor est ainsi planté pour l’exil ou la mort atroce, au gré des vagues sanglantes qui se succéderont pendant trente ans, pour aboutir au génocide déclenché par le meurtre du successeur de Kayibanda, Juvénal Habyiarimana, et la percée décisive du Front patriotique en 1994 : Interhamwe hutus contre Inkotanyi tutsis mais aussi tout un peuple sans défense. Deux millions de réfugiés, et plus d’un demi-million de morts au moins, en quelques mois.  rééducations à la chinoise) un immense besoin sacramentel : celui du pardon et de la vraie réconciliation des âmes. A ce prix seulement, il deviendra une nation, l’Imbuga y’Inyiabutatu, le peuple des trois « races » qui ont fondé autrefois la terre des mille collines.
rééducations à la chinoise) un immense besoin sacramentel : celui du pardon et de la vraie réconciliation des âmes. A ce prix seulement, il deviendra une nation, l’Imbuga y’Inyiabutatu, le peuple des trois « races » qui ont fondé autrefois la terre des mille collines.  Sur le site de « La Vie », Antoine Arjakovsky, directeur de recherche au Collège des Bernardins, spécialiste de l'orthodoxie, répond aux questions de Marie-Lucile Kubaki :
Sur le site de « La Vie », Antoine Arjakovsky, directeur de recherche au Collège des Bernardins, spécialiste de l'orthodoxie, répond aux questions de Marie-Lucile Kubaki :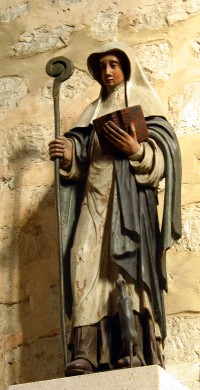 LA VIE DE SAINTE GERTRUDE DE NIVELLES - fête au 17 mars (
LA VIE DE SAINTE GERTRUDE DE NIVELLES - fête au 17 mars (

 Vous avez dit un synode à Rome sur la famille ? En Belgique, après l’extension emblématique de l’euthanasie légale aux mineurs d’âge, les gauches laïques belges, tous sexes (linguistiques) confondus s’en prennent au patronyme familial multiséculaire. Le petit Poucet cdH se rebiffe, sous les sarcasmes les Lalieux (PS), Gerkens (Ecolo) et autres Bacquelaine (MR) : que du bonheur avant les élections du 25 mai. Lu dans « La Libre » de ce jour sous la signature de A. C. (Clevers Antoine) :
Vous avez dit un synode à Rome sur la famille ? En Belgique, après l’extension emblématique de l’euthanasie légale aux mineurs d’âge, les gauches laïques belges, tous sexes (linguistiques) confondus s’en prennent au patronyme familial multiséculaire. Le petit Poucet cdH se rebiffe, sous les sarcasmes les Lalieux (PS), Gerkens (Ecolo) et autres Bacquelaine (MR) : que du bonheur avant les élections du 25 mai. Lu dans « La Libre » de ce jour sous la signature de A. C. (Clevers Antoine) :