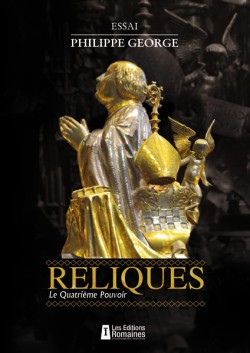Le Figaro Magazine consacre un reportage à ce haut lieu de mémoire et de spiritualité de la Russie orthodoxe; à découvrir ici : http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/11/01003-20131011ARTFIG00360-les-solovki-iles-sacrees-iles-martyres.php
Histoire - Page 153
-
Un reportage sur les îles Solovki où naquit le Goulag en 1923
-
Espagne : 522 martyrs de la Guerre Civile béatifiés
L'Église béatifie 522 nouveaux martyrs de la guerre d'Espagne
De Radio Vatican :
Ce dimanche, 522 martyrs de la guerre d’Espagne ont été béatifiés à Tarragone en Catalogne, lors d’une cérémonie présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la congrégation pour les causes des Saints. Une cérémonie exceptionnelle à laquelle ont participé de très nombreux prêtres, religieux et religieuses et de familles des martyrs.
Parmi les 522 nouveaux bienheureux figurent trois évêques, 82 prêtres diocésains, 3 séminaristes, 412 consacrés et 7 laïcs provenant de différents diocèses espagnols. Ils ont été tués pour la plupart entre 1936 et 1939 par les forces républicaines. Sept d'entre eux étaient étrangers: trois Français, un Cubain, un Colombien, un Philippin et un Portugais.
La Guerre civile espagnole est encore un sujet de division dans le pays. L’Eglise ayant souvent été accusée de soutenir le franquisme. La Conférence épisocpale espagnole a d'ailleurs présenté ces Bienheureux comme des "martyrs du XXème siècle". Le 28 octobre 2007, Benoît XVI avait béatifié 498 martyrs sur la place Saint-Pierre, trois jours avant l'examen au Parlement espagnol de la loi de réhabilitation des victimes du franquisme, voulue par le premier ministre de l’époque José Luis Zapatero.
L’hommage du Pape à leur témoignage
A l’issue de l’Angélus ce dimanche place Saint-Pierre, le Pape a salué l’exemple de ces nouveaux bienheureux : « Aujourd’hui à Tarrogone en Espagne, ont été proclamés bienheureux près de cinq-cents martyrs, tués en raison de leur foi durant la guerre civile espagnole, pendant les années trente. Louons le Seigneur pour leurs courageux témoignages, et par leur intercession, supplions-le de libérer le monde de toute violence ».a dit le Pape.
François a également enregistré un message vidéo qui a été retransmis au cours de la cérémonie espagnole. Un message dans lequel il demande aux nouveaux martyrs d’intercéder pour que nous ne soyons pas des chrétiens « sans substance », eux qui étaient des chrétiens « jusqu’au bout ».
-
Livres en Famille : des livres d'actualité pour défendre la vie, la famille...
CES LIVRES QUI FONT L’ACTUALITE
Anne-Charlotte Lundi - Tel : (00.33.(0)6 11 04 82 59)
- Chronique du choc des civilisations 2013, Aymeric Chauprade, 31 €
- Histoire passionnée de la France, Jean Sévillia, 25 €
- Et la France se réveilla –Enquête sur la révolution des valeurs, V. Trémolet de Villers… 18 €
- Le combat de l’Eglise contre l’avortement, Laurent Aventin, 15 €
- Témoins de Jéhovah – Les missionnaires de Satan, Robin de Ruiter & Laurent Glauzy, 23€
- Vatican II, une histoire à écrire, Roberto de Mattei, 25 €
LES GRANDS THEMES D’ACTUALITE
Défense de la Famille, défense de la Vie, Pour une société selon le droit naturel… http://www.livresenfamille.fr/
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Histoire, Livres - Publications, Politique, Société 0 commentaire -
Ce soir sur Arte : l'horreur du génocide perpétré par les Khmers Rouges
"L'Image manquante": retour sur le drame cambodgien; de François Forestier sur TéléObs
Film de Rithy Panh, ce mercredi à 20h50 sur Arte.
L'image manquante
Le cinéaste du massacre : Rithy Panh, enfant du drame cambodgien, a consacré son oeuvre à son pays. Depuis "Cambodia, entre guerre et paix" (1991) jusqu'à "l'Image manquante" (2013), en passant par "Un soir après la guerre" (1997) et "S21, la machine de mort khmère rouge" (2002), tous ses films se réfèrent à la période de la dictature communiste (1975-1979), qui a fait plus de deux millions de morts (soit un quart de la population), période qui n'a rien à envier à la bestialité nazie. Le mystère demeure sur l'aveuglement des grandes puissances, sur la complicité des partis maoïstes, sur la raison profonde de ce sang versé.
Ce qui demeure, en revanche, c'est l'extraordinaire traumatisme dont Rithy Panh se fait le témoin : fils d'une famille de paysans (mais son père fut aussi instituteur), le cinéaste a, dans sa jeunesse, été interné dans un camp de concentration : ses parents, ses proches, ses amis, eux, ne s'en sont pas sortis. Rithy Panh, par miracle, a survécu. Destiné à être menuisier, il a choisi de suivre des cours de cinéma à son arrivée en France, dans les années 1980. Et dès ses débuts de cinéaste, il a consacré ses films au Cambodge. "Les Gens de la rizière" (1994) est l'histoire d'une famille de cultivateurs dont le destin est celui du malheur : c'est la préfiguration des autres oeuvres de Panh. Où est passé ce pays qu'il a connu dans son enfance ? Disparu, balayé par l'ouragan de la dictature. Seul le cinéma pourra (peut-être) faire retrouver l'identité de la tradition khmère : désormais, Rithy Panh se consacre à la collation des images datant de l'ère communiste, images rassemblées au Centre des Ressources audiovisuelles du Cambodge.
Dans son dernier film, "l'Image manquante", prix de la section "Un certain regard" du Festival de Cannes 2013, le cinéaste constate, cependant, que les images, justement, manquent. De cette absence il tire des passionnantes questions sur l'Histoire et l'oubli. Que sommes- nous sans images ? Qui sommes-nous sans le cinéma ? Rithy Panh est un artiste de la mémoire.
François Forestier
-
Espagne, 13 octobre : béatification de 522 martyrs de la Guerre Civile
Lu sur Aleteia :
522 martyrs de la guerre civile espagnole béatifiés le 13 octobre
Ce sera la plus vaste béatification collective dans l’histoire du pays.
Tarragone se prépare à accueillir dimanche prochain, 13 octobre, la cérémonie de béatification de 522 martyrs de l’Espagne du XXe siècle, baptisée la Béatification de l’Année de la foi.
Cette cérémonie exceptionnelle, qui se déroulera à 12h, en plein air, dans le Complexe éducatif de la ville tarragonaise, sera présidée par le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le cardinal Angelo Amato, qui représentera le pape François. Il sera accompagné par 93 évêques, dont le président de la Conférence épiscopale espagnole, cardinal Antonio María Rouco Varela, et l’archevêque de Tarragone, Jaume Pujols, ainsi que par «tous» les prélats catalans. Seront également présents plus de 1.200 prêtres, 2.200 religieux et de nombreuses autorités et familles des martyrs. Près de 20.000 personnes sont attendues pour la Messe.
Parmi les 522 martyrs, figurent trois évêques, 82 prêtres diocésains, 3 séminaristes, 412 consacrés et sept laïcs provenant de différents diocèses espagnols. L’évêché d’Orihuela-Alicante, par exemple, qui compte 4 martyrs, a organisé un grand pèlerinage à Tarragone pour tous les prêtres, religieux et laïcs désireux de vivre ce moment historique.
Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Histoire, Persécutions antichrétiennes, Témoignages 0 commentaire -
Quand les couvents de Rome offraient un refuge aux juifs lors de l'Occupation
Les couvents de Rome, refuges des juifs sous l'Occupation
Un texte inédit de Saul Israel publié par L'Osservatore Romano (Zenit.org)
Pour le professeur Giorgio Israel, mathématicien italien, « l’ouverture [aux juifs] des portes de couvents et de maisons religieuses » sur ordre de Pie XII est « une évidence ».
Son père, Saul Israel, médecin et écrivain juif de Salonique (1897-1981), citoyen italien, a subi la persécution nazi-fasciste et a trouvé refuge au couvent de Saint-François, rue Merulana, à Rome (cf. Ci-joint, le document inédit, Zenit du 8 octobre 2013, dans notre traduction intégrale de l'italien).
Le témoignage complet de Paul Israel a été publié il y a quatre ans, dans « Pour la défense de Pie XII. Les raisons de l’histoire » (« In difesa di Pio XII, Le ragioni della storia », Venise, Marsilio, 2009).
Or, un texte inédit vient d'être retrouvé par son fils Giorgio: « En mettant de l’ordre dans les papiers de mon père je suis tombé sur un autre document dont j’ignorais l’existence, qui constitue un témoignage encore plus direct et tissé d’éléments factuels », explique Giorgio Israel dans L'Osservatore Romano.
Il s'agit d'un brouillon d’une « déclaration envoyée à l’Association Guglielmo Pallavicini à l’occasion de la cérémonie commémorative en l’honneur de Pie XII qui a eu lieu à Zagarolo le 29 juin 1965 ».
« Lire (ou relire) ce document n’est pas inutile aujourd’hui, étant donné que ce qui passait alors pour une évidence — « l’ouverture [aux juifs] des portes de couvents et de maisons religieuses » sur ordre de Pie XII, comme chacun savait » — ne semble plus l’être », fait-il observer.
Giorgio Israel rend également hommage aux « prêtres cités pour leur engagement généreux ».
-
Vous avez dit : "reliques" ?
RELIQUES. LE QUATRIÈME POUVOIR
Qu’est-ce qu’une relique ? À quoi servent les reliques ? Comment s’est développé leur culte ? Quelles sont les grandes reliques vénérées en Europe ? D’un abécédaire à un dictionnaire des grandes reliques, sous des allures à la fois de manuel ou d’ouvrage scientifique universitaire, ce livre se propose de répondre à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet.
Le Moyen Âge a vécu un long développement du culte des saints, qui imprègne les mentalités. Les reliques y ont joué un rôle considérable, car le saint est considéré comme présent et puissant par leur intermédiaire. Si les ossements sont les reliques par excellence, il existe toute une série d’autres reliques. Le Saint Suaire et la Sainte Croix sont bien connus, et les ostensions ou les pèlerinages séculaires gardent parfois actualité. Trop souvent ne fut retenu que l’aspect spectaculaire des reliques : leur trafic passe pour scandaleux à nos yeux. Mais le domaine de recherche est immense et les centres d’intérêt historique multiples. Les reliques sont des instruments de communication exceptionnels et leur puissance médiatique est profonde dans la société. Le culte des reliques traverse toutes les périodes de l’histoire, depuis l’Antiquité tardive ; il concerne le Christ et chaque saint, groupes de saints, à travers la dévotion vouée par les religieux comme par les laïcs. Les reliques sont devenues un nouveau et vrai champ historique.
La publication systématique des trésors d’églises en cours apporte de nouveaux documents. Ouvrir les châsses avec doigté archéologique permet d’en inventorier le contenu avec rigueur et d’en publier les résultats. Les sources écrites retrouvées éclairent parfois l’histoire d’un édifice religieux ou d’une œuvre d’art – le contenant, le reliquaire – et elles mentionnent des noms de saints, de lieux et de personnages, sans oublier leur intérêt paléographique évident. Les objets archéologiques les accompagnant sont divers. Ici se dessinent « les routes de la foi » et, plus largement, se révèlent les traces des contacts humains, un puzzle extraordinaire à reconstituer et qui sort largement du domaine strictement hagiologique. La circulation des biens et des personnes et les réseaux mis en place sont révélés par ces traces matérielles multiformes, qui concourent grandement à la connaissance du passé. Ici commence « le métier d’historien ».
ISBN 979-10-90523-23-4 Nombre de pages 430 24,85 € (papier) 5 € (pdf)Lien permanent Catégories : Art, Culture, Eglise, Foi, Histoire, Livres - Publications, Patrimoine religieux, Spiritualité 1 commentaire -
Les idéologies du progrès
 Le XXe siècle a été celui de la faillite des idéologies « du progrès », mais aussi de la pensée démocrate-chrétienne. Heureusement, affirme Gregor Puppinck, directeur de l’European Centre for Law and Justice (ECLJ) : le chrétien ne doit pas vivre dans un futur hypothétique mais dans l’« ici et maintenant » du secours à porter à son prochain.
Le XXe siècle a été celui de la faillite des idéologies « du progrès », mais aussi de la pensée démocrate-chrétienne. Heureusement, affirme Gregor Puppinck, directeur de l’European Centre for Law and Justice (ECLJ) : le chrétien ne doit pas vivre dans un futur hypothétique mais dans l’« ici et maintenant » du secours à porter à son prochain.L’excellent hebdomadaire « Famille chrétienne » lui donne ici la parole :
Combien de fois entendons-nous : face aux changements du monde moderne, face à toutes les idéologies visant à changer la société, les chrétiens demeurent dans la situation bête du refus, de la vaine opposition ; ces chrétiens se reprochent alors, avec frustration et un petit sentiment d’infériorité, de ne plus avoir de projet, d’être à sec : plus de vision de l’avenir, plus de vocation. Quels projets, quelle société avons-nous à proposer ? Le peuple s’éloignerait-il d’une Église qui n’aurait plus rien de neuf à proposer ? Les chrétiens seraient expulsés de l’histoire et condamnés à protester contre les progrès et les changements, comme un chien qui aboie au bord de la route sur les voitures qui passent. Nous serions en panne… tant mieux !
Depuis l’époque moderne, les philosophes élaborent des projets de société. Au XXe siècle, les peuples ont été embarqués dans les projets socialistes, communistes et fascistes. Cesprojets promettaient un monde nouveau, meilleur. À chaque fois, il s’agit de projections intellectuelles dans l’avenir, d’imagination d’un monde futur, tant et si bien que l’homme moderne ne vit plus que dans le futur. Ayant rejeté le passé, il est en perpétuelle projection de lui-même. Il doit habiter le futur, avoir des projets, accomplir lespromesses du progrès.
La faillite de la pensée démocrate-chrétienne
Face à aux idéologies des deux derniers siècles, les catholiques ont d’abord répondu en réaffirmant la royauté sociale du Christ hic et nunc, ici et maintenant, puis ils ont adopté sa version édulcorée et laïcisée : la pensée démocrate-chrétienne. Cette pensée n’était plus une affirmation de foi, mais un projet politique tendant à réconcilier le catholicisme et la modernité, en modernisant le premier, et en christianisant la seconde. Ce projet politique temporel était une contre-idéologie visant à concurrencer les socialismes et fascismes. Les opuscules Christianisme et Démocratie et Les Droits de l’homme ont été rédigés par Jacques Maritain en Amérique pendant la Guerre pour contrer les propagandes nazies et communistes. Le second a même été rédigé à la demande du gouvernement américain. Il fallait gagner les imaginations, les aspirations et les consciences politiques des personnes pour instaurer, de façon démocratique, une royauté sociale du Christ. Le respect des droits de l’homme aurait été un moyen de respecter concrètement les droits de Dieu car, en respectant l’homme, c’est Dieu qui aurait été ultimement respecté et honoré.
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Doctrine Sociale, Economie, Enseignement - Education, Ethique, Europe, Histoire, Politique, Religions, Société 1 commentaire -
L'abandon des fêtes chrétiennes ou l'établissement de la société vide de sens
Lu sur le site web de « La Libre » ce point de vue (externe, of course, à la rédaction de ce journal). Sébastien Morgan, auteur de "Devenir soi-même, chronique d'un chrétien du XXIe siècle" s’exprime ici, dans la rubrique « opinions » (1) :
« Le débat de la semaine, lancé par l'anthropologue Dounia Bouzar, est évidemment l'abandon de deux jours fériés chrétiens en France pour les remplacer par l'Aïd et Yom Kippour. Par cette proposition, l'on peut une fois de plus constater dans quel gouffre d'oubli et de négation sombre la France, entraînant sans doute une partie de l'Europe à sa suite. On voudrait gommer le passé, le reléguer dans un musée, l'effacer des mémoires.
Bien sûr que chacun a le droit de fêter ce qu'il veut chez lui : Yom Kippour pour les Juifs, l'Aïd pour les Musulmans, la Tara Verte pour les bouddhistes, Beltaine pour les Wiccans, Thanksgiving pour les expatriés américains ou l'anniversaire du petit... Faut-il pour cela acter officiellement les désidératas particuliers de tout un chacun ?
Bien sûr que non. N'en déplaise au lobbying laïcard athée, la France et l'Europe sont des entités baptisées et chrétiennes. En tant que telles, elles peuvent et doivent être ouvertes à la diversité d'opinion et sans doute de religion dans une certaine limite, mais doit-on pour autant complètement se déraciner dans une sorte de folie moderniste incohérente et libérale ?
Il faut s'entendre sur les mots. Je défends l'idée d'une société traditionnelle opposée à la dite société moderniste. Qu'est-ce à dire ?
Par société traditionnelle, j'entends non pas une société moralement conservatrice, figée, réactionnaire, autoritariste et cloisonnée mais une société qui donne du sens. Or pour donner du sens, il faut s'inscrire dans le passé et s'enraciner dans le temps. « Même une plaisanterie a bien plus d'éclat quand elle a mille ans derrière elle» (2) disait C.S.Lewis. Et il avait raison, car au-delà de la boutade, les fêtes chrétiennes s'inscrivent dans une logique cyclique, rythmant la vie spirituelle et communautaire. Au-delà des croyances individuelles, elles inscrivent la société toute entière dans une logique propre qui est celle du christianisme, à savoir :
-
Les quarante millions de morts du grand bond en avant du président Mao
-
Qui voulez-vous panthéoniser ?
Herodote.net propose de voter pour trois personnalités "panthéonisables". Lesquelles choisiriez-vous ? C'est ici : http://www.herodote.net/retrospectives-18.php#bas
-
Béatifié aujourd'hui : Miroslav Bulešić, un jeune prêtre croate martyrisé par les communistes
Miroslav Bulešić, le curé martyr
2013-09-28 L’Osservatore Romano
Martyrisé avec cruauté uniquement pour avoir assuré son ministère sacerdotal, le jeune curé Miroslav Bulešić (1920-1947), sera béatifié samedi 28 septembre, à Pula en Croatie par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, représentant le Pape François.
Fils de Miho (Michel) et Lucija, Miroslav Bulešić naquit dans un petit village d’Istrie, Čabrunići, dans la paroisse de Svetvinčenat (Saint-Vincent), le 13 mai 1920. Il fréquenta l’école élémentaire à Juršići (1926–1930), où son professeur de religion (catéchiste) fut le zélé père Ivan Pavić. Après le lycée, Bulešić décida de suivre des études de philosophie et de théologie et de se préparer au sacerdoce. Comme curé, il tenta de connaître en personne ses paroissiens pour les conduire à la Messe dominicale. Cette activité était observée de près par les ennemis de l’Eglise dans les files de la Résistance. Ils n’appréciaient pas du tout que le curé ait plus d’influence qu’eux sur ses paroissiens.
A partir du 19 août 1947, il fut confié au père Miroslav Bulešić la tâche d’administrer la confirmation à Pazin. Les responsables du séminaire ne savaient rien des désordres et des agressions organisés par les communistes. Au début, autour de Pazin, la confirmation fut donnée sans difficulté, mais bien vite il y eut des barrages sur les routes pour bloquer les confirmands, afin qu’ils ne puissent pas rejoindre leurs paroisses respectives. Les militants communistes attaquaient les prêtres et les enfants et se moquaient d’eux publiquement. C’est dans ce climat que Bulešić arriva à Lanišće le 23 août 1947 et y passa la nuit avec l’intention d’administrer la confirmation le lendemain. Quand il arriva au presbytère avec l’envoyé de l’évêque de Trieste, il confirma sept autres filles et garçons en plus qui, à cause des troubles et des barrages, n’étaient pas parvenus à arriver à temps à l’église. Peu après fit irruption dans la maison un groupe de communistes, qui s’acharnèrent en particulier et avec plus de violence sur le jeune père Miroslav, en le frappant sans pitié, partout où ils le purent. Plusieurs témoins regardaient impuissants de l’extérieur ce qui était en train de se passer. Le père Miroslav était couvert de sang. Par deux fois, ils l’ont entendu s’exclamer : « Jésus, accueille mon âme ». Puis son assassin lui trancha la gorge avec un couteau. Le sang du martyr recouvrit les murs et le sol. Il était environ 11h00 le 24 août 1947.
Jure Bogdan, postulateur
Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Histoire, Persécutions antichrétiennes, Témoignages 0 commentaire