Lu sur le site web « Benoît et moi » :
« L’Eglise, en niant le péché originel, suit le monde mais se condamne elle-même à l’insignifiance. Un monde sans péché originel est capable de se débrouiller tout seul, de se donner le salut à son propre niveau, il est autonome et n’a pas besoin de Dieu ou de l’Église. Et l’Eglise, qui était indispensable, devient simplement (éventuellement) utile. Mais « être ‘utile à …’ sans préciser à quoi, c’est laisser au monde le soin de clarifier, selon ses catégories à lui, ce à quoi elle peut et doit être utile », faisant ainsi d’elle une agence mondial(ist)e de plus. Très intéressante réflexion de la rédaction de la Bussola, dans sa rubrique « doctrine sociale de l’Eglise ».(www.lanuovabq.it/it/dalla-chiesa-utile-alla-chiesa-inutile) »
Voici la traduction française de cet article publiée par les soins de « Benoît et moi » :
« Quand l’Église se considère uniquement utile au monde, elle finit rapidement par se considérer comme inutile. Naturellement, à ce point, même sa Doctrine sociale est parvenue au terminus
Dans l’encyclique Caritas in veritate, on lit que le christianisme est non seulement utile mais nécessaire au développement de l’homme (n. 4), car « sans Dieu, l’homme ne sait pas où aller et ne peut même pas comprendre qui il est » (n. 78). Nécessaire signifie qu’il ne peut pas être absent, utile signifie par contre une présence accidentelle qui, si elle est là, produit un certain effet positif mais non essentiel, et si elle n’est pas là, ne cause aucun dommage. Selon Augusto Del Noce (comme il le dit dans Il problema dell’ateismo), le mode de penser de la modernité a transformé le christianisme de nécessaire à utile parce qu’il a fait du péché un simple accident que la dialectique historique ou la praxis humaine sont capables de surmonter d’elles-mêmes. La sécularisation du péché et, surtout, la négation du péché originel, ont produit un christianisme utile mais pas indispensable.
Un monde sans péché originel est capable de se débrouiller tout seul et de se donner le salut à son propre niveau, il est autonome et n’a pas besoin de Dieu ou de l’Église. Même un monde anéanti par le péché originel – comme c’est le cas dans la vision protestante – n’a pas besoin de Dieu et même dans ce cas, la religion et l’Église n’ont pas de fonction essentielle et irremplaçable. Dans le premier cas parce que le monde pense qu’il peut tout faire par lui-même, dans le second parce que le monde pense qu’il ne peut rien faire d’aucune manière, Dans les deux cas le monde est autonome, adulte, maître de lui-même.
Dans l’Église catholique, nous assistons depuis quelque temps à son retrait du monde et en même temps à son immersion dans le monde. Le retrait concerne sa conviction de ne plus avoir quelque chose de décisif et d’indispensable à apporter au monde; l’immersion dans le monde découle de cette même conviction selon laquelle elle ne croit plus avoir de spécificité (ou de mission) par rapport au monde. L’Église se considère seulement utile, mais il y a beaucoup de choses utiles et le monde les utilise mais n’a réellement besoin d’aucune d’elles. L’Église devient l’un des nombreux organismes utiles mais aussi, pour cette raison même, inutile. Si sa présence dans le monde vient à faire défaut, personne ne le remarque, pas même les hommes d’Église.
De cette conviction qu’elle n’est qu’utile, nous avons eu de nombreuses preuves, surtout ces dernières années et même ces derniers jours. L’Église qui ne défend plus la loi naturelle, qui ne défend plus sa propre doctrine sur les questions morales décisives, qui ne défend plus la vie, le mariage, la gestion correcte de la sexualité, qui accepte la fermeture des églises par décret gouvernemental, qui ne veut plus rien de « catholique » dans la société… est une Église qui, après s’être considérée comme utile, en vient à se considérer comme inutile.
Aujourd’hui, l’Église veut être utile dans la défense de l’environnement en collaborant avec les agences internationales, elle veut travailler pour défendre la démocratie contre le danger du populisme, elle se veut très « constitutionnelle » dans la défense de la Constitution républicaine, elle pense être utile non pas en condamnant les lois injustes mais en travaillant pour les améliorer, Elle veut être utile en abattant les murs et en bénissant tout ce que la société exprime ; pour pouvoir être utile à l’accueil ou à la réconciliation, elle renonce à préciser sa propre doctrine ; face à chaque problème, elle ne se montre plus intéressée par le quoi mais par le comment, proposant seulement des voies utiles de dialogue, de confrontation et d’unité.
Mais une Église utile ainsi est déjà inutile. Être « utile à … » sans préciser à quoi, c’est laisser au monde le soin de clarifier, selon ses propres catégories, ce à quoi elle peut et doit être utile. L’Église, pour être utile, a choisi de renoncer à avoir l’exclusivité des fins ultimes, qui donnent un sens à toutes les fins intermédiaires. Ce faisant, elle est devenue inutile. Une agence parmi d’autres dédiée au dialogue, à la fraternité, à l’accueil, à l’accompagnement, à la proximité, à la solidarité, à la tolérance, au « marcher » ensemble, à l’inclusion, à la durabilité. »
Ref. De l’Eglise utile à l’Eglise inutile
La tentation mondaine est vieille comme l’Eglise, et la carte de la (dé-) christianisation fluctue au gré des siècles. Reste l’ultime question posée par le Christ lui-même et à laquelle il n’a pas répondu car il en a confié le soin à notre liberté : quand le Fils de l’Homme reviendra sur la terre trouvera -t-il la foi ?
JPSC
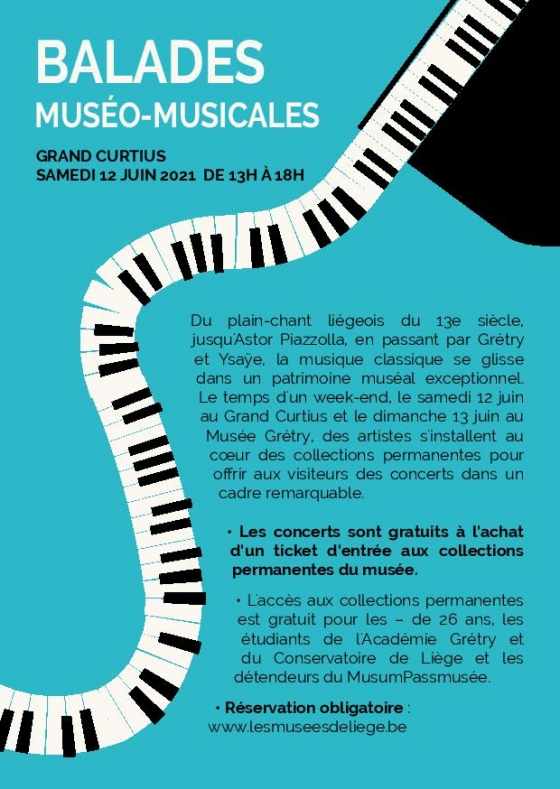
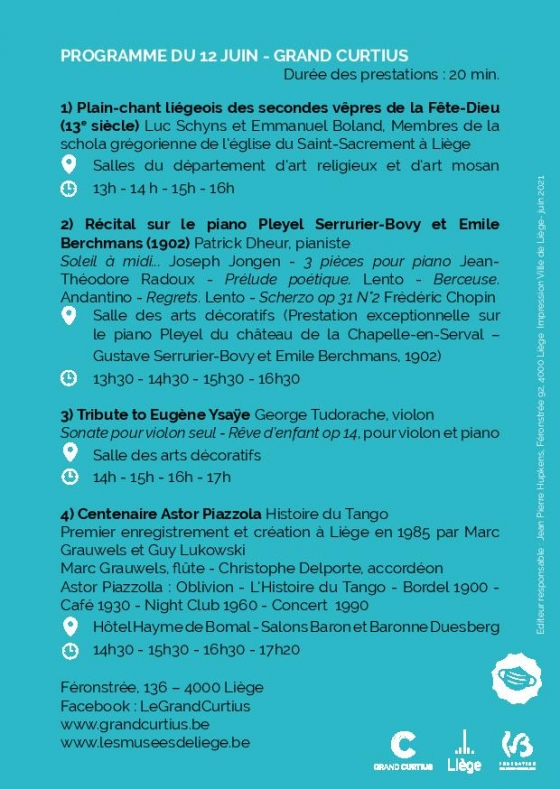
 « Sarajevo (kath.net/ Maria 1.0) Lorsque le pape Saint Jean-Paul II l'a accepté au Collège des cardinaux le 26 novembre 1994, Vinko Puljić, 49 ans, était le plus jeune cardinal. Aujourd'hui, le cardinal Vinko Puljić est archevêque de Vrhbosna (Sarajevo). L'archidiocèse de Sarajevo a ses origines au 7ème siècle. En 1881, il fut rétabli en tant qu'évêché. L'archevêché est situé à l'est de la Bosnie-Herzégovine et borde la Croatie au nord, la Serbie à l'est et le Monténégro au sud. Le diocèse comprend des parties de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République serbe. Mgr Puljić n'est pas seulement le curé de son diocèse mais, en tant que cardinal, également membre de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. En décembre 2020, l'homme de 75 ans a survécu à une grave maladie COVID-19. "Marie 1. 0 » a parlé au cardinal Puljić. L'interview a été arrangée par Thommy M. Schott et traduite par Dinka Mihic. Les questions sont posées par Clara Steinbrecher, responsable de l'initiative Maria 1.0.
« Sarajevo (kath.net/ Maria 1.0) Lorsque le pape Saint Jean-Paul II l'a accepté au Collège des cardinaux le 26 novembre 1994, Vinko Puljić, 49 ans, était le plus jeune cardinal. Aujourd'hui, le cardinal Vinko Puljić est archevêque de Vrhbosna (Sarajevo). L'archidiocèse de Sarajevo a ses origines au 7ème siècle. En 1881, il fut rétabli en tant qu'évêché. L'archevêché est situé à l'est de la Bosnie-Herzégovine et borde la Croatie au nord, la Serbie à l'est et le Monténégro au sud. Le diocèse comprend des parties de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République serbe. Mgr Puljić n'est pas seulement le curé de son diocèse mais, en tant que cardinal, également membre de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. En décembre 2020, l'homme de 75 ans a survécu à une grave maladie COVID-19. "Marie 1. 0 » a parlé au cardinal Puljić. L'interview a été arrangée par Thommy M. Schott et traduite par Dinka Mihic. Les questions sont posées par Clara Steinbrecher, responsable de l'initiative Maria 1.0.


 La Pentecôte (d’un mot grec qui veut dire le cinquantième jour) est l’octave double et jubilaire de la fête de Pâques (7 X 7 + 1). C’est en même temps le second point culminant du cycle festif de Pâques. A Pâques, le Christ, le divin Soleil, s’est levé ; à la Pentecôte, il est à son zénith, il chauffe, mûrit et apporte la vie.
La Pentecôte (d’un mot grec qui veut dire le cinquantième jour) est l’octave double et jubilaire de la fête de Pâques (7 X 7 + 1). C’est en même temps le second point culminant du cycle festif de Pâques. A Pâques, le Christ, le divin Soleil, s’est levé ; à la Pentecôte, il est à son zénith, il chauffe, mûrit et apporte la vie.
