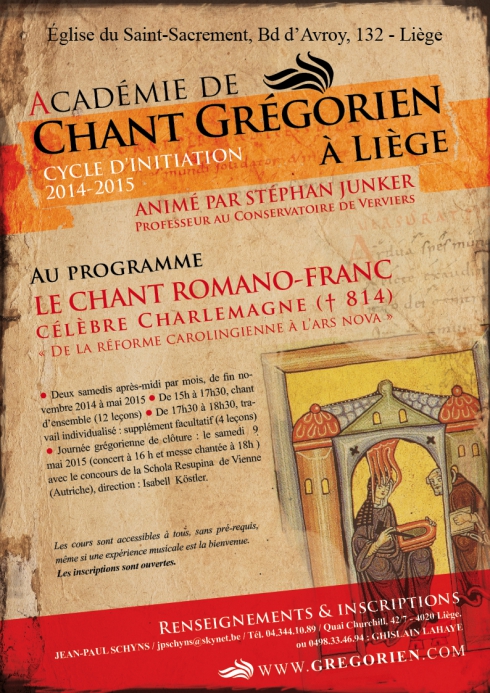En Belgique, les « patros » se sont distanciés de l’Eglise « institutionnelle » C’est du moins ce qu’ils ont déclaré dans un communiqué du 23 novembre 2013: « Nous faisons référence à Jésus, l’homme, sa vie, ses valeurs, son message et non à l’Eglise institutionnelle ». Quand à la divinité de Jésus, passons...
La situation est-elle meilleure en France ? Le blog « Salon Beige nous apprend que:
« (…) Le 11 novembre prochain, le patronage du Bon Conseil organise à Paris, en partenariat avec Famille Chrétienne, un colloque sur le thème : « L’Église a-t-elle encore quelque chose à faire en éducation ? L’exemple des patronages ». L’abbé Vincent de Mello, fondateur du patronage, indique :
"Quand l’Église a été congédiée de sa mission éducative par la séparation de l’Église et de l’État, elle a investi les patronages pour compenser. Après la guerre, les patronages ont eux-mêmes été abandonnés. L’idée selon laquelle l’Église aurait alors perdu le sens de sa mission éducative n’est pas tout à fait fausse.
Les patronages, qui ne sont ni l’école, ni un cours de catéchisme, mais une école d’amitié, ont donc été abandonnés, parce que l’Église a considéré que ce n’était pas le rôle du prêtre d’être animateur d’un club de foot. Elle a préféré se concentrer sur ses missions premières, son « service public » propre, les sacrements. Elle a ainsi déserté un front considérable, qui a été réinvesti par des Maisons des jeunes et de la culture (MJC).
Mais ce n’est pas avant tout une question de moyens, mais de décision politique, de la façon dont l’Église a défini ses priorités. Le terrain non catéchétique a semblé inutile. Je pense au contraire, qu’il est indispensable, que cette gratuité est très importante. La devise des patronages est « Ici on joue, ici on prie ». Le jeu permet à l’enfant de se créer un imaginaire, le jeu éveille son âme, l’ouvre à la possibilité d’un autre monde, et rend plausible l’existence de l’autre monde dans lequel nous introduit la liturgie.
N’est-ce pas plutôt que l’Église a renoncé à régenter la vie entière des individus ?
Il y a là sans doute de l’idéologie. Mais c’est plus complexe. Beaucoup ont pensé que la formule des patronages était usée, vieillotte, peu « modernisable ». L’abandon de ce terrain a peut-être aussi été accentué par une paranoïa autour de la crise de la pédophilie dans l’Église.
Mais l’Église a aussi voulu se spécialiser, et laisser l’éducation à des spécialistes. L’école catholique a ainsi cloisonné la pastorale, l’enseignement et l’éducation. C’est une démarche exactement opposée à celle qui animait jusque-là les traditions éducatives catholiques, des jésuites comme des oratoriens.
Les professeurs aujourd’hui se cantonnent à leur seul rôle d’enseignant. Il faut au contraire réfléchir à la façon d’en faire aussi des éducateurs. Dans cet esprit, nous proposons par exemple que les surveillants ne soient pas seulement des pions, mais jouent avec les enfants et les collent si nécessaire.
[...] La demande des parents est grande, et va bien au-delà des familles catholiques. La plupart des enfants de mon patronage ne sont pas catholiques. Pourquoi les familles se tournent-elles vers l’Église ? Parce qu’elle peut donner un accompagnement de qualité. Elle a pour atout un savoir ancestral, facile à retrouver, des ressources pédagogiques considérables.
Aujourd’hui, il nous est possible de développer notre « caractère propre », tout en étant en règle avec la législation, qui ne limite pas la portée évangélisatrice des patronages. Au contraire, le prêtre y retrouve un contact avec beaucoup de gens qu’il ne pourrait toucher autrement. La figure du prêtre est une figure paternelle, qui porte l’amour maternel de l’Église. Sa présence concourt à donner un climat de charité fraternelle. Sa figure a une signification sacramentelle que les parents perçoivent. Cela donne lieu à des demandes de baptême par exemple. Michel Janva ».
Ref. Le terrain non catéchétique est indispensable pour l'Eglise
JPSC