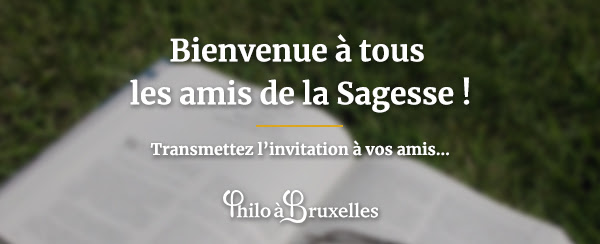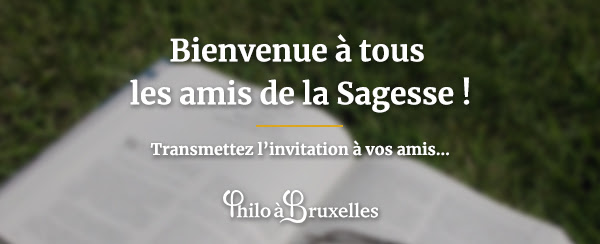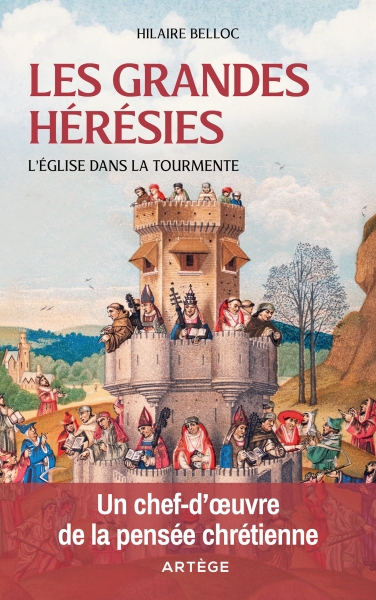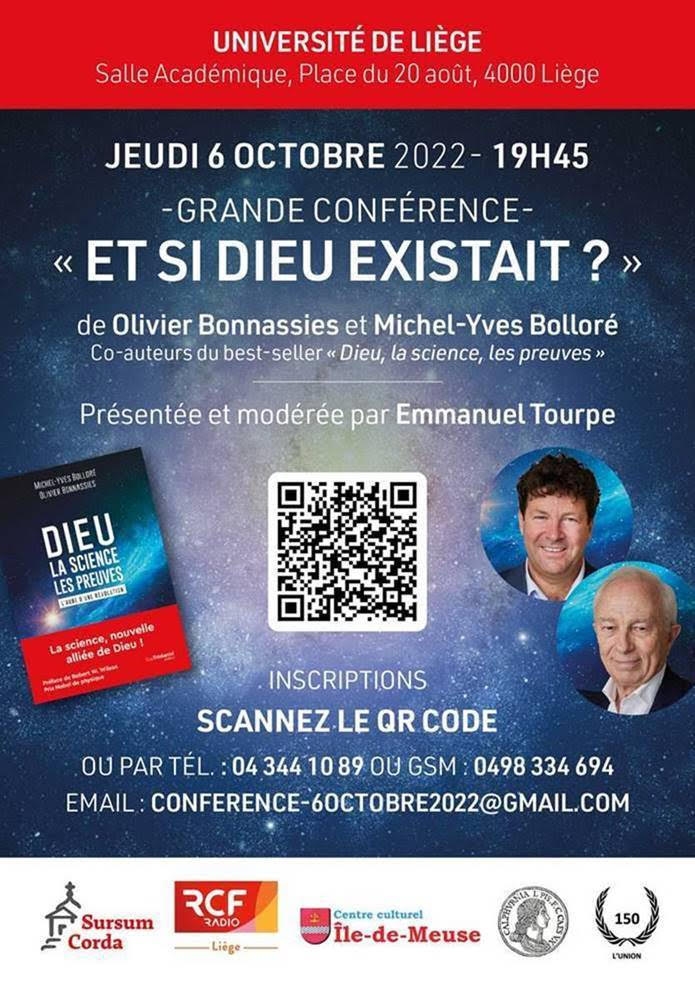Stéphane Mercier nous présente le nouveau cycle 2022-2023

Voici le programme des 9 conférences :
C’était, dit-on, l’habitude d’Aristote d’enseigner la philosophie en se promenant, ou de dispenser ses leçons dans un lieu désigné pour la promenade, et c’est à ce type de promenades philosophiques que nous vous convions pour la saison 2022/2023 de Philo à Bruxelles.
Des promenades, donc, pour l’esprit, car vous pourrez les suivre en demeurant assis, à moins que vous ne préfériez les écouter en replay en vous promenant véritablement, pour un bénéfice double du corps et de l’esprit !
Nous vous proposons, cette année, neuf conférences sur des sujets qui tendent ensemble à explorer les conditions d’un agir vertueux animé par l’amour de la sagesse.
Nous commencerons, dans la première conférence de ce cycle, par porter un regard sur la pensée contemporaine, pour découvrir l’imprégnation kantienne de nos esprits. Oui, nous sommes tributaires de Kant, et c’est chez Kant qu’il faut aller chercher non la source unique, mais l’une des racines de l’agnosticisme contemporain. Prendre la mesure du mal, c’est en même temps éprouver le besoin du remède, de sorte que ce diagnostic porté sur l’agnosticisme hérité de Kant, nous invitera, une fois encore, à renouer avec saint Thomas d’Aquin.
À ce premier exposé succédera une deuxième conférence, où saint Thomas viendra couronner une antique réflexion du monde grec sur les vertus cardinales. Après avoir parlé, l’an dernier, des péchés capitaux, il n’est en effet pas inutile de déployer l’histoire des vertus qui structurent une vie équilibrée et aussi humainement réussie que peut l’escompter la nature.
Cette centralité de la vertu nous suggérera la matière d’une troisième conférence : si la vertu est au cœur de la philosophie, c’est que la théorie n’est pas et ne doit surtout pas être déconnectée de la pratique. Le fossé entre théorie et pratique n’a pas cessé de s’approfondir depuis des siècles alors que la pensée grecque non seulement envisageait la philosophie dans sa dimension spéculative, mais considérait aussi la grave nécessité de traduire dans la pratique son enseignement. Cette idée d’une philosophie comme mode de vie est également au cœur de ce que l’on peut désigner, à l’autre extrémité du continent eurasiatique, comme la pédagogie morale inscrite au cœur de la tradition confucianiste. Cette troisième conférence proposera donc de croiser les perspectives entre Occident et Orient lointaine.
L’idée tellement grecque d’une philosophie conçue comme mode de vie orienté vers l’acquisition de la sagesse permet de mieux comprendre, comme nous le ferons dans une quatrième conférence, pourquoi ceux qu’on a appelés les Pères apologistes, ces écrivains chrétiens du deuxième siècle, se sont efforcés de montrer et de démontrer que le christianisme, loin d’être imputable au dérèglement d’un quarteron de forcenés factieux, réalisait supérieurement l’objectif de la philosophie comme amour de la sagesse : au lieu d’une sagesse humaine, trop humaine, le christianisme est en effet l’amour de la Sagesse éternelle, de Dieu lui-même, maître et origine de toute chose.
Parmi les philosophies antiques qui connaîtront une fortune remarquable en régime chrétien, une en particulier met l’accent sur la pratique : c’est le stoïcisme. La cinquième conférence nous permettra de suivre les étapes de cette intégration de la pensée et de la discipline stoïciennes dans le monde chrétien depuis la fin de l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne.
La conscience occidentale, au milieu du dix-septième siècle, est revenu quelque peu de sa fascination pour l’antique philosophie, pour se montrer volontiers sceptique. C’est à l’aspect le plus stimulant de ce recul, de cette prise de distance, que sera consacrée la sixième conférence. Suivant le mot de Pascal : « se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher » : nous parlerons de la place de l’humour, du rire ou du sourire, et certainement de la détente en philosophie.
Dans la septième conférence, nous aborderons le problème du mal chez saint Augustin en particulier, mais, renouvelant la perspective comparatiste qui nous avait servi dans la troisième conférence, nous ferons le lien entre Augustin et Xunzi, l’un des plus remarquables et des principaux représentants de l’antique pensée confucianiste. Lui aussi, soucieux d’affronter la question du mal dans une perspective certes très différente certes de la perspective occidentale, jette sur elle un éclairage bien digne d’intérêt.
S’agissant d’un problème de première importance, le mal nous occupera encore dans la huitième conférence, où cette fois nous verrons comment la Révélation de l’Ancien Testament, et du livre de Job en particulier, s’intègre au contexte culturel du Proche-Orient ancien pour en dépasser les antiques perspectives comme plus tard la pensée chrétienne sera le levain dans la pâte culturelle du monde gréco-romain.
La philosophie, la pensée, la Révélation : autant d’événements qui se produisent dans le temps et nous invitent à réfléchir sur la nature du temps. Nous reviendrons à saint Augustin pour nous servir de guide dans la neuvième conférence, la dernière de ce cycle : qu’est-ce que le temps ? le temps de l’homme et celui des hommes, le temps de mon histoire personnelle, et celui de l’Histoire avec une majuscule. Les vicissitudes du temps, son passage et les modalités de son déroulement nous invitent à voir dans le temps un tremplin vers l’éternité, à suspendre le cours du temps au présent éternel et immuable de Dieu. Et cette suspension du temps nous signifiera opportunément qu’il est temps, avec cet exposé, d’achever la promenade de ce cycle pour l’année 2022-2023.
Au plaisir de vous retrouver le mardi 18 octobre, à 19 h 30 pour entreprendre la première de ces promenades philosophiques !
Regarder la courte vidéo de présentation
Retrouvons-nous le mardi prochain,
18 octobre, à 19 h 30, pour la
Conférence de rentrée avec Stéphane Mercier sur le thème
Kant, marâtre de l’agnosticisme contemporain.
Adresse
À la Bécasse
Rue de Tabora 11, 1000 Bruxelles
salle à l’étage
Je m’inscris
Vous pouvez également suivre la conférence en direct ici.

Kant, marâtre de l’agnosticisme contemporain
ou : Comment conserver la santé mentale avec une belle-mère métaphorique, mais néanmoins encombrante ?
De quoi sera-t-il question ? D’un sujet grave et sérieux, pour commencer, et strictement philosophique celui-là.
Qui d’entre nous a lu Kant ? Moi certes un peu, quand je le devais et que je parvenais à garder les yeux ouverts devant le dénuement glacé et l’accablante technicité de sa prose, que j’avoue cependant ne connaître que par traduction interposée. Mais il n’est pas nécessaire d’avoir lu Kant pour être kantien : ce sera le sujet de notre première conférence. Pour le dire d’un mot, Kant est la marâtre de l’agnosticisme contemporain, l’éminence grise qui, en coulisses, rend compte d’un état d’esprit largement répandu chez nous, Occidentaux, qui, à cause de Kant, nous sommes si universellement murés dans un scepticisme qui ne nous empêche pas de dogmatiser.
De Dieu, diront en effet beaucoup de nos contemporains avec l’aplomb de ceux qui détiennent un savoir certain, de Dieu nous ne pouvons pas dire s’il est ou s’il n’est pas. Dogmatisme et scepticisme. S’agit-il de deux postures contradictoires ? Pas du tout : nous verrons, en effet, comment la pensée de Kant explique la catastrophe agnostique contemporaine. Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir ; et nous sommes, nous, beaucoup plus kantiens que nous ne l’imaginons. Heureusement, on peut sortir de l’impasse kantienne par le haut, en particulier avec l’aide de saint Thomas : le Docteur d’Aquin, le « génie intelligent » (pour reprendre l’expression du P. dominicain Charles-Damien Boulogne), nous prescrira le remède qui nous permettra de ne pas étouffer en demeurant confinés avec l’envahissante marâtre de Königsberg.
Quand ? Mardi 18 octobre à 19 h 30
Où ? À la Bécasse Rue de Tabora 11, 1000 Bruxelles Salle à l’étage
Séance de questions & réponses à la fin de la conférence, sur place. Pour les téléspectateurs, envoyez vos questions par chat, en direct sur YouTube ou par SMS, Telegram, Signal, email, formulaire de contact etc.)
Mardi 15 novembre : Petite histoire des vertus cardinales, de Platon à saint Thomas.
Mardi 13 décembre : Progrès spirituel et discipline de vie en Orient et en Occident : perspectives croisées.