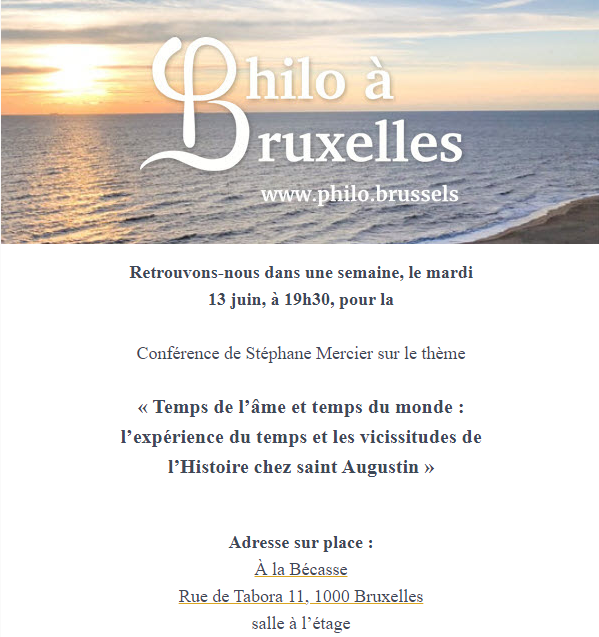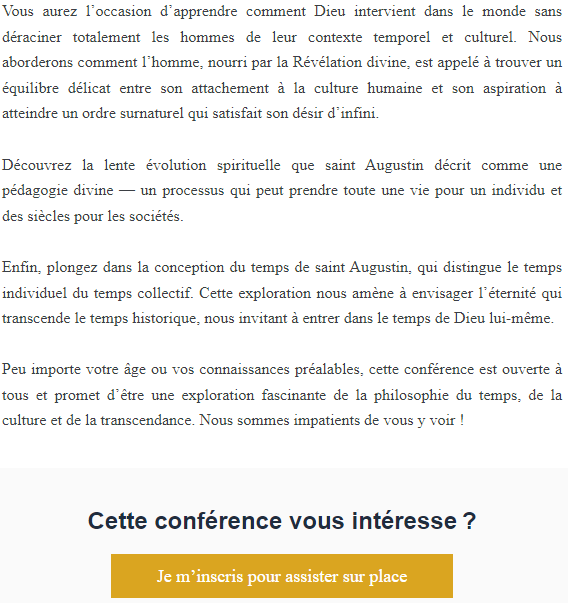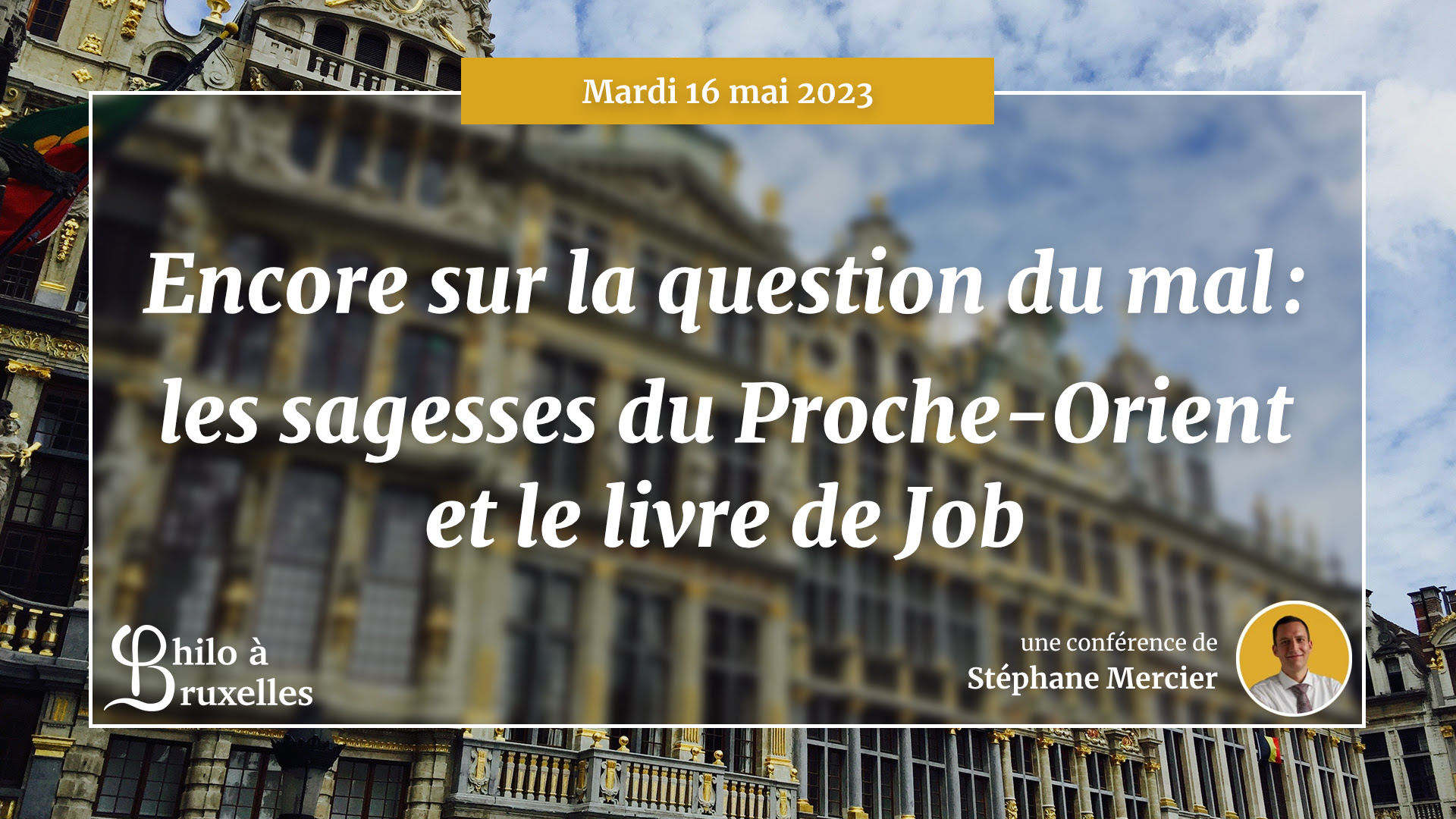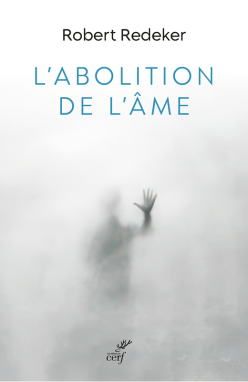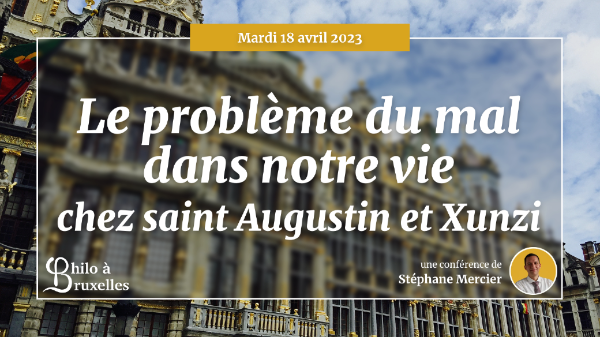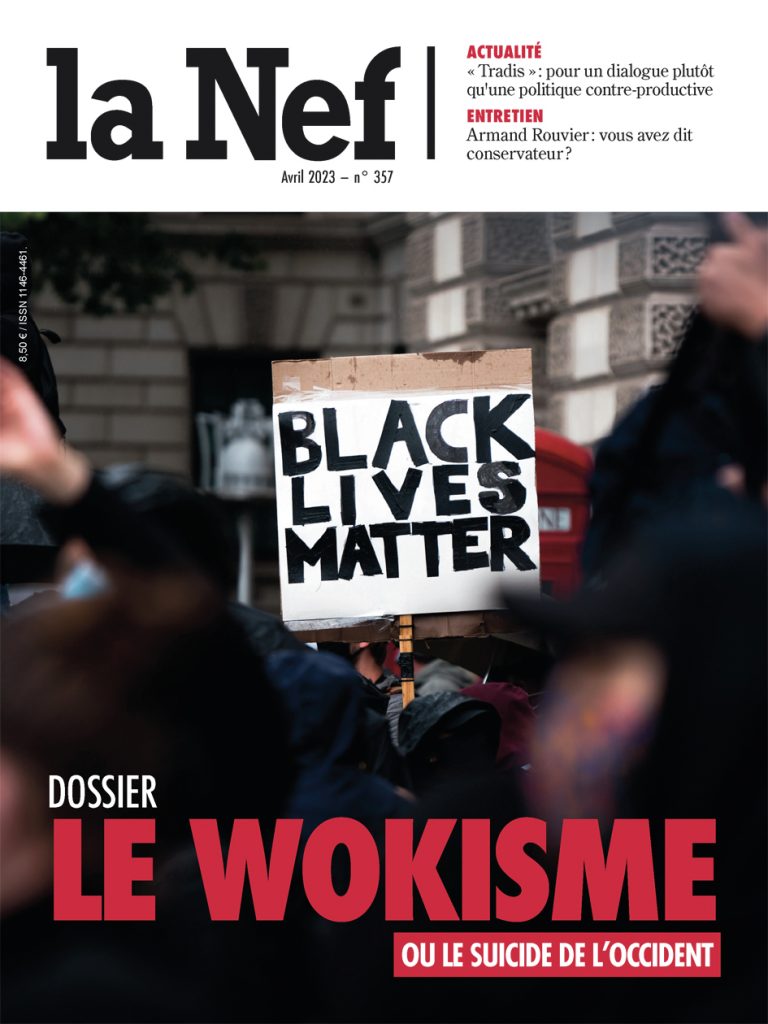Du site du Figaro via Il Sismografo :
L’étrange récupération de Blaise Pascal par le pape François
(Le Figaro) TRIBUNE - Trois universitaires spécialistes de l’œuvre de Blaise Pascal ont lu la lettre apostolique qu’a consacrée le pape François à l’auteur des Pensées. S’ils saluent la reconnaissance du souverain pontife pour un immense génie, ils critiquent une lecture orientée selon les options théologiques et la sensibilité d’un pape jésuite. Ils restituent avec brio son œuvre dans le contexte de la querelle entre augustinisme et jésuitisme.
Le pape François est malicieux. Il aime étonner, et même prendre à contre-pied les opinions les mieux admises. Ainsi a-t-il jeté un franc embarras parmi les lecteurs de Blaise Pascal le jour de son quatrième centenaire, le 19 juin 2023, en décidant de lui consacrer une lettre apostolique. L’honneur est immense: le Clermontois rejoint ainsi au panthéon personnel du souverain pontife Dante et saint François de Sales, précédents bénéficiaires de semblables missives. Mais cette nouvelle publication a plongé de nombreux catholiques français dans une stupéfaction gênée. Pascal n’était-il pas connu pour ses positions «jansénistes», à la limite de l’orthodoxie?
L’un de ses ouvrages majeurs, Les Provinciales, n’est-il pas constitué d’une série de lettres brillantes, ironiques, cruelles, qui discréditèrent le laxisme qu’elles dénonçaient chez les Jésuites, ordre dont le Saint-Père est précisément issu? Ces sulfureuses «petites lettres», prisées par Voltaire, n’ont-elles pas longtemps figuré à l’index des livres interdits? Malaise de l’Église. Embarras parmi ceux qui veulent voir en Pascal un «philosophe» seulement équipé d’une foi surnuméraire - ce débat autorise peu à ignorer Pascal, croyant «de feu» (le terme qui irradie l’éblouissant Mémorial).
Les spécialistes sont, depuis le XVIIe siècle, partagés sur la catholicité de Pascal. Aujourd’hui, tandis que certains militent au sein d’associations spécialement créées pour favoriser la canonisation de l’auteur (par exemple, la récente Société des amis de Blaise Pascal qui reprend de la sorte la suggestion de La Vie de M. Pascal écrite par sa sœur aînée, Gilberte Périer), d’autres, comme Simon Icard, chercheur au CNRS, voient dans l’intention présumée sanctificatrice du pape une simple «blague jésuite» qu’on ne saurait prendre vraiment au sérieux, tant elle contredit les positions traditionnelles de l’Église sur l’œuvre de Blaise Pascal.
Alors, saint Pascal hérétique? Pascal simplement catholique? Pourquoi François a-t-il cru bon de rouvrir ce vieux dossier recouvert par trois siècles de poussière vaticane? Au-delà des questions techniques de conformité à l’orthodoxie théologique, en quoi Pascal représente-t-il un enjeu politique aujourd’hui pour l’Église romaine - voire une figure majeure à ne pas laisser échapper?
La nouvelle éthique du XVIe siècle
Si Pascal a jadis pu être considéré comme dangereux par l’Église, c’est pour avoir continué à professer une foi héritée de la pensée de saint Augustin, qui avait dominé la chrétienté pendant un millénaire. Ce christianisme né en Afrique au Ve siècle, consolidé à l’époque médiévale, est celui que Jean Delumeau a si bien décrit dans La Peur en Occident: une vision fulgurante de l’homme déchu, misérable créature dépouillée de toute force et de toute bonté, torturé par la toute-puissance du péché, rongé par le désir d’une pureté interdite, abandonné à un sentiment de déréliction dont seul peut le libérer ce don gratuit et immérité d’un Dieu omnipotent: la grâce.