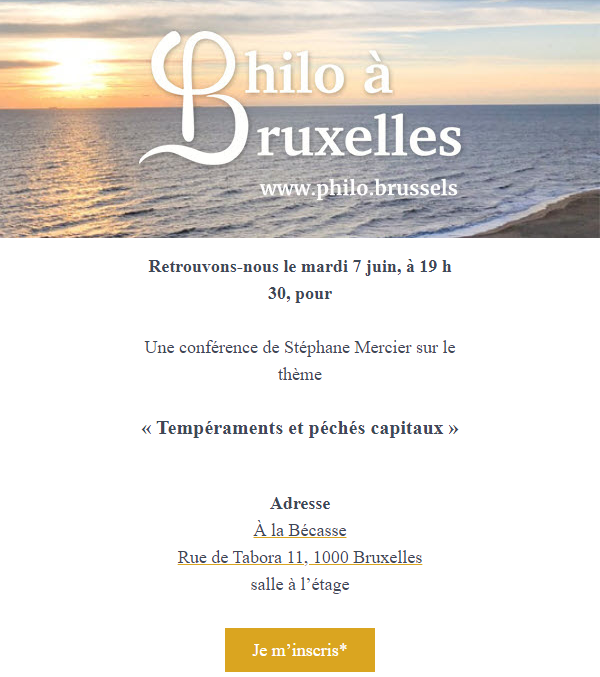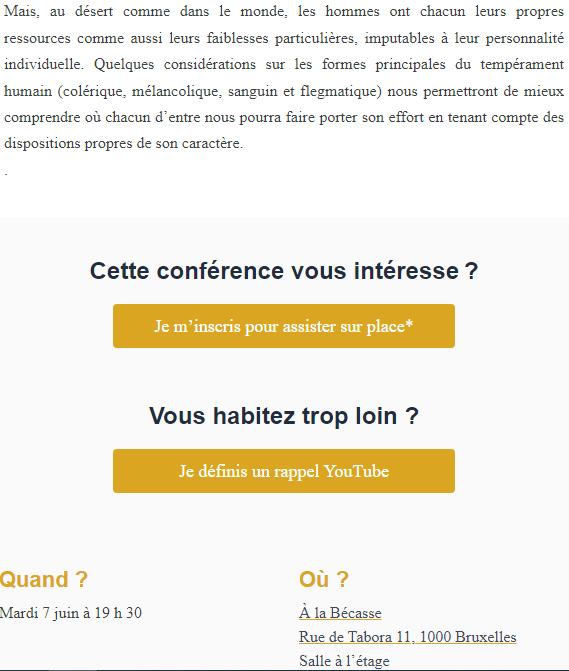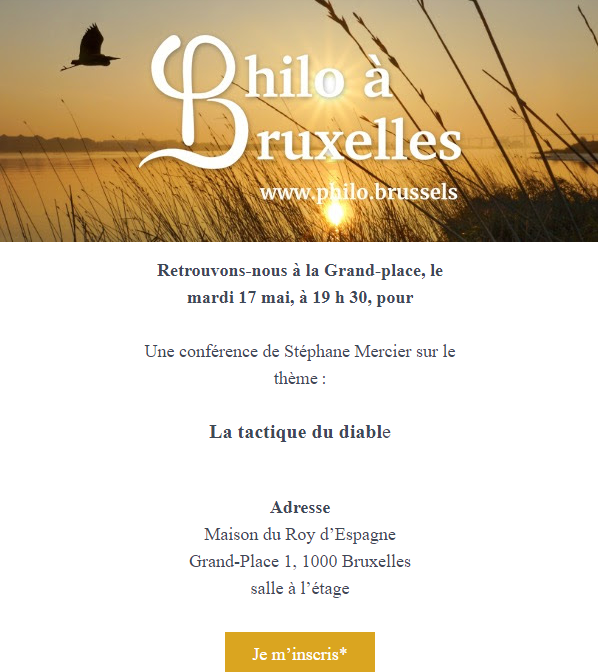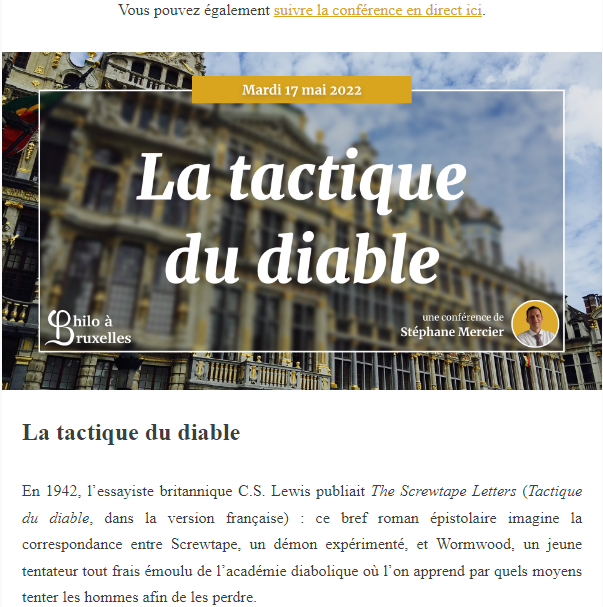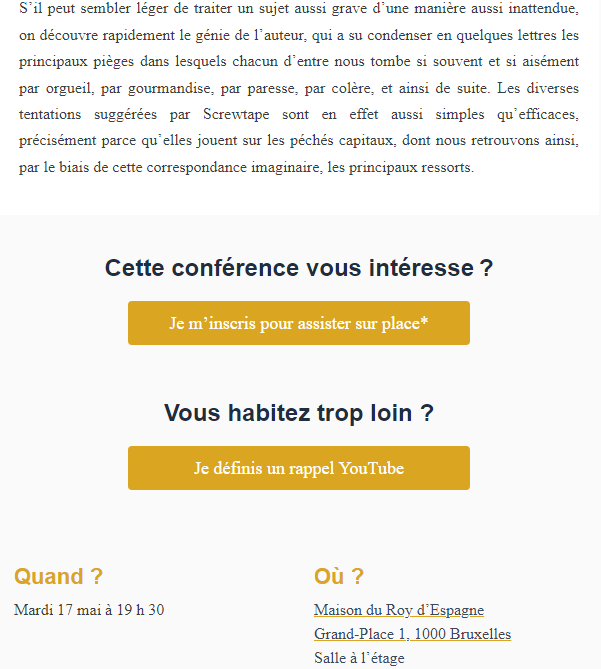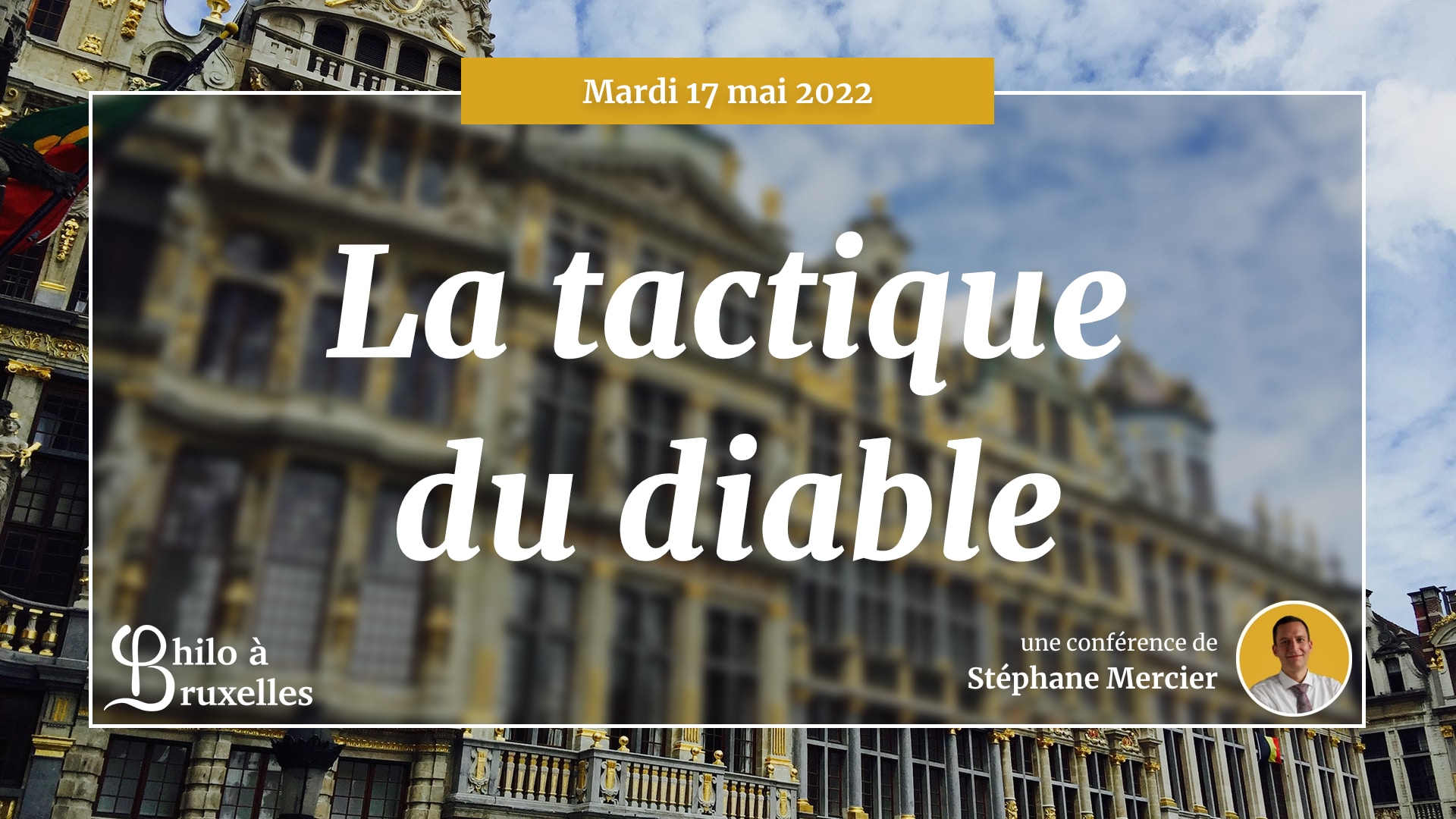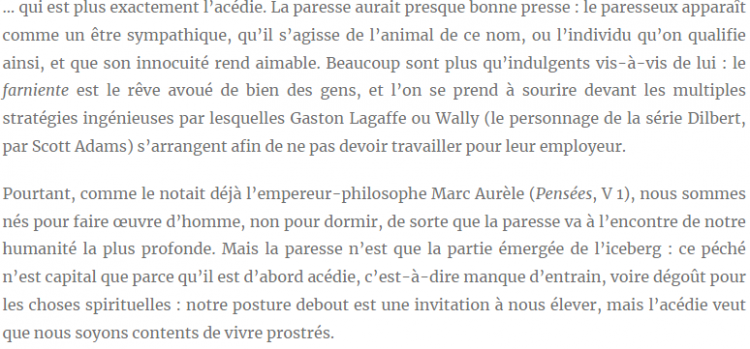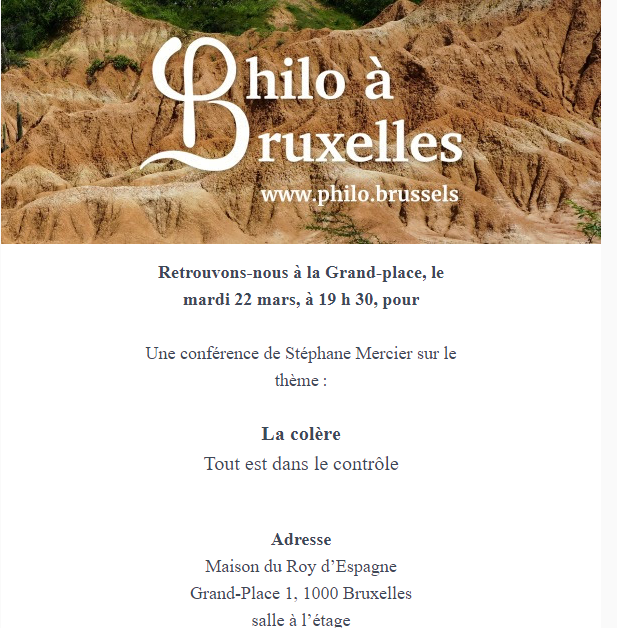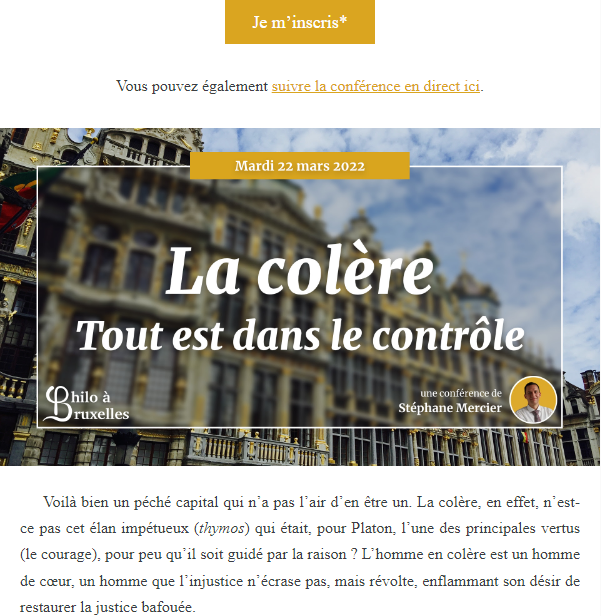Philosophie - Page 11
-
François-Xavier Bellamy soumis à la question
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Ethique, Idées, Médias, Philosophie, Politique, Témoignages 0 commentaire -
Prouver Dieu, la différence homme-femme, le sacerdoce : une émission (Esprit des Lettres) à ne pas manquer sur KTO
De KTO Télévision, une émission à ne pas manquer :
L’Esprit des Lettres de juin 2022 : P. François Euvé, René Écochard, P. François Potez
01/07/2022
Jean-Marie Guénois a choisi pour vous des lectures de vacances plus exigeantes que beaucoup de ses confrères. Mais l’été n’est-il pas l’occasion de méditer sur l’essentiel ? Le père François Euvé, aiguillonné par des publications récentes proposant des preuves de l’existence de Dieu, enrichit le débat, de sa plume alerte (La science, l’épreuve de Dieu? chez Salvator). René Écochard fait un remarquable travail de compilation des découvertes et savoirs sur la différence homme-femme, aujourd’hui souvent relativisée. Il nous offre Homme, femme... ce que nous disent les neurosciences chez Artège. Enfin, le père François Potez, dans « La grave allégresse » - être prêtre aujourd’hui, chez Mame, délivre une réflexion sur le sacerdoce fondée sur des années de ministère et d’accompagnement. UNE COPRODUCTION KTO-JDS-LA PROC.
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Foi, Idées, Livres - Publications, Médias, Philosophie, Sciences, Spiritualité 0 commentaire -
« Tempéraments et péchés capitaux » : une conférence en replay de Stéphane Mercier offerte par 'Philo à Bruxelles'
VIVENT LES VACANCES !
Pour les fêter dignement, ainsi que le 5ᵉ anniversaire* de Philo à Bruxelles, nous avons décidé de vous faire bénéficier gratuitement du replay de la dernière conférence de Stéphane Mercier sur le thème
« Tempéraments et péchés capitaux »
Retrouvez-la dès maintenant en ligne sur la page d’accueil du site internet Philo à Bruxelles :
Retour au désert :
Tempéraments et péchés capitaux
Notre « exploration » des péchés capitaux et de leur histoire commence dans le désert, là où s’est élaborée notre septénaire des vices. Nous pouvons ainsi prendre la mesure de la pertinence à la fois psychologique, philosophique et théologique de l’analyse proposée par les reclus à l’intention de ceux qui, comme nous, sont dans le monde (bien qu’essayant, autant que possible, de ne pas en être…).Cependant, dans le désert comme dans le monde, chaque homme jouit de ses propres ressources et souffre de ses faiblesses particulières, liées à l'essence de sa personnalité.
Quelques considérations sur les formes principales du tempérament humain : colérique, mélancolique, sanguin et flegmatique, nous permettront de peut-être mieux nous connaître et comprendre où faire porter nos efforts en tenant compte des dispositions propres de notre caractère.
Quand ?
Vous pouvez écouter gratuitement cette conférence pendant toutes les vacances.
Et même dès maintenant grâce à un simple clic !
Où ?
Chez vous, sur votre lieu de villégiature, en route, derrière le volant, dans le train ou pourquoi pas sur la plage ou dans un verger…
La dernière conférence n’ayant pas pu être diffusée en direct et parce que nous savons combien vous apprécierez cette conférence sur le thème « Tempéraments et péchés capitaux », nous avons décidé de vous offrir un accès à cette dernière vidéo de Stéphane Mercier, pendant toutes les vacances de cet été 2022.
Toutes les autres vidéos – déjà plus de 40 ! – sont également accessibles sur cette page. Il vous suffit de souscrire un abonnement grâce à des tarifs à la portée de toutes les bourses.
Toute l’équipe de Philo à Bruxelles vous dit MERCI pour votre soutien et vous souhaite une bonne écoute !
Plus d’informations
* 5 ans… Oui, il y a cinq ans déjà que nous nous sommes lancés dans l’aventure de Philo à Bruxelles.
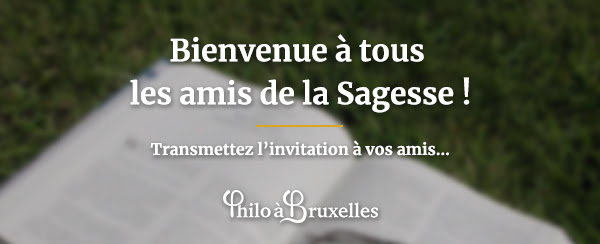
-
Belgique : TV-Il était une foi… Georges-Louis Bouchez
Dans une interview récente le président du MR déclarait: « Je crois en moi. Et je crois en Dieu ». Qui est Dieu pour Georges-Louis Bouchez ? La quête de sens peut-elle inspirer la politique ? Les religions peuvent-elles contribuer aux débats de société ? Découvrez les réponses de l’homme politique.
Explicitation dans un entretien réalisé par le site web des diocèses francophones de Belgique : propos recueillis par Christophe HERINCKX
Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Foi, Idées, Philosophie, Religions, Société, Spiritualité, Témoignages 1 commentaire -
Philo à Bruxelles, 7 juin : "Tempéraments et péchés capitaux" avec Stéphane Mercier
-
Philo à Bruxelles, 17 mai : "La tactique du diable" avec Stéphane Mercier
-
"Philo à Bruxelles", 17 mai : "La tactique du diable" avec Stéphane Mercier
17 mai à 19h30, sur la Grand-Place de Bruxelles (Maison du Roy d’Espagne) :La tactique du diable
-
Philo à Bruxelles : 26 avril; "La paresse, le vide de l'âme" avec Stéphane Mercier
Retrouvons-nous à la prochaine conférence de Stéphane Mercier : 26 avril à 19h30, sur la Grand-Place de Bruxelles.
-
Après l’humanisme
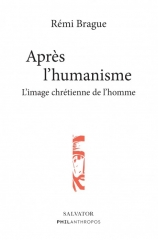 Rémi Brague est professeur émérite de philosophie médiévale, arabe et juive. Membre de l’Institut de France et auteur d’une œuvre importante. Voici, le texte de interview qu’il a accordée à Christophe Geffroy, fondateur et directeur du mensuel La Nef à propos de son dernier livre : « Après l’humanisme. L’image chrétienne de l’homme » Salvator, 2022, 210 pages, 20 € :
Rémi Brague est professeur émérite de philosophie médiévale, arabe et juive. Membre de l’Institut de France et auteur d’une œuvre importante. Voici, le texte de interview qu’il a accordée à Christophe Geffroy, fondateur et directeur du mensuel La Nef à propos de son dernier livre : « Après l’humanisme. L’image chrétienne de l’homme » Salvator, 2022, 210 pages, 20 € :« La Nef – Pourquoi s’intéresser à une définition de l’homme, en quoi est-elle nécessaire ? Et est-il seulement possible de « définir » l’homme dont vous dites bien qu’il est « mystère » comme le Dieu dont il est l’image ?
Rémi Brague – Ce que je défends est qu’il faut se méfier de toute définition de l’homme qui serait, selon l’étymologie, une façon de fixer des limites (latin : finis) à l’humain. Ce qui mène à exclure tout ce qui ne satisfait pas aux critères. D’abord les fœtus ou les nourrissons encore incapables de poser les actes par lesquels on peut identifier l’humain comme la parole. Puis les comateux aux encéphalogrammes plats. On en vient aisément, et l’histoire récente nous en fournit des exemples concrets, à décider qu’il y a des « sous-hommes » qui mènent une « vie qui ne vaut pas d’être vécue » (lebensunwertes Leben), etc.
C’est d’avoir voulu être trop humain, en centrant trop le regard sur l’homme, que l’humanisme s’est épuisé : comment en est-il arrivé là, était-ce inscrit dans l’humanisme originel ?
Que l’homme soit au centre, admettons, mais sans oublier qu’au centre du village, il n’y a pas que le trône, mais aussi le pilori… Mais au centre de quoi au juste ? Je dirais donc plutôt que l’humanisme s’est rabougri en perdant de vue le contexte à l’intérieur duquel l’humain prend son sens. On peut le penser ce contexte en différents styles. Pour les Anciens, c’était le monde physique en son bel ordre – en grec : kosmos. L’homme en était le sommet, non le tyran, mais plutôt le chef-d’œuvre, le vivant qui réalise le mieux les intentions de la Nature. Il le faisait par la pratique des vertus. Pour la Bible, ce contexte est Dieu. L’homme en est l’image. Pour se montrer à la hauteur de cette vocation, il se guide sur les commandements donnés par le Dieu créateur et libérateur.
Le fait de définir l’homme par lui-même comme le fait un certain humanisme conduit non pas à l’échec, écrivez-vous, « mais à une réussite telle qu’elle aboutit à l’opposé de ce qui était recherché » : pourriez-vous nous l’expliquer ?
La définition de soi par soi est l’aspect théorique d’une attitude pratique, la recherche de l’autonomie. Or, la détermination de soi par soi est neutre : elle peut être positive, mais aussi négative. Dans mes Ancres dans le ciel (2009), j’ai fait un peu d’humour noir en rappelant que le suicide était aussi une façon de se déterminer soi-même. Voire, plus efficacement que tout essai pour s’améliorer physiquement ou moralement.
Pourquoi la tentation de créer un « homme nouveau » conduit-elle au désastre ?
Je laisse de côté le problème du prétendu « transhumanisme » : techniquement faisable ? moralement justifiable ? etc. Mais le projet de créer un « homme nouveau » est ancien. Voyez le livre de Dalmacio Negro, El mito del hombre nuevo (2009), qu’il faudrait traduire. L’ennui c’est que le créateur d’un éventuel « homme nouveau » resterait un « homme ancien », gouverné non par la recherche de la sainteté, mais plutôt par celle du pouvoir. On n’obtiendra qu’une version augmentée de cet « homme ancien ». Celui que saint Paul appelle le « vieil homme » aura reçu son masque au concombre, voilà tout. L’élévation se réduira à un lifting…
Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Ethique, Foi, Idées, Philosophie, Société, Spiritualité 0 commentaire -
RDC : Interview de Mgr Donatien Nshole, secrétaire général de l’influente Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO)
Une mentalité et un franc parler qui détonnent avec ceux des milieux cléricaux usuels en Europe et ailleurs:
Lien permanent Catégories : Actualité, Doctrine, Doctrine Sociale, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, Idées, Justice, Philosophie, Politique, Société, Spiritualité, Témoignages 1 commentaire -
"Philo à Bruxelles", 22 mars : "La colère, tout est dans le contrôle"
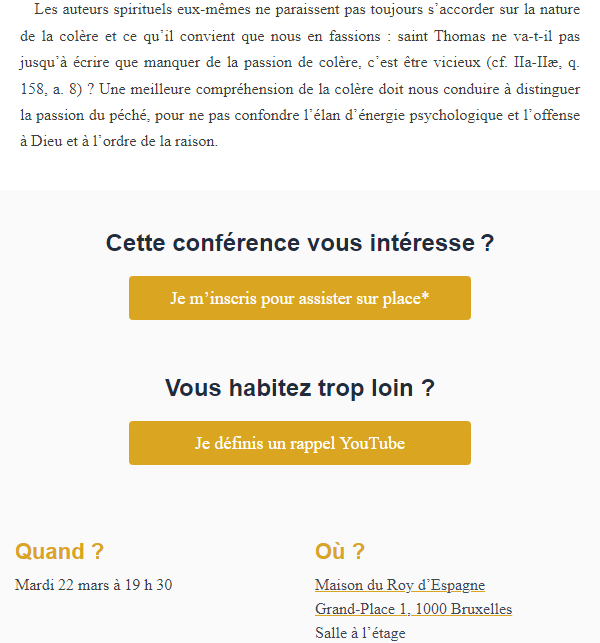
Infos supplémentaires
Séance de questions & réponses à la fin de la conférence, sur place. Pour les téléspectateurs, envoyez vos questions par chat, en direct sur YouTube ou par SMS, Telegram, Signal, email, formulaire de contact etc.)
Stéphane Mercier est heureux de vous retrouver aux prochaines conférences :
22 mars : La colère
Tout est dans le contrôle.19 avril : La paresse
Le vide de l’âme. -
"Dieu, la science, les preuves" : l'éclairage de Mgr Léonard
L'éclairage de Mgr Léonard sur le livre de Bolloré et Bonassies (Dieu, la science, les preuves) a été publié dans la revue La Nef du mois de février 2022 et reproduit (mais pas in extenso) sur didoc.be :
L'aube d'une révolution?
.
Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies ont publié à l’automne dernier Dieu, la science, les preuves qui est un véritable best-seller avec déjà plus de 100.000 exemplaires vendus. Nous reproduisons ici une bonne partie de la recension que Mgr Léonard en a faite.
L’ouvrage de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies, Dieu, la science, les preuves, préfacé par le prix Nobel de physique, Robert W. Wilson, est, en tous points, remarquable.
Après une introduction consacrée à la notion même de preuve scientifique, il établit que la certitude de la mort thermique de l’Univers, liée à son entropie croissante, à son inéluctable désorganisation, implique nécessairement aussi qu’il a eu un commencement, ce que confirme la théorie du Big Bang, universellement acceptée aujourd’hui. Celle-ci consiste à affirmer que l’Univers physique que nous connaissons s’est développé à partir de ce que l’abbé Georges Lemaître, un des auteurs de cette théorie (qui n’était pas jésuite mais un simple prêtre diocésain), appelait familièrement un « atome primitif » contenant toute l’énergie, la matière et l’information qui se déploieraient progressivement, dans l’espace-temps, engendré lui-même avec l’explosion de cet atome, et ce à la faveur de l’expansion de l’Univers, autre élément essentiel de cette théorie, confirmé ensuite expérimentalement.
Cette extraordinaire découverte scientifique pose une question essentielle, qui n’est plus, elle-même, du ressort de la science : d’où proviennent l’existence et le contenu de cet atome primitif ? Il est impossible de répondre scientifiquement à cette question de l’origine, dès lors que l’atome primitif ne comporte pas d’« avant », puisque le temps lui-même, tout comme l’espace, est né avec le Big Bang. Vous pouvez légitimement tenir que le Big Bang était « précédé » par les mathématiques et par une « intelligence » portant les vérités mathématiques. Vous pouvez même émettre l’hypothèse qu’une volonté créatrice est responsable de l’existence même de cet atome primitif. Mais, ce faisant, vous sortez du raisonnement purement scientifique et entrez dans le domaine plus large des vérités philosophiques ou, plus précisément, « métaphysiques ». Beaucoup de scientifiques, sortant du registre purement scientifique, s’engagent dans un questionnement métaphysique. L’ouvrage en donne de nombreux exemples. Ils ne trahissent nullement la rigueur qu’impliquent les sciences. Ils manifestent simplement que la raison philosophique est plus large que la raison scientifique et formulent les implications exigées rationnellement par les données de la science.
Une démarche analogue s’impose en vertu du « principe anthropique » tenu par nombre de scientifiques, selon lequel l’apparition de la vie et, singulièrement, de la vie humaine n’a été possible, au cours d’une longue évolution, qu’à la faveur de réglages extrêmement précis, tels que la moindre différence de ces paramètres, fût-elle infinitésimale, eût rendu impossible la texture actuelle de l’Univers et, spécialement, la naissance de la Terre et, en son sein, de la vie et de l’homme (anthropos, en grec). Attribuer au hasard cette formidable évolution du Cosmos et ce surgissement de la vie et de l’homme ne tient plus la route aujourd’hui. Beaucoup de scientifiques, ici aussi, reconnaissent la réalité d’un « principe anthropique », en ce sens que les paramètres fondamentaux de l’Univers semblent avoir été calculés de manière très fine de telle sorte que l’éclosion de la vie et de l’homme sur la Terre y fut possible. Affirmer que cela a été réglé par une Intelligence créatrice n’est pas du ressort de la science elle-même, mais d’une raison philosophique plus large. C’est ainsi, par exemple, que l’Evangile de Jean (cf. Jn 1, 1-3), en tenant que tout a été créé par Dieu dans son Verbe, par son « Logos », invite à penser que si la Création est si prodigieusement organisée et intelligible, c’est parce qu’elle provient d’une Pensée intelligente. Au point qu’en produisant finalement un « animal logique », un « zôon logikon », comme disait Aristote, l’Univers restitue, en quelque sorte, son origine : créé par une Pensée, il finit par faire surgir en son sein un être « pensant » qui transcende, par sa pensée, l’Univers entier.
Lien permanent Catégories : Culture, Débats, Idées, Livres - Publications, Philosophie, Sciences 1 commentaire