Alors que les fidèles s’apprêtent à entrer dans la Semaine sainte après le Dimanche des rameaux ce 28 mars, tour d’horizon des mesures sanitaires en place chez nos voisins européens. Un commentaire d’Agnès Pinard Legry sur le site web « Aleteia » :
 À l’approche de la Semaine sainte et de Pâques et alors que le contexte sanitaire se tend, les catholiques français ont appris avec soulagement qu’ils pourront assister, sauf nouvelles mesures, aux différents offices de la Semaine sainte et de Pâques. Seules contraintes outre le protocole sanitaire : respecter le couvre-feu (de 19h à 6h) et, pour les zones concernées, choisir une messe à moins de 10 kilomètres de chez soi. « Les règles s’appliquant aux lieux de culte resteront inchangées », a ainsi assuré le Premier ministre Jean Castex il y a quelques jours. Face à l’épidémie, nos voisins européens ont pris des dispositions plus ou moins drastiques concernant les offices de la Semaine sainte. Comment vont-ils vivre ce temps fort de la liturgie ?
À l’approche de la Semaine sainte et de Pâques et alors que le contexte sanitaire se tend, les catholiques français ont appris avec soulagement qu’ils pourront assister, sauf nouvelles mesures, aux différents offices de la Semaine sainte et de Pâques. Seules contraintes outre le protocole sanitaire : respecter le couvre-feu (de 19h à 6h) et, pour les zones concernées, choisir une messe à moins de 10 kilomètres de chez soi. « Les règles s’appliquant aux lieux de culte resteront inchangées », a ainsi assuré le Premier ministre Jean Castex il y a quelques jours. Face à l’épidémie, nos voisins européens ont pris des dispositions plus ou moins drastiques concernant les offices de la Semaine sainte. Comment vont-ils vivre ce temps fort de la liturgie ?
1ALLEMAGNE : DES OFFICES FINALEMENT AUTORISÉS
Pendant cinq jours, du 1er au 5 avril, l’Allemagne devait se mettre « en pause », avait indiqué ce mardi 23 mars la chancelière Angela Merkel lors d’une conférence de presse. Les offices religieux sur cette période, c’est-à-dire pendant la Semaine sainte et Pâques, devaient être annulés, les messes se tenir à huis clos et les fidèles contraints de vivre ces temps liturgiques forts depuis chez eux. Mais au lendemain des annonces, ce mercredi, Angela Merkel a reconnu avoir fait « une erreur » en voulant durcir pour le long week-end de Pâques les règles sanitaires anti-Covid en Allemagne. À l’issue d’une réunion d’urgence avec les Länder, les États-régions, la chancelière allemande confirmé l’abandon du projet.
2ESPAGNE : DES OFFICES MAIS PAS DE PROCESSION
Les offices de la Semaine sainte et de Pâques sont maintenus mais les processions, si importantes en Espagne, sont suspendues. Un protocole sanitaire (masque obligatoire, désinfection des mains, distance de sécurité…) est appliqué dans les églises lors des messes.
Lire aussi :Les leçons d’humanité des jours de la Semaine sainte
3ÉCOSSE : REPRISE DES OFFICES
Si aucune détérioration de la situation sanitaire n’est observée d’ici là, le gouvernement a annoncé la reprise des messes publiques en Écosse à partir du vendredi 26 mars afin de permettre aux fidèles de vivre pleinement le Dimanche des rameaux, la Semaine sainte et Pâques. Le protocole sanitaire y sera néanmoins strict avec un plafond fixé à 50 personnes quelle que soit la taille de l’édifice religieux et deux mètres de distance entre les fidèles.
4ROYAUME-UNI : LES OFFICES MAINTENUS
Comme en France, le Royaume-Uni autorise les messes publiques à condition de respecter un protocole sanitaire (distance de sécurité, port du masque…).
5BELGIQUE : DE FORTES CONTRAINTES
En Belgique, les messes publiques sont limitées à 15 personnes depuis le mois de décembre 2020 et cela quelle que soit la taille de l’édifice. Une situation jugée injustifiable et discriminatoire pour de nombreux fidèles qui ne devrait pas évoluer pour la Semaine sainte et Pâques.
Lire aussi :En Belgique, « le mépris total des cultes »
6ITALIE : LES OFFICES MAINTENUS
En raison de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, les autorités italiennes ont adopté de nouvelles restrictions liées au contexte sanitaire jusqu’au 6 avril. Malgré un couvre-feu de 22h à 6h du matin, l’interdiction de se déplacer entre les régions et la fermeture de commerces non-essentiels, les festivités « liées à des cérémonies civiles ou religieuses » restent autorisées. Les messes publiques sont donc autorisées à condition de respecter un protocole sanitaire prenant en compte les différents gestes barrières.
7PORTUGAL : DES OFFICES MAIS PAS DE PROCESSION
Après près de trois mois de confinement, les messes publiques ont repris mi-mars au Portugal. Contrairement à ce qui s’est passé en 2020 en raison de la pandémie, les célébrations de cette année se feront donc bien avec la participation de l’assemblée. La Conférence épiscopale du Portugal a néanmoins demandé à ce que les processions et autres expressions de piété populaire soient suspendues afin d’éviter des « risques pour la santé publique ».
Ref. Semaine sainte : les Français plus « chanceux » que leurs voisins européens ?
Comme on l’aura lu par ailleurs, les préoccupations actuelles de l’épiscopat belge sont d’un autre ordre que celui de la liberté des cultes. A chacun ses priorités, mais un choix étrange -ou un aveu d'impuissance- qui laissera des traces parmi les chrétiens de tous âges et opinions.
JPSC

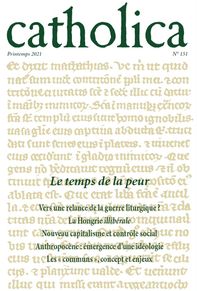

 À l’approche de la
À l’approche de la 