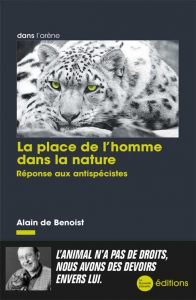De Monika Jablonska sur le National Catholic Register :
Jean Paul II avait raison : Il n'y a pas de liberté sans vérité
"Il ne peut y avoir d'État de droit (...) que si les citoyens et surtout les dirigeants sont convaincus qu'il n'y a pas de liberté sans vérité." Le pape Jean-Paul II
4 juillet 2021
L'homme est appelé à la liberté et à la vérité. La vérité est donnée à l'homme comme un fondement inébranlable. "Alors seulement, il pourra se réaliser pleinement et même se dépasser." Il n'y a pas de liberté sans vérité. Les deux sont des phénomènes intégrés, fondus en un seul.
La splendeur de la vérité resplendit dans toutes les œuvres du Créateur et, de façon particulière, dans l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu (Genèse 1, 26). Selon Karol Wojtyła, "la vérité éclaire l'intelligence de l'homme et façonne sa liberté, en le conduisant à connaître et à aimer le Seigneur."
Seule la liberté issue de la vérité engendre le bien. Sinon, la liberté peut être une force du mal car elle dégénère en licence. Telles sont mes réponses à deux questions fondamentales : Qu'est-ce que la liberté ? La liberté peut-elle exister sans la vérité ?
Selon Aristote, "la liberté est une propriété de la volonté qui se réalise par la vérité. La liberté est donnée à l'homme comme une tâche à accomplir". L'auto-réalisation de la liberté humaine dans la vérité commence dans "l'expérience du sujet moral." Saint Thomas d'Aquin fait sien le système aristotélicien des vertus : prudence, justice, force d'âme et tempérance. "Le bien qui doit être accompli par la liberté humaine est précisément le bien des vertus". Mais saint Thomas fait un pas de plus et ajoute à la morale d'Aristote " la lumière qu'offre l'Écriture Sainte ". La plus grande lumière vient du commandement d'aimer Dieu et le prochain. Dans ce commandement, la liberté humaine trouve sa pleine réalisation."
L'enracinement de la liberté dans la vérité a également été un thème central dans les écrits du pape saint Jean-Paul II. Le thème de la liberté humaine est au cœur de ses documents magistériels. Le pape l'a défini ainsi :
"La liberté ne consiste pas à faire ce qui nous plaît, mais à avoir le droit de faire ce que nous devons".
" L'homme est appelé à la liberté ", a-t-il dit. Il entendait par là une liberté fondée sur des valeurs et des attitudes éthiques. La liberté repose également sur quatre fondements principaux : la vérité, la solidarité, le sacrifice et l'amour.
La vérité : "Les libres forces créatrices de l'homme ne pourront se développer pleinement que si elles se fondent sur la vérité, qui est donnée à tout homme comme un fondement inébranlable. Ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra se réaliser pleinement et même se dépasser. Il n'y a pas de liberté sans vérité."
Solidaire : "La liberté vécue dans la solidarité s'exprime dans l'action pour la justice dans les domaines politique et social, et oriente le regard vers la liberté des autres. Il n'y a pas de liberté sans solidarité."
Sacrifice : "La liberté est une valeur extrêmement précieuse, pour laquelle il faut payer un prix élevé. Elle exige de la générosité et une disposition au sacrifice ; elle exige de la vigilance et du courage face aux forces internes et externes qui la menacent. ... Il n'y a pas de liberté sans sacrifice."
L'amour. "Laissez la porte ouverte en ouvrant vos cœurs ! Il n'y a pas de liberté sans amour".
Karol Wojtyla connaissait le véritable prix de la liberté. Il a vécu sous la menace de mort des nazis, et a vu sa chère Pologne lutter sous les communistes. Il était donc l'un des plus puissants ambassadeurs de la liberté et de la vérité dans son propre pays et dans le monde entier. En 1996, le pape polonais a lancé un appel aux "nations qui se voient encore refuser le droit à l'autodétermination, ces nombreuses nations, et elles sont effectivement nombreuses, dans lesquelles les libertés fondamentales de l'individu, de la foi et de la conscience ainsi que la liberté politique ne sont pas garanties". Ainsi, le manque de vérité se traduit par un manque de liberté.
Dans sa première encyclique Redemptor Hominis, Jean-Paul II a cité les paroles du Christ sur la force libératrice de la vérité. Puis il a ajouté :
"Ces paroles contiennent à la fois une exigence fondamentale et un avertissement : l'exigence d'un rapport honnête à la vérité comme condition d'une liberté authentique, et l'avertissement d'éviter toute liberté illusoire, toute liberté unilatérale superficielle, toute liberté qui n'entre pas dans la vérité entière sur l'homme et sur le monde."
En effet, étant donné le pluralisme, l'agnosticisme et le relativisme sceptique contemporains, l'avertissement de Jean-Paul II concernant la "crise de la liberté et de la vérité" sonne comme une prophétie. Il nous a mis en garde contre le fait que tout écart par rapport à la vérité entraîne une perte d'ancrage de la liberté et expose l'homme à la violence des passions et à la manipulation.
La crise contemporaine de la liberté est à la base une crise de la vérité. Dans Veritatis Splendor, Evangelium Vitae et ailleurs dans ses enseignements officiels, Jean-Paul II a affirmé que nier le lien entre liberté et vérité pouvait conduire au totalitarisme. Et dans Mémoire et identité, il a expliqué :
"L'abus de la liberté provoque une réaction qui prend la forme d'un système totalitaire ou d'un autre. C'est la corruption de la liberté que nous avons connue au 20e siècle et dont nous connaissons un peu la forme aujourd'hui."
À la suite d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin et de Jean-Paul II, nous répétons qu'"il n'y a pas de liberté sans vérité". Il est clair que le lien entre la liberté humaine et la vérité est d'une importance capitale. Par conséquent, la compréhension de la pensée de nos philosophes et de la théologie de la vérité et de la liberté de Jean-Paul II dans le contexte individuel, social et politique nous aide à répondre correctement aux défis de l'époque actuelle.
C'est l'occasion de vous rappeler la parution de l'incontournable "Plaidoyer pour le Vrai" de Paul Vaute : voir Paul Vaute présente son livre "Plaidoyer pour le Vrai"

 "La polémique en Belgique au sujet du “décolonialisme” – mouvement d’effacement des œuvres coloniales porté par des organisations antiracistes à la suite des protestations, aux États-Unis, contre l’assassinat du noir Georges Floyd par un policier blanc – se nourrit d’une participation inattendue. L’Université de Kisangani – ex-Stanleyville – s’inquiète, en effet, de la stigmatisation des para-commandos belges qui, le 24 novembre 1964, mirent fin aux exactions des rebelles Simbas dans cette ville.
"La polémique en Belgique au sujet du “décolonialisme” – mouvement d’effacement des œuvres coloniales porté par des organisations antiracistes à la suite des protestations, aux États-Unis, contre l’assassinat du noir Georges Floyd par un policier blanc – se nourrit d’une participation inattendue. L’Université de Kisangani – ex-Stanleyville – s’inquiète, en effet, de la stigmatisation des para-commandos belges qui, le 24 novembre 1964, mirent fin aux exactions des rebelles Simbas dans cette ville.