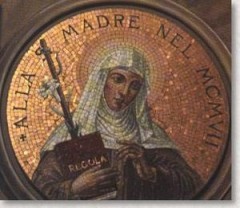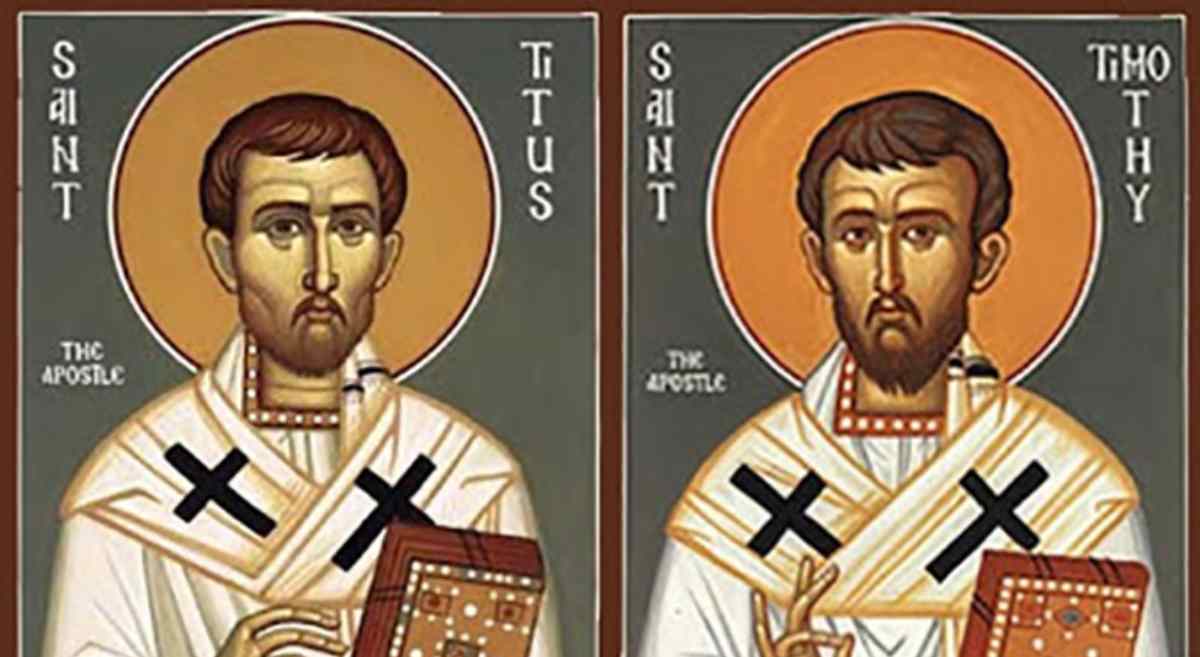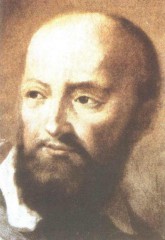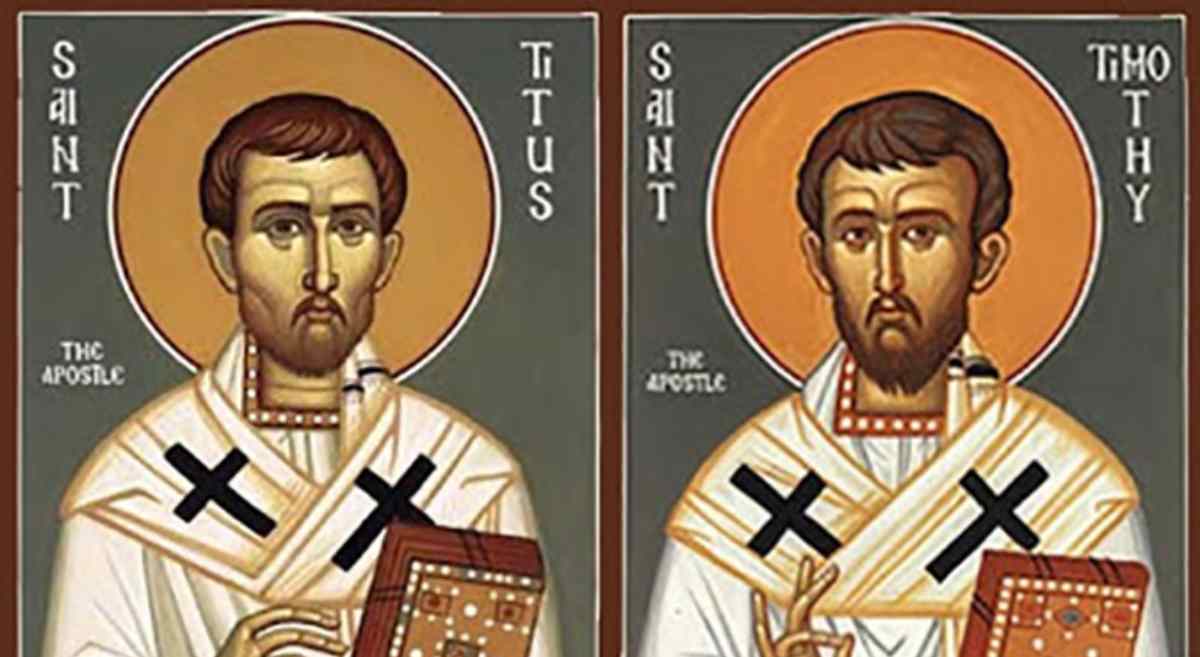
Catéchèse de Benoît XVI (13 décembre 2006)
Chers frères et soeurs,
Après avoir longuement parlé du grand Apôtre Paul, nous prenons aujourd'hui en considération ses deux collaborateurs les plus proches: Timothée et Tite. C'est à eux que sont adressées trois Lettres traditionnellement attribuées à Paul, dont deux sont destinées à Timothée et une à Tite.
Timothée est un nom grec et signifie "qui honore Dieu". Alors que dans les Actes, Luc le mentionne six fois, dans ses Lettres, Paul fait référence à lui au moins à dix-sept reprises (on le trouve en plus une fois dans la Lettre aux Hébreux). On en déduit qu'il jouissait d'une grande considération aux yeux de Paul, même si Luc ne considère pas utile de nous raconter tout ce qui le concerne. En effet, l'Apôtre le chargea de missions importantes et vit en lui comme un alter ego, ainsi qu'il ressort du grand éloge qu'il en fait dans la Lettre aux Philippiens: "Je n'ai en effet personne d'autre (isópsychon) qui partage véritablement avec moi le souci de ce qui vous concerne" (2, 20).
Timothée était né à Lystres (environ 200 km au nord-ouest de Tarse) d'une mère juive et d'un père païen (cf. Ac 16, 1). Le fait que sa mère ait contracté un mariage mixte et n'ait pas fait circoncire son fils laisse penser que Timothée a grandi dans une famille qui n'était pas strictement observante, même s'il est dit qu'il connaissait l'Ecriture dès l'enfance (cf. 2 Tm 3, 15). Le nom de sa mère, Eunikè, est parvenu jusqu'à nous, ainsi que le nom de sa grand-mère, Loïs (cf. 2 Tm 1, 5). Lorsque Paul passa par Lystres au début du deuxième voyage missionnaire, il choisit Timothée comme compagnon, car "à Lystres et à Iconium, il était estimé des frères" (Ac 16, 2), mais il le fit circoncire "pour tenir compte des juifs de la région" (Ac 16, 3). Avec Paul et Silas, Timothée traverse l'Asie mineure jusqu'à Troas, d'où il passe en Macédoine. Nous sommes en outre informés qu'à Philippes, où Paul et Silas furent visés par l'accusation de troubler l'ordre public et furent emprisonnés pour s'être opposés à l'exploitation d'une jeune fille comme voyante de la part de plusieurs individus sans scrupules (cf. Ac 16, 16-40), Timothée fut épargné. Ensuite, lorsque Paul fut contraint de poursuivre jusqu'à Athènes, Timothée le rejoignit dans cette ville et, de là, il fut envoyé à la jeune Eglise de Thessalonique pour avoir de ses nouvelles et pour la confirmer dans la foi (cf. 1 Th 3, 1-2). Il retrouva ensuite l'Apôtre à Corinthe, lui apportant de bonnes nouvelles sur les Thessaloniciens et collaborant avec lui à l'évangélisation de cette ville (cf. 2 Co 1, 19).
Nous retrouvons Timothée à Ephèse au cours du troisième voyage missionnaire de Paul. C'est probablement de là que l'Apôtre écrivit à Philémon et aux Philippiens, et dans ces deux lettres, Timothée apparaît comme le co-expéditeur (cf. Phm 1; Ph 1, 1). D'Ephèse, Paul l'envoya en Macédoine avec un certain Eraste (cf. Ac 19, 22) et, ensuite, également à Corinthe, avec la tâche d'y apporter une lettre, dans laquelle il recommandait aux Corinthiens de lui faire bon accueil (cf. 1 Co 4, 17; 16, 10-11). Nous le retrouvons encore comme co-expéditeur de la deuxième Lettre aux Corinthiens, et quand, de Corinthe, Paul écrit la Lettre aux Romains, il y unit, avec ceux des autres, les saluts de Timothée (cf. Rm 16, 21). De Corinthe, le disciple repartit pour rejoindre Troas sur la rive asiatique de la Mer Egée et y attendre l'Apôtre qui se dirigeait vers Jérusalem, en conclusion de son troisième voyage missionnaire (cf. Ac 20, 4). A partir de ce moment, les sources antiques ne nous réservent plus qu'une brève référence à la biographie de Timothée, dans la Lettre aux Hébreux où on lit: "Sachez que notre frère Timothée est libéré. J'irai vous voir avec lui s'il vient assez vite" (13, 23). En conclusion, nous pouvons dire que la figure de Timothée est présentée comme celle d'un pasteur de grand relief. Selon l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe, écrite postérieurement, Timothée fut le premier Evêque d'Ephèse (cf. 3, 4). Plusieurs de ses reliques se trouvent depuis 1239 en Italie, dans la cathédrale de Termoli, dans le Molise, provenant de Constantinople.
Quant à la figure de Tite, dont le nom est d'origine latine, nous savons qu'il était grec de naissance, c'est-à-dire païen (cf. Gal 2, 3). Paul le conduisit avec lui à Jérusalem pour participer au Concile apostolique, dans lequel fut solennellement acceptée la prédication de l'Evangile aux païens, sans les contraintes de la loi mosaïque. Dans la Lettre qui lui est adressée, l'Apôtre fait son éloge, le définissant comme son "véritable enfant selon la foi qui nous est commune" (Tt 1, 4). Après le départ de Timothée de Corinthe, Paul y envoya Tite avec la tâche de reconduire cette communauté indocile à l'obéissance. Tite ramena la paix entre l'Eglise de Corinthe et l'Apôtre, qui écrivit à celle-ci en ces termes: "Pourtant, le Dieu qui réconforte les humbles nous a réconfortés par la venue de Tite, et non seulement par sa venue, mais par le réconfort qu'il avait trouvé chez vous: il nous a fait part de votre grand désir de nous revoir, de votre désolation, de votre amour ardent pour moi... En plus de ce réconfort, nous nous sommes réjouis encore bien davantage à voir la joie de Tite: son esprit a été pleinement tranquillisé par vous tous" (2 Co 7, 6-7.13). Tite fut ensuite envoyé encore une fois à Corinthe par Paul - qui le qualifie comme "mon compagnon et mon collaborateur" (2 Co 8, 23) - pour y organiser la conclusion des collectes en faveur des chrétiens de Jérusalem (cf. 2 Co 8, 6). Des nouvelles supplémentaires provenant des Lettres pastorales le qualifient d'Evêque de Crète (cf. Tt 1, 5), d'où sur l'invitation de Paul, il rejoint l'Apôtre à Nicopolis en Epire (cf. Tt 3, 12). Il se rendit ensuite également en Dalmatie (cf. 2 Tm 4, 10). Nous ne possédons pas d'autres informations sur les déplacements successifs de Tite et sur sa mort.
En conclusion, si nous considérons de manière unitaire les deux figures de Timothée et de Tite, nous nous rendons compte de plusieurs données très significatives. La plus importante est que Paul s'appuya sur des collaborateurs dans l'accomplissement de ses missions. Il reste certainement l'Apôtre par antonomase, fondateur et pasteur de nombreuses Eglises. Il apparaît toutefois évident qu'il ne faisait pas tout tout seul, mais qu'il s'appuyait sur des personnes de confiance qui partageaient ses peines et ses responsabilités. Une autre observation concerne la disponibilité de ces collaborateurs. Les sources concernant Timothée et Tite mettent bien en lumière leur promptitude à assumer des charges diverses, consistant souvent à représenter Paul également en des occasions difficiles. En un mot, ils nous enseignent à servir l'Evangile avec générosité, sachant que cela comporte également un service à l'Eglise elle-même. Recueillons enfin la recommandation que l'Apôtre Paul fait à Tite, dans la lettre qui lui est adressée: "Voilà une parole sûre, et je veux que tu t'en portes garant, afin que ceux qui ont mis leur foi en Dieu s'efforcent d'être au premier rang pour faire le bien" (Tt 3, 8). A travers notre engagement concret, nous devons et nous pouvons découvrir la vérité de ces paroles, et, précisément en ce temps de l'Avent, être nous aussi riches de bonnes oeuvres et ouvrir ainsi les portes du monde au Christ, notre Sauveur.