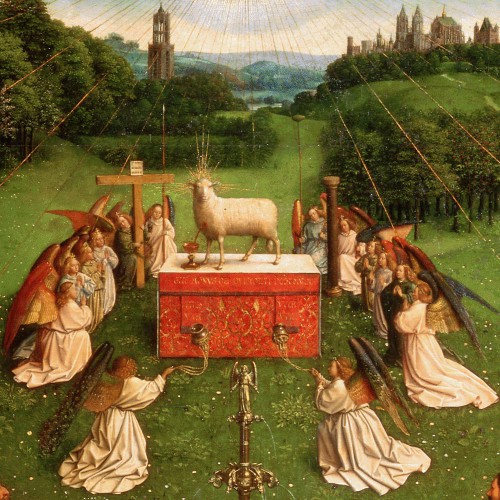On fête aujourd'hui ce grand évêque auquel un livre éclairant fut consacré il y a quelques années. Le blog de Francis Richard présente cet ouvrage :
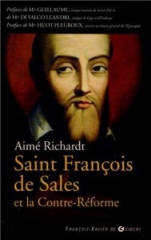 "Saint François de Sales et la Contre-Réforme" d'Aimé Richardt
"Saint François de Sales et la Contre-Réforme" d'Aimé Richardt
Depuis vingt ans Aimé Richardt écrit en moyenne un livre par an. Hormis un livre sur Louis XV, tous ses livres sont consacrés à des personnages - ou à des thèmes - des XVIe et XVIIe siècles, de préférence religieux.
Cette fois, il s'est intéressé à un saint qui a joué un grand rôle dans la renaissance catholique en France voisine, François de Sales.
Le terme de Contre-Réforme est anachronique, puisque l'auteur précise en exergue de son livre qu'il n'apparaît qu'au XVIIIe siècle finissant sous la plume d'"un juriste de Göttingen, Johann Stefan Pütter (1776), pour désigner, non un mouvement d'ensemble, mais un retour opéré de force d'une terre protestante à des pratiques catholiques...".
Or, Saint François de Sales et la Contre-Réforme montre tout le contraire, à savoir que Saint François de Sales a opéré le retour de terres protestantes à des pratiques catholiques par la seule prédication de la charité fraternelle et par des prières ardentes.
Certes le saint savoyard se montrera ferme tout le long de sa vie, mais il sera doux tout à la fois. Ce que lui reprocheront des catholiques provocateurs tels que Jules Barbey d'Aurevilly ou intransigeants comme Léon Bloy.
Avant la naissance de François de Sales, dans les années 1530, les réformés, emmenés par Berne, convertissent Lausanne et Genève par la force, c'est-à-dire en dévastant et en détruisant des églises, en malmenant physiquement des prêtres, en leur donnant des ultimatums pour se convertir et en leur interdisant de dire la messe. En 1535, l'évêque de Genève est même contraint de quitter la ville...qui devient dès lors ville protestante.
François de Sales naît le 21 août 1567 au château familial situé près de Thorens, proche d'Annecy. Après être allé à l'école de La Roche (1573-1575), il fait trois années de collège à Annecy (1575-1578), avant d'être envoyé au Collège de Clermont à Paris, où il suit pendant quatre ans (1578-1582) le cursus de grammaire, de rhétorique et d'humanité. De 1582 à 1584 il suit les cours de lettres et d'arts libéraux à la Faculté des arts, puis de 1584 à 1588 ceux de philosophie et de théologie.
Pendant ce séjour parisien, durant six semaines, fin 1586 début 1587, il traverse une crise mystique "en découvrant les disputes théologiques sur la doctrine de la prédestination". Comme le dit l'évêque de Gap, Mgr Jean-Michel Di falco Léandri dans sa préface:
"Aujourd'hui, le débat s'est déplacé. La question, chez nombre de contemporains, n'est plus: "Suis-je sauvé ou non ?", mais: "Vais-je vers le néant ou non? Vais-je vers l'indifférencié ou non? Ne suis-je qu'un conglomérat de particules élémentaires ou non?"
Mais ce qui est remarquable, c'est que cette question, même si elle est déplacée, porte, elle aussi, en elle la question de la liberté de l'homme: "Mes gènes me conditionnent-ils ou non?"
Toujours est-il que c'est à Padoue où il poursuit des études de droit et de théologie (1588-1591) que François s'apaise après avoir lu, sur la recommandation de son confesseur, le livre du père jésuite Luis Molina sur La concordance du libre-arbitre avec les dons de la grâce.
En 1592, après être retourné en Savoie, François devient avocat à Chambéry en novembre. L'année suivante il décline les lettres patentes de sénateur que lui accorde le duc de Savoie, ce qui peine son père, qui est encore plus peiné d'apprendre que son fils aîné veut servir Dieu et qu'il vient d'être nommé prévôt du chapitre de Saint Pierre de Genève.
En 1594, François de Sales se rend en Chablais entièrement acquis, par la force, aux calvinistes (il n'y a plus qu'une poignée de catholiques). Non sans mal il va le convertir par la voie d'amour, en commençant par prêcher dans sa capitale, Thonon:
"C'est par la charité qu'il faut ébranler les murs de Genève, par la charité qu'il faut l'envahir, par la charité qu'il faut la reconquérir. Je ne vous propose ni le fer, ni la poudre dont l'odeur et la saveur évoquent la fournaise de l'enfer."
A cette occasion il va innover, en 1595, en ajoutant l'apostolat par la presse à ses prédications qui n'attirent au début que de faibles auditoires. Tant et si bien qu'à la Noël 1596 toutes ses entreprises de conversion, en dépit de multiples embûches dressées par les réformés, commencent à porter leurs fruits et se traduisent peu à peu par un renversement de la situation, qui ne sera complet qu'en 1598.
Tout le restant de sa vie François de Sales va promouvoir cette voie d'amour qui a si bien réussi au Chablais avec le retour à la foi catholique de ses habitants. Cette voie est pour lui applicable en toutes circonstances, même s'il échoue, en l'empruntant, à convertir Théodore de Bèze, qu'il rencontre à plusieurs reprises.
Quand il impose à Jeanne de Chantal des règles difficiles à observer, il lui écrit:
"Il faut tout faire par amour et rien par la force; il faut plus aimer l'obéissance que craindre la désobéissance."
La vie de François de Sales est bien remplie. Il est coadjuteur, puis successeur de l'évêque de Genève. Il reprend en mains les prêtres de son diocèse dont il connaît toutes les villes. Il répond à tous ceux qui lui écrivent. Il fonde des monastères avec Jeanne de Chantal. Il écrit des livres, dont L'introduction à la vie dévote (qui a énormément de succès) et le Traité de l'amour de Dieu (qui en a beaucoup moins). Il convertit. Il prêche, souvent plusieurs fois par jour. Il voyage en Italie, en France. Il semble inépuisable.
Pourtant François de Sales tombe gravement malade par trois fois, en 1590, fin 1597 début 1598, en 1622. Il se rétablit les deux premières fois. Mais la troisième il est rappelé à Dieu, à 55 ans, ce qui n'est pas mourir jeune à l'époque.
Aimé Richardt nous restitue toute cette vie à l'aide de témoignages de contemporains, de citations de livres consacrés au saint, d'extraits des oeuvres elles-mêmes écrites par lui. Cette biographie est importante parce qu'elle nous montre un saint qui convertit par la persuasion et par le dialogue, qui aime les autres comme il aime Dieu et comme Dieu l'aime, qui est dévôt, c'est-à-dire d'une grande piété, ce qui va de pair pour lui avec la grande charité qui l'anime:
"Si la charité est une plante", écrit-il "la dévotion est la fleur...si elle est un baume précieux, la dévotion en est l'odeur."
En somme il s'agit d'un saint pour notre temps où, bien souvent, les imprécations, voire les injures, servent d'arguments, où beaucoup de choses sont imposées sans discussion, où il n'est pas question d'obtenir de consentement mais de contraindre.
Francis Richard
Saint François de Sales et la Contre-Réforme, Aimé Richardt, 270 pages, François-Xavier de Guibert