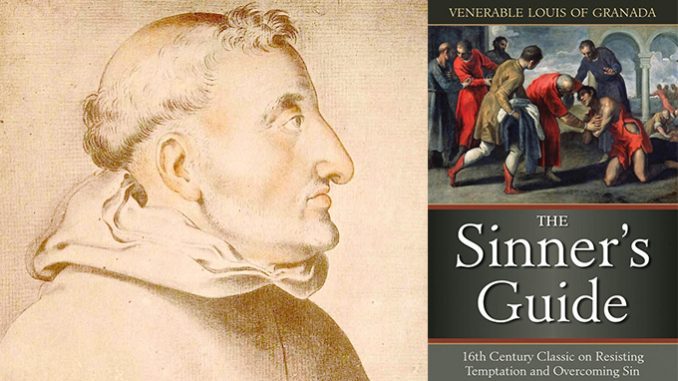LETTRE APOSTOLIQUE
UNE FIDÉLITÉ QUI GÉNÈRE L’AVENIR
DE SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XIV
À L’OCCASION DU 60e ANNIVERSAIRE
DES DÉCRETS CONCILIAIRES
OPTATAM TOTIUS ET PRESBYTERORUM ORDINIS
2. Nous ne célébrons pas un anniversaire de papier ! En effet, ces deux documents sont solidement fondés sur la compréhension de l’Église comme Peuple de Dieu en pèlerinage dans l’histoire et ils constituent une pierre milliaire de la réflexion sur la nature et la mission du ministère pastoral, et sur la préparation à celui-ci, et ils conservent au fil du temps une grande fraîcheur et une grande actualité. J’invite donc à en poursuivre la lecture au sein des communautés chrétiennes, et leur étude, dans les séminaires en particulier et dans tous les lieux de préparation et de formation au ministère ordonné.
3. Dans les Décrets Optatam totius et Presbyterorum Ordinis, bien insérés dans la Tradition doctrinale de l’Église sur le sacrement de l’Ordre, le Concile a attiré l’attention sur le sacerdoce ministériel et a fait émerger le souci des prêtres. L’intention était d’élaborer les conditions nécessaires à la formation des futures générations de prêtres selon le renouveau promu par le Concile, en conservant fermement l’identité ministérielle et en mettant en évidence de nouvelles perspectives qui intègrent la réflexion précédente, dans une optique de sain développement doctrinal. [2] Il faut donc en faire la mémoire vivante, en répondant à l’appel à saisir le mandat que ces décrets ont confié à toute l’Église : redynamiser sans cesse et chaque jour le ministère des prêtres, en puisant des forces de sa racine qui est le lien entre le Christ et l’Église, pour qu’ils soient, avec tous les fidèles et à leur service, des disciples missionnaires selon son Cœur.
4. Dans le même temps, au cours des six décennies qui se sont écoulées depuis le Concile, l’humanité a vécu et continue de vivre des changements qui exigent une vérification constante du chemin parcouru et une actualisation cohérente des enseignements conciliaires. Parallèlement, au cours de ces années, l’Église a été conduite par l’Esprit Saint à développer la doctrine du Concile sur sa nature communautaire selon la forme synodale et missionnaire. [3] C’est dans cette intention que j’adresse la présente Lettre apostolique à tout le Peuple de Dieu, afin de reconsidérer ensemble l’identité et la fonction du ministère ordonné à la lumière de ce que le Seigneur demande aujourd’hui à l’Église, en poursuivant la grande œuvre d’actualisation du Concile Vatican II. Je propose de le faire à travers le prisme de la fidélité, qui est à la fois grâce de Dieu et chemin constant de conversion pour satisfaire avec joie à l’appel du Seigneur Jésus. Je tiens tout d’abord à exprimer ma gratitude pour le témoignage et le dévouement des prêtres qui, partout dans le monde, offrent leur vie, célèbrent le sacrifice du Christ dans l’Eucharistie, annoncent la Parole, absolvent les péchés et se consacrent généreusement, jour après jour, à leurs frères et sœurs en servant la communion et l’unité et en prenant soin, en particulier, de ceux qui souffrent le plus et vivent dans le besoin.
Fidélité et service
5. Toute vocation dans l’Église naît d’une rencontre personnelle avec le Christ, « qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive ». [4] Avant tout engagement, avant toute bonne aspiration personnelle, avant tout service, il y a la voix du Maître qui appelle : « Viens et suis-moi » ( Mc 1, 17). Le Seigneur de la vie nous connaît et éclaire notre cœur de son regard d’amour (cf. Mc 10, 21). Il ne s’agit pas seulement d’une voix intérieure, mais d’une impulsion spirituelle qui nous parvient souvent à travers l’exemple d’autres disciples du Seigneur et qui prend forme dans un choix de vie courageux. La fidélité à la vocation, surtout dans les moments d’épreuve et de tentation, se renforce lorsque nous n’oublions pas cette voix, lorsque nous sommes capables de nous souvenir avec passion du son de la voix du Seigneur qui nous aime, nous choisit et nous appelle, en nous confiant également à l’accompagnement indispensable de ceux qui sont experts dans la vie de l’Esprit. L’écho de cette Parole est, au fil du temps, le principe de l’unité intérieure avec le Christ qui est fondamentale et incontournable dans la vie apostolique.