Du site de La Stampa, cette nouvelle interview du pape :
Pape François: "Le souverainisme me fait peur, mène à la guerre"
Le Pontife: "L’Europe ne doit pas fondre, il faut la sauver, elle a des racines humaines et chrétiennes. Une femme comme Ursula von der Leyen peut faire revivre la force des pères fondateurs "
09 août 2019
CITÉ DU VATICAN. Le pape ouvre la porte à 10h30 avec son sourire aimable. On entre dans l'une des pièces utilisée pour recevoir les gens, meublée avec l'essentiel, sans distractions ni luxe, juste un crucifix accroché au mur. Nous sommes arrivés à l'entrée du Perugino, la plus proche de la Casa Santa Marta. Scénario habituel: quelques soutanes, gendarmes et gardes suisses. À l'arrière-plan, le dôme de Saint-Pierre. Au Vatican, la routine habituelle est ralentie par la chaleur et le climat des vacances. Pour le pape François, ce n’est pas un jour ordinaire: c’est le 6 août, le 41e anniversaire de la mort de saint Paul VI, un pontife auquel il tient particulièrement: "En ce jour, j’attends toujours un moment pour descendre aux cryptes sous la basilique et rester seul dans la prière et le silence devant sa tombe. C'est bon pour mon coeur ». Les plaisanteries ne durent pas longtemps, nous sommes au coeur de la conversation.
François est gai et détendu. Et concentré. Ses capacités d'écoute sont impressionnantes. Il regarde toujours dans les yeux. Jamais la montre. Il prend les moments de réflexion nécessaires avant d'exprimer un avis délicat. On évoque l'Europe, l'Amazone et l'environnement. L'entretien est intense et ininterrompu. Le pape ne boit même pas une gorgée d'eau. Nous le lui signalons, il secoue les épaules et répond en souriant: "Je ne suis pas le seul à ne pas avoir bu."
Votre Sainteté, vous avez exprimé l'espoir que "l'Europe sera à nouveau le rêve des pères fondateurs". Qu'attendez-vous?
"L'Europe ne peut et ne doit pas se dissoudre. C'est une unité historique, culturelle et géographique. Le rêve des pères fondateurs était cohérent car il s'agissait d'une mise en œuvre de cette unité. Maintenant, nous ne devons pas perdre cet héritage ".
Comment voyez-vous cela aujourd'hui?
"Il s'est affaibli au fil des ans, en partie à cause de problèmes administratifs et de désaccords internes. Mais vous devez le sauver. Après les élections, j'espère qu'un processus de relance va démarrer et qu'il se poursuivra sans interruption ".
Êtes-vous satisfait de la nomination d'une femme à la présidence de la Commission européenne?
« Oui. Aussi parce qu'une femme peut être apte à raviver la force des pères fondateurs. Les femmes ont la capacité de rapprocher, d'unir ».
Quels sont les principaux défis?
"Un par-dessus tout: le dialogue. Entre les parties, les hommes. Le mécanisme mental doit être "d'abord l'Europe, puis chacun de nous". Le "chacun de nous" n'est pas secondaire, c'est important, mais l'Europe est plus importante. Dans l'Union européenne, nous devons parler, comparer et savoir. Parfois, nous ne voyons que des monologues de compromis. Non: il faut aussi écouter ».
De quoi avez-vous besoin pour dialoguer?
"Nous devons partir de notre propre identité".
Ici, les identités: pour combien comptent-elles? Si nous en faisons trop avec la défense des identités, ne risquons-nous pas l'isolement? Comment réagissons-nous aux identités génératrices d'extrémisme?
"Je vous donne l'exemple du dialogue œcuménique: je ne peux faire de l'œcuménisme que si je pars de mon catholicisme, et l'autre qui pratique l'œcuménisme avec moi doit le faire en tant que protestant, orthodoxe ... Son identité n'est pas négociable, elle est intégrée. Le problème avec les exagérations est que l'on se ferme sur son identité, on ne s'ouvre pas. L'identité est une richesse - culturelle, nationale, historique, artistique - et chaque pays a la sienne, mais elle doit être intégrée au dialogue. Cela est décisif: de sa propre identité, il faut s’ouvrir au dialogue afin de recevoir quelque chose de plus grand de l’identité des autres. N'oubliez jamais que le tout est supérieur à la partie. Globalisation, l'unité ne doit pas être conçue comme une sphère, mais comme un polyèdre: chaque peuple conserve son identité dans l'unité avec les autres ".
Quels sont les dangers du la souverainisme?
"Le souverainisme est une attitude d'isolement. Je suis inquiet parce que nous entendons des discours qui ressemblent à ceux d'Hitler en 1934. «D'abord, nous. Nous ... nous ... ": ce sont des pensées effrayantes. Le souverainisme est la fermeture. Un pays doit être souverain, mais pas fermé. La souveraineté doit être défendue, mais les relations avec les autres pays et avec la Communauté européenne doivent également être protégées et promues. Le souverainisme est une exagération qui finit toujours mal: il conduit à des guerres ».
Et les populismes?
"Même discours. Au début, j’ai eu du mal à comprendre parce que, en étudiant la théologie, j’ai approfondi le popularisme, c’est la culture du peuple: une chose est que les gens s’expriment, un autre est d’imposer une attitude populiste au peuple. Le peuple est souverain (il a une façon de penser, de s’exprimer et de ressentir, d’évaluer), mais les populismes nous mènent à des souverainismes: ce suffixe, "isme", n’est jamais bon ".
Comment parler des migrants?
«Tout d'abord, n'oubliez jamais le droit le plus important: le droit à la vie. Les immigrants arrivent principalement pour fuir la guerre ou la faim, du Moyen-Orient et d'Afrique. Sur la guerre, nous devons nous engager et lutter pour la paix. La faim concerne principalement l’Afrique. Le continent africain est victime d'une malédiction cruelle: il semble être exploité dans l'imaginaire collectif. Une partie de la solution consiste plutôt à investir sur place pour résoudre leurs problèmes et mettre un terme aux flux migratoires. "
Mais puisqu'ils viennent à nous, comment devrions-nous nous comporter?
"Les critères doivent être suivis. Premièrement: recevoir, qui est aussi une tâche évangélique chrétienne. Les portes doivent être ouvertes et non fermées. Deuxièmement: accompagner. Troisièmement: promouvoir. Quatrième intégrer. Dans le même temps, les gouvernements doivent penser et agir avec prudence, ce qui est une vertu du gouvernement. Qui administre est appelé à dire combien de migrants peuvent être reçus ».
Et si le nombre est supérieur aux possibilités de réception?
«La situation peut être résolue par le dialogue avec d'autres pays. Il y a des États qui ont besoin de gens, je pense à l'agriculture. J'ai vu quelque chose comme cela qui s'est passé récemment face à une urgence: cela me donne de l'espoir. Et puis, savez-vous à quoi cela servirait aussi? "
A quoi ?
« La créativité. Par exemple, ils m'ont dit que dans un pays européen, il y a des villes à moitié vides en raison du déclin démographique: certaines communautés de migrants pourraient y être transférées, ce qui pourrait, entre autres, relancer l'économie de la région ".
Sur quelles valeurs communes devrait reposer la relance de l'UE? L'Europe a-t-elle encore besoin du christianisme? Et dans ce contexte, quel rôle ont les orthodoxes?
«Le point de départ, ce sont les valeurs humaines de la personne humaine. Avec les valeurs chrétiennes: l'Europe a des racines humaines et chrétiennes, c'est l'histoire qui la raconte. Et quand je dis cela, je ne sépare pas catholiques, orthodoxes et protestants. Les orthodoxes ont un rôle très précieux pour l'Europe. Nous avons tous les mêmes valeurs fondamentales ».
Nous traversons mentalement l'océan et pensons à l'Amérique du Sud. Pourquoi convoquer un synode sur l'Amazone en octobre au Vatican?
"Il est le" fils "de" Laudato si '". Ceux qui ne l'ont pas lu ne comprendront jamais le Synode sur l'Amazonie. Laudato si ’n’est pas une encyclique verte, c’est une encyclique sociale qui repose sur une réalité" verte ", la garde de la Création".
Y at-il un épisode significatif pour vous?
"Il y a quelques mois, sept pêcheurs m'ont dit:" Ces six derniers mois, nous avons collecté 6 tonnes de plastique". L'autre jour, j'ai lu un article sur un immense glacier d'Islande qui avait presque complètement fondu: ils lui avaient construit un monument funéraire. Avec l'incendie de la Sibérie, certains glaciers du Groenland ont fondu par tonnes. Les habitants d'un pays du Pacifique sont en mouvement parce que dans vingt ans, l'île où ils vivront ne sera plus. Mais les données qui m'ont le plus choqué en sont une autre ».
Lequel?
«The Overshoot Day: le 29 juillet, nous avons épuisé toutes les ressources régénérables de 2019. À partir du 30 juillet, nous avons commencé à consommer plus de ressources que celles que la planète parvient à régénérer en un an. C'est très grave. C'est une situation d'urgence mondiale. Et le nôtre sera un synode d’urgence. Mais faites attention: un synode n'est pas une réunion de scientifiques ou d'hommes politiques. Ce n'est pas un Parlement, c'est autre chose. Cela vient de l'Eglise et aura une mission et une dimension évangélisatrices. Ce sera une œuvre de communion guidée par le Saint-Esprit ".
Mais pourquoi se concentrer sur l'Amazone?
«C'est un lieu représentatif et décisif. Avec les océans, il contribue de manière décisive à la survie de la planète. Une grande partie de l'oxygène que nous respirons provient de là. C'est pourquoi la déforestation signifie tuer l'humanité. Et puis, l’Amazonie implique neuf États et ne concerne donc pas un seul pays. Et je pense à la richesse de l'Amazonie, de la biodiversité végétale et animale: c'est merveilleux ».
Le Synode discutera également de la possibilité d'ordonner des "viri probati", hommes âgés et mariés, qui peuvent remédier au manque de clergé. Sera-ce l'un des thèmes principaux?
"Absolument pas: il s'agit simplement d'un point de l'Instrumentum Laboris (le document de travail, éd). L’important sera les ministères de l’évangélisation et les différentes façons d’évangéliser ".
Quels sont les obstacles à la sauvegarde de l'Amazonie?
"La menace de la vie des populations et du territoire découle des intérêts économiques et politiques des secteurs dominants de la société".
Alors, comment la politique devrait-elle se comporter?
«Éliminer leurs propres connivences et corruptions. Il doit assumer des responsabilités concrètes, par exemple en ce qui concerne les mines à ciel ouvert, qui empoisonnent l’eau et causent tant de maladies. Ensuite, il y a la question des engrais ".
Votre Sainteté, que craignez-vous le plus pour notre planète?
«La disparition de la biodiversité. Nouvelles maladies mortelles. Une dérive et une dévastation de la nature pouvant mener à la mort de l’humanité ".
Voyez-vous une prise de conscience de la question de l'environnement et du changement climatique?
"Oui, en particulier dans les mouvements de jeunes écologistes, comme celui dirigé par Greta Thunberg, "Fridays for future". J'ai vu un de leur panneau qui m'a frappé: "Nous sommes l'avenir!" ».
Notre conduite quotidienne - recycler, faire attention à ne pas gaspiller l’eau à la maison - peut affecter ou est insuffisante pour contrer le phénomène?
"Cela concerne tout, car il s’agit d’actions concrètes. Et surtout, cela crée et diffuse la culture de ne pas souiller la création ».
 « Depuis plusieurs semaines, les soupçons de détournement de 15 millions de dollars des caisses de l’Etat empoisonnent le climat politique congolais. Il faut dire que le sujet est d’autant plus sensible que le nouveau président Félix Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption son principal marqueur politique. L’affaire porte sur une somme de 100 millions de dollars versée par l’Etat aux entreprises pétrolières « pour compenser leur manque à gagner ». Sur ces 100 millions, 15% de « décote » devaient revenir au Trésor public congolais. Mais le 17 juillet dernier, un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) se penche sur la transaction et affirme que l’Etat n’a jamais vu la couleur des 15 millions de dollars, qui ont été versés sur un autre compte bancaire, contrevenant ainsi « aux dispositions légales et règlementaires régissant les finances publiques », affirme l’IGF.
« Depuis plusieurs semaines, les soupçons de détournement de 15 millions de dollars des caisses de l’Etat empoisonnent le climat politique congolais. Il faut dire que le sujet est d’autant plus sensible que le nouveau président Félix Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption son principal marqueur politique. L’affaire porte sur une somme de 100 millions de dollars versée par l’Etat aux entreprises pétrolières « pour compenser leur manque à gagner ». Sur ces 100 millions, 15% de « décote » devaient revenir au Trésor public congolais. Mais le 17 juillet dernier, un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) se penche sur la transaction et affirme que l’Etat n’a jamais vu la couleur des 15 millions de dollars, qui ont été versés sur un autre compte bancaire, contrevenant ainsi « aux dispositions légales et règlementaires régissant les finances publiques », affirme l’IGF.
 Y voit-on un peu plus clair dans la constitution du gouvernement congolais? Après une gestation de sept mois, un accord aurait été signé (31 juillet) entre les deux compères qui ont confisqué le pouvoir -après une série d’élections truquées à tous les niveaux- pour mettre en route un attelage, gigantesque et budgétivore, de 48 ministres et 17 vice-ministres, soit au total 65 portefeuilles à répartir : mais comment ? 42 pour Kabila (label FCC) et 23 pour Tshisekedi (label CASH). Analyse de Christophe Rigaud sur le site web « Afrikarabia » :
Y voit-on un peu plus clair dans la constitution du gouvernement congolais? Après une gestation de sept mois, un accord aurait été signé (31 juillet) entre les deux compères qui ont confisqué le pouvoir -après une série d’élections truquées à tous les niveaux- pour mettre en route un attelage, gigantesque et budgétivore, de 48 ministres et 17 vice-ministres, soit au total 65 portefeuilles à répartir : mais comment ? 42 pour Kabila (label FCC) et 23 pour Tshisekedi (label CASH). Analyse de Christophe Rigaud sur le site web « Afrikarabia » :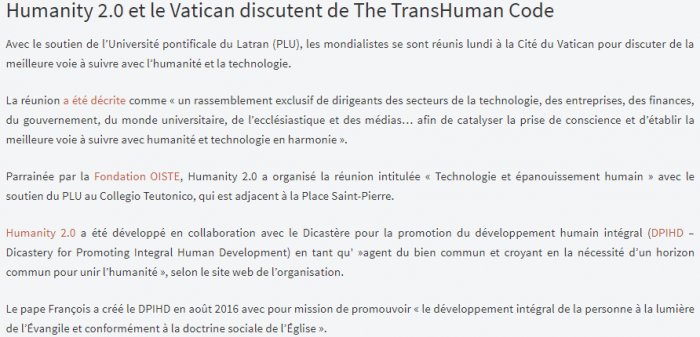

 De
De 