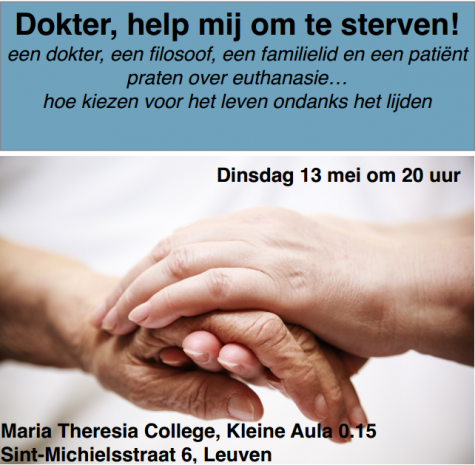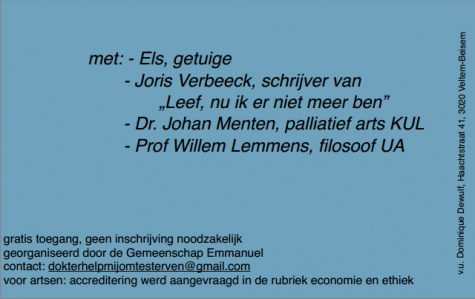De Sébastien Maillard dans le journal « La Croix » extraits) :
« Chiffres précis, arguments juridiques affûtés, riposte aux attaques jugées idéologiques… les deux jours d’audition publique du Saint-Siège devant le comité des Nations unies contre la torture, les 5 et 6 mai à Genève, ont été un temps d’échange difficile sur des sujets douloureux mais de haute tenue.
La délégation vaticane, conduite par le nonce apostolique auprès de l’ONU, Mgr Silvano Tomasi, était interrogée dans le cadre de la surveillance du respect de la convention onusienne contre la torture. Un texte de 1984, signé par le Saint-Siège en 2002, et sur lequel le comité de l’ONU contre la torture a pour charge de veiller.
Deux controverses juridiques ont dominé l’audition. La première, comme lors de l’audition en janvier devant le comité de l’ONU des droits de l’enfant, porte sur l’étendue de la responsabilité légale du Saint-Siège. Celui-ci tend à la circonscrire au seul territoire de la Cité du Vatican, ayant sur le reste de l’Église universelle une « responsabilité pastorale », selon la distinction de Mgr Tomasi sur Radio Vatican (…)..
Mais la précaution de ne pas interférer avec les juridictions nationales propres à chaque pays ne convainc pas le rapporteur du comité de l’ONU, la juriste américaine, Felice Gaer, qui s’est montrée durant toute l’audition une experte tenace. Selon son raisonnement, tous les représentants et fonctionnaires d’un État même à l’extérieur des frontières du pays sont soumis à sa législation.
L’autre débat a porté sur l’étendue de la notion de torture et traitements inhumains en cause dans la convention onusienne (…)..Ce n’est pas comme le viol en tant qu’arme de guerre », soulève une source vaticane. Durant l’audition, le Saint-Siège a dû, en tout état de cause, justifier dans le détail sa lutte contre les abus sexuels sur mineurs commis par des prêtres alors que son rapport de 25 pages remis en amont au comité n’y faisait pas allusion.
En réponse aux demandes précises formulées la veille par le rapporteur Gaer, Mgr Tomasi a évoqué le nombre d’accusations crédibles contre des prêtres pédophiles transmis à la Congrégation pour la doctrine de la foi, année après année, de 2004 à 2013 inclus, donnant un total de 3 420 cas.
Ceux-ci concernent le plus souvent des faits remontant aux années 1960, 1970 et 1980. Le nonce apostolique a également chiffré le nombre de prêtres réduits à l’état laïc sur cette même période – 848 – et ceux frappés d’autres mesures disciplinaires 2 572. (…).Ces données, la révision du code pénal du Vatican intégrant la convention de l’ONU contre la torture et l’installation de la nouvelle commission pontificale pour la protection de l’enfance devraient amener le comité contre la torture à rendre des conclusions, avec des critiques dures, mais bien plus équilibrées et mieux formulées que celles du comité des droits de l’enfant », estime Alessandra Aula, secrétaire générale du Bureau international catholique de l’enfance (Bice), qui a suivi les deux jours d’audition, dont le « haut niveau » l’a impressionnée (…).
Réf. Débat juridique avec le Saint-Siège au comité de l’ONU contre la torture.
La question juridique est notamment de savoir si la relation existant entre le Saint-Siège, organisation dotée d’une personnalité de droit international (distincte de celle de l’Etat de la Cité du Vatican, dont la juridiction s’étend sur un millier de citoyens au plus) et les clercs de l’Eglise catholique est assimilable au lien d’autorité existant entre un commettant,quelle que soit la nature du lien, et ses préposés, statutaires, contactuels ou autres.
Pour le reste, il s'agir de faits souvent prescrits sur le plan pénal, chronique d’un laisser-aller lamentable : 3 420 cas de pédophilie cléricale concernant le plus souvent des faits remontant aux années 1960, 1970 et 1980, une époque qualifiée, en son temps, de « gulf stream de la grâce » conciliaire par le cardinal Suenens. JPSC.


 D’après un communiqué de l’agence Belga : Le pape Paul VI, à la tête de l'Eglise catholique de 1963 à 1978 et qui l'a gouvernée dans la période difficile de l'après-Concile Vatican II, sera béatifié le 19 octobre, a annoncé samedi le Vatican.
D’après un communiqué de l’agence Belga : Le pape Paul VI, à la tête de l'Eglise catholique de 1963 à 1978 et qui l'a gouvernée dans la période difficile de l'après-Concile Vatican II, sera béatifié le 19 octobre, a annoncé samedi le Vatican.